Qui a pété ?

Le fond de l’air est rouge

Année : 1977
Réalisation : Chris Marker
Voulu ou pas, ce qui ressort de ce documentaire retraçant les différentes luttes communistes de la seconde moitié du XXᵉ, c’est surtout l’impression d’un grand mirage. On est loin des principes révolutionnaires du siècle des lumières.
Liberté ? Liberté de fermer ta gueule si tu n’es pas d’accord, que ce soit avec l’impérialisme US (Vietnam, Chili, Bolivie), ou avec les groupuscules de partis de gauche qui se font la guerre, chacun étant persuadé que l’autre a toujours tort, et que parce qu’il a tort, c’est un bourgeois qui s’ignore (cf. Jean Vilar, créateur du TNP, ça ne s’invente pas).
Égalité ? Mon cul… C’est une lutte qui ne tient pas à créer une société de l’ensemble mais une société du contre. De la haine anti-riches, anti-patrons, antibourgeois, et pourquoi ne pas dire au fond anti-cons, ça résume assez bien…
C’est rappelé dans le doc : on est toujours le gauchiste de quelqu’un finalement…
Belle pseudo-révolution de mai 68 en France, quand ailleurs, on se bat contre des dictatures ou contre l’impérialisme. On a ici ce qui deviendra plus tard des bobos, des étudiants parisiens qui jouent à la révolution. C’est ce qui s’appelle « tuer le père »… Les soixante-huitards n’avaient rien de communiste. C’était la révolte de petits cons attardés faisant tardivement leur crise d’adolescence contre l’autorité parentale. La belle ironie : faire tomber de Gaulle pour arriver à Pompidou et à Giscard. « La France de Pompidou », c’est la Contre-Réforme de la société en réponse à cette révolution de la bourgeoisie protestataire (qui n’est pas encore le “prolétariat”). Forcément, c’est la faute des “médias” qui avaient tourné en dérision les événements en en montrant que les aspects violents pour faire peur à la ménagère. Les ouvriers ont eu du mal à débrailler, et une fois fait, les étudiants se sont barrés estimant ne pas faire la révolution pour se battre… Elle est belle la révolution. On veut faire comme le Che (ou plutôt comme Debray) : la révolution sans en prendre sur la gueule. « Sous les pavés, la plage » symbole de mai 68, résume assez bien le sens de cette révolution de sorbonnard ; slogan plus anarchiste que communiste.


Un intervenant prophétise en quelque sorte les maigres changements à venir, et peut-être la seule issue : « Communisme et capitalisme ont fait la preuve de leur inefficacité. La solution est peut-être un entre-deux. Le capitalisme se muant en libéralisme et le communisme en socialisme. Une société qui ferait le compromis des deux. » La dilution a bien eu lieu, mais de compromis il n’y en a pas eu, la mondialisation ayant profité (c’est bien le mot) à une classe dominante et les inégalités n’ayant cessé de s’accentuer. La force de l’industrialisation, c’est d’offrir un confort que même les plus “communistes” ne peuvent plus refuser. L’eldorado d’un capitaliste profitant à tous… La classe dirigeante se coupe de sa base, minorité ultra-profiteuse, on peut l’accepter jusqu’à la fin des Trente glorieuses. Cet eldorado n’est lui aussi qu’un mirage. Pour contenter tout le monde, la réussite reposait sur quelques principes : surproduction, surconsommation. Il faut bien exploiter quelque chose pour profiter. Si ce ne peut être les hommes, ce sera les ressources. Alors l’écologie a fait son apparition. La révolution verte est, à peu de chose près, une révolution rouge. Le constat est bon ; les propositions, inacceptables. La contestation n’est plus ouvrière. L’ouvrier est mort, Thatcher l’a tué, ou expulsé en Asie. Dans “industrie”, il y a “Indus”, donc elle peut bien retourner d’où elle vient. « Ah, non, merde, reviens, ce n’est pas ce que je voulais dire !… ». Eh oui, plus qu’une révolution rouge, le XXᵉ siècle a été une révolution de la mondialisation. Plus qu’une crise des idéologies, qu’une crise économique, c’est surtout une crise identitaire où chacun doit repenser sa place en fonction de celle du voisin. Une mutation de chaque instant qui est contraire à l’idée qu’on se fait, qu’on nous vend, et à laquelle on aspire, du confort. Il n’est plus question de liberté ou d’égalité, mais de bien-être. Le Bhoutan va même jusqu’à parler de Bonheur national brut, en référence au PIB.
La mutation “géniale” du capitalisme — ou de la bourgeoisie, certains diraient — c’est que pour étouffer la lutte ouvrière, il suffisait de ne plus avoir d’ouvrier, donc d’usine, et de n’avoir plus que des consommateurs. L’opium du peuple, on disait à une époque. On préfère continuer à fumer, malgré les taxes, malgré la mauvaise santé. C’est tellement agréable d’être con, c’est-à-dire, se plaindre en crachant des volutes de fumée que tous les autres le sont. La plainte n’a jamais causé de tort qu’à celui qui se plaint. Le capital dit à l’exploité : allez, tire une taffe. Et l’exploité s’exécute. L’exploité se plaindra du prix et des taxes sur les cigarettes, mais refuse simplement d’arrêter de fumer. Il n’y a pas de pire esclave que l’esclave qui s’ignore. Et quand ce n’est pas la cigarette, c’est le loto : les mirages ont toujours fait recette. Il n’est plus question de prolétaires et de capitalistes, mais de dealers et de camés. Le fond de l’air n’est pas rouge, il est enfumé. On ne voit rien et on continue de croire que notre myopie ne constitue pas une vision étouffée de la réalité. Alors la contestation est là, oui, vaguement écologiste, mollement anticapitaliste, mais l’exploité lui, il n’a plus d’idéal, il rêve déjà, et il n’attend que sa dose quotidienne. On voudrait supprimer les patrons tout en gardant son droit à posséder un iPod et à fumer ses clopes.
On n’est pas des hommes. La civilisation n’existe pas. Il n’y a que des trous du cul qui engendrent des trous du cul. Chaque trou du cul chie sur son voisin trou du cul. Quand des milliards de trous du cul se mettent à chier sur la planète, ça sent mauvais. Et c’est toujours la merde du voisin qui pue le plus. On est dans une grande chiasse mondialisée et personne n’a idée de comment on va arrêter la colique. Qu’on ait les « mains coupées » ou les « mains libres », c’est du pareil au même : on s’en lave les mains. Il suffit de tirer la chasse. On ne sait pas où ça va, mais ça débarrasse, et c’est tant mieux. Le capital n’a pas d’odeur et est incolore. Le reste, si. C’est toute la magie d’une ère de consommation. Les mirages permettent de voir loin et de voir venir (sans jamais atteindre son but). Et pendant ce temps, ce n’est pas « sous les pavés, la plage », mais sous le tapis, la merde.

Le fond de l’air est rouge, Chris Marker 1977 | Dovidis, INA, Iskra





 Année : 2008
Année : 2008







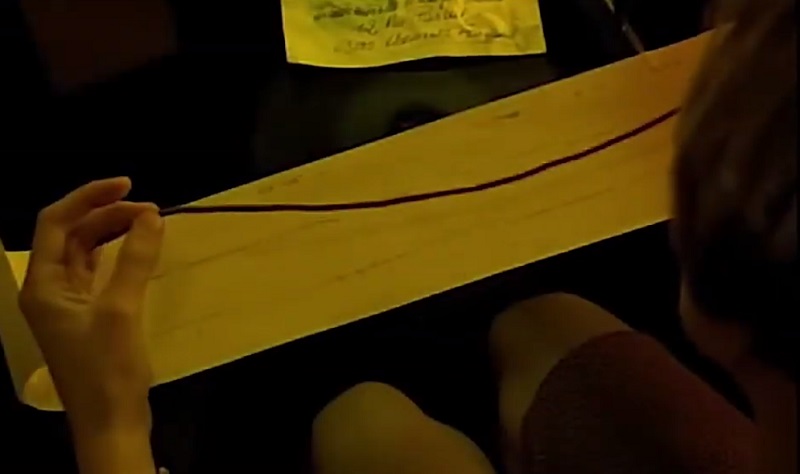

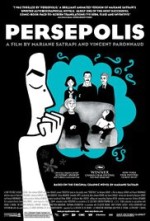



 Année : 1973
Année : 1973















 Année : 1959
Année : 1959


 Année : 1953
Année : 1953
