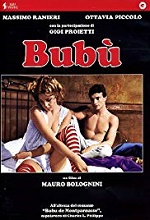Deux tourtereaux pris par l’urgence de survivre : résister à la tentation du jeu, de la convoitise de l’étranger, et retrouver les bonnes vieilles valeurs populaires.
Les quinze premières minutes sont magnifiques. Les deux amoureux échouent dans un hôtel, accablés par les dettes ; ils osent à peine se regarder, se demandant comment survivre. Tout est affaire ici de regards : la manière de les faire dialoguer dans le montage. Un peu comme trente ans plus tard, Valerio Zurlini réussira à le faire dans le magnifique Été violent.
Le montage suit littéralement le langage des yeux : une situation, une atmosphère, une attitude pensive suivie d’un roulement d’yeux tout ce qu’il y a de plus simple au monde et qui est le signe qu’on cherche à chasser une pensée par une autre ; et puis un regard qui en cherche un autre parfois hors champ ; et hop, on coupe pour montrer ce qui est vu ; et rebelote. Les yeux, rien que les yeux. Pour montrer ce qu’on pense, pour montrer la détresse, la solitude (parfois partagée), il suffit de regarder, mais de manière très épurée, sans autre mouvement, celui qui regarde et n’est pas censé être vu. On se passe ainsi pas mal d’intertitres, car on lit tout dans un regard, surtout l’indéchiffrable. Et en effet, en un peu plus d’une heure, le film n’en contient qu’une vingtaine. In the Mood for…



L’influence allemande, celle de Murnau tendance Kammerspielfilm (voire celle de L’Aurore, avec l’attrait pernicieux des lumières de la ville, le personnage tentateur) est évidente, même si on joue moins sur les décors : l’accent est plutôt ici mis sur la psychologie des personnages (on est loin de l’expressionnisme, si le jeu est plein d’intensité, on est dans une veine beaucoup plus naturaliste, voire stanislavskienne), et la caméra est parfois virevoltante sans jamais tomber dans les excès.
Le cœur du film est peut-être moins convaincant. Le jeune délaissant sa belle, accaparé qu’il est par ses gains, puis ses pertes, au casino ; et la belle voyant fatalement rôder autour d’elle un bellâtre bien né dont elle n’a que faire.
Cela a au moins le mérite d’être vite expédié et d’être efficace. Même en Italie, 1929 semble avoir été un cru exceptionnel pour le muet…



 Cold War Zimna wojna, Pawel Pawlikowski 2018 Opus Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej, MK2 Films
Cold War Zimna wojna, Pawel Pawlikowski 2018 Opus Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej, MK2 Films