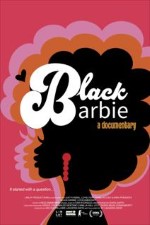La Verte Moisson
Année : 1959
Réalisation : François Villiers
Avec : Pierre Dux, Dany Saval, Jacques Perrin, Claude Brasseur
Le récit des héros ordinaires fait rarement des histoires extraordinaires…
Des gosses de première dans un lycée de banlieue parisienne décident de s’improviser résistants face à l’occupation allemande. Mise en place de petits coups sans importance, puis passage à un autre un peu plus consistant. Manque de bol, ils se font se choper pour une histoire idiote dont ils ne sont même pas responsables.
Bien entendu, les apprentis Guy Môquet ne flancheront pas et resteront les bons petits héros dont chaque patrie chahutée par les affres de la guerre rêverait avoir.
Les vrais héros, il faut évidemment les honorer, mais le faire au cinéma cela implique souvent de nier toute possibilité aux nuances, aux paradoxes, aux contradictions de s’exprimer, et l’on se retrouve avec des histoires lisses.
Ces histoires de héros, on les connaît tous. Les héros ont tous la même histoire. Ils sont droits, courageux, ils sauvent la patrie, la mère et l’orphelin. D’accord. Et après ? Ça ne fait pas de bons films. À moins, parfois, d’y ajouter une note personnelle qui aille du côté de la fantaisie, de la romance, de la camaraderie. Parler d’autre chose en somme, s’intéresser à un angle oblique, moins frontal qui tombera fatalement dans l’hagiographie des héros.
Inutile de creuser beaucoup, car en réalité, les vrais héros n’existent pas ; du moins, ils sont en réalité bien différents de l’image que l’on se fait d’eux si l’on ne s’applique qu’à les montrer sous les aspects qui font d’eux justement des héros.
Le film expose brièvement quelques questions comme la peur, le doute, la frivolité, l’immaturité, mais de simples évocations ne font ni un angle ni un film. Si ça ne fait pas le sujet du film, je peine à croire qu’un film sur des héros, et non avec des héros puisse véritablement soulever l’intérêt du spectateur.
Les évidences, pour répéter un meme en vogue : « vu et s’en tape ». Pas le meilleur moyen d’honorer les héros de ces histoires sans saveur.
La Verte Moisson, François Villiers (1959) | Caravelle