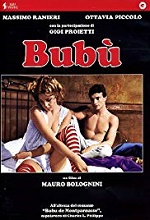Pâques sanglantes
Titre original : Non c’è pace tra gli ulivi
Année : 1950
Réalisation : Giuseppe De Santis
Avec : Raf Vallone, Lucia Bosè, Folco Lulli
— TOP FILMS —
Un mélange surprenant de néoréalisme et peut-être… d’expressionnisme. Le passage par un sujet ancré dans la ruralité (rappelant les thématiques propres au western) et le recours constant aux décors naturels d’une force inouïe (montagnes de basse altitude, rocailleuses, avec quelques ombrages d’oliviers) assure le côté néoréaliste du film (dans la continuité de Riz amer, du même Giuseppe De Santis).

Paysage rocailleux | Non c’è pace tra gli ulivi, Pâques sanglantes, Giuseppe De Santis (1950) | Lux Film

Pâques sanglantes, Giuseppe De Santis (1950) | Lux Film
Le plus surprenant cependant, ce sont les options choisies dans la mise en scène : la sophistication, voire l’artifice, est constante. Pour rester au plus près de ses acteurs Giuseppe De Santis multiplie les plans rapprochés, c’est ensuite une sorte de valse continue qui s’opère entre les acteurs et la caméra. Celle-ci, malgré le décor escarpé, est toujours mobile, suivant les personnages en travelling d’accompagnement, manifestement posée sur un rail. Les acteurs peuvent évoluer autour d’elle, et elle les suit alors sur son axe.


Plus surprenant encore, les acteurs parlent parfois face caméra, soit en regardant l’objectif soit en regardant derrière elle tout en s’adressant à leur interlocuteur qu’on voit également dans le champ et qu’on voit ne pas être regardé par son partenaire au moment où il lui parle et s’adresse à la caméra… Ce n’est pas systématique, surtout proposé lors des séquences entre les deux amoureux des rôles principaux, et ça réussit assez bien.



La distanciation produite proposée est assez radicale. J’en ai rarement vu élaborée sous cette forme, avec autant d’audace sans pour autant tourner à la pure expérimentation, et aussi efficace dans une fiction. Regarder la caméra, ce n’est pas rare ; la regarder un peu, ou pas tout à fait, mais regarder au loin comme on le ferait au théâtre sans même regarder son partenaire, adoptant en conséquence des mouvements de déplacement d’acteurs qui n’ont rien de réalistes (même au cinéma, à cette époque, on sait se positionner l’un à l’autre en formant un angle et en faisant croire qu’on se fait face alors qu’en réalité on se positionne pour que la caméra nous voie mieux), et avoir une telle inventivité, proche de la danse en offrant certaines postures évocatrices, dans ces déplacements et ces cadrages, j’avoue ne pas avoir vu souvent ça.
On aurait presque l’impression que la caméra est un drone qui les suit au plus près et dont les acteurs auraient conscience, et on ne serait alors presque pas étonnés de voir un acteur toucher la caméra pour lui faire changer d’angle… Le dispositif est déjà fascinant, mais le faire dans un environnement aussi rustique, ça ne fait que renforcer sa singularité et l’effet produit.
La photo, en dehors d’une grande profondeur de champ et du format carré rappelant pour beaucoup les caractéristiques de la vision humaine, est d’un noir et blanc magnifique, pleine de contraste rappelant, à raison ou non, celle de La Perle, tourné trois ans avant.
(Toutes les captures sont issues des dix premières minutes. Ça pose le décor…)