Triangle amoureux classique, le dilemme vieux comme la pluie, et pourtant ça marche toujours.
Le mari et sa femme vivent dans une petite ville comme le titre l’indique, éloignés du chahut de la grande ville. On est presque à la campagne. C’est paisible, mais on voit les traces de la guerre un peu comme dans Autant en emporte le vent, avec des murets éclatés… Un serviteur vit avec eux, ainsi que la sœur du mari, tout juste nubile (c’est le printemps pour tout le monde). Lui, le mari, souffre de la tuberculose et refuse de se soigner ; elle, sa femme, se languit par l’ennui. C’est une sorte de Madame Bovary qui attend que quelque chose vienne la délivrer, ou la réveiller…
L’un des coups de génie de ce film, il commence par l’angle employé pour raconter cette histoire. C’est la femme qui la raconte, chuchotant presque. Quelques phrases au début, puis parfois une pensée pour exprimer son état d’esprit, pour compter le temps qui passe. Au lieu de mettre des panneaux « le jour suivant », pourquoi ne pas le faire dire par un narrateur… ? Je n’ai jamais vu ça, et pourtant ça marche parfaitement. Des voix off, on en voit souvent au cinéma, la voix du narrateur, mais quand on y pense, c’est systématiquement celle d’un homme. La voix du narrateur, c’est un peu celle du dieu omnipotent, donc forcément, on pense à un homme… Pourquoi avoir choisi la femme pour raconter cette histoire ? Ça marche tellement bien sous cet angle que ça peut paraître évident, encore faut-il avoir eu l’idée. Les meilleures idées sont les plus simples, pourtant, je ne me rappelle pas avoir vu un tel procédé.
Un visiteur se présente donc dans le domaine. Un ami que le mari n’a pas vu depuis une dizaine d’années. Sa femme ne le voit pas encore, mais quand elle apprend son nom, elle commence à s’inquiéter parce qu’elle a connu quelqu’un qui portait ce même nom (récit en voix off). Ils se rencontrent finalement, et c’est bien lui : les deux expliquent au mari qu’ils étaient du même village, et qu’ils ont grandi ensemble…



Les dés sont lancés. On peut deviner la suite. Ils s’étaient juré autrefois de ne jamais se quitter, mais les événements les ont séparés…, et à nouveau rapprochés. Le film parvient à échapper à la tentation du passage à l’acte. Mais au pays du taoïsme, la règle du non-agir est une vertu. Les deux personnages ont le temps de pécher en pensées (ils semblent envisager toutes les possibilités : le passage à l’acte, ça peut être la consommation de leur amour, comme ça peut être… le meurtre du mari). Mais, ce ne sont pas Les Amants diaboliques. On est beaucoup plus près d’In the Mood for Love avec ces deux amants qui se promènent, se reniflent, ne savent quoi se dire, s’enlacent, puis se repoussent… C’est une danse impossible entre deux aimants. Cette manière d’arriver à décrire des situations sans tomber dans la grossièreté d’un « passage à l’acte », rend tous les personnages sympathiques. Encore un de ces films sans méchants, presque philanthropiques. L’opposition, elle vient des événements, on est conscient que personne n’est coupable de quoi que ce soit, et on ne veut pas être le premier à fauter. Ce sont des épreuves imprévues qu’il faut accepter sans pointer la responsabilité sur l’un ou l’autre… Même la jalousie du mari n’en est pas une. Personne n’a rien fait de mal, pourtant tout le monde se sent coupable.
Si dans In the Mood for Love, l’utilisation de la musique est primordiale, ici c’est une autre musique qu’on entend. Celle du silence. Le rythme se ferme dans une même lenteur, pesante, comme une respiration qui s’étire, comme quand on ne veut pas déranger et que les mouches font un vacarme inouï. La maîtrise du rythme et du ton est totale, je ne sais même pas s’il y a des équivalents à cette époque. Chez Orson Welles peut-être…, d’ailleurs, le film présente les personnages et les acteurs un peu comme Welles le faisait au début de ses films. Là encore, on peut imaginer une inspiration directe, étant donné que ce n’est pas très fréquent comme procédé.
Tout le reste du film est tout autant maîtrisé : les acteurs gardent parfois le rythme très particulier de la pantomime, mais en 1948 on a eu le temps de perdre les tics du muet (on peut en voir un peu dans Les Anges du boulevard, 1937 — où parfois même avec des scènes sonorisées, les acteurs jouent sans dialogues, avec une belle réussite d’ailleurs).
Les décors et la lumière sont magnifiques : mouvements de caméra, contre-plongées, plans larges pour laisser la liberté à la mise en scène et aux acteurs (au lieu de passer systématiquement par le montage), des effets de lumière tout aussi magnifiques (comme cette scène dans la chambre du mari, à l’ombre de la lune où, à tour de rôle, son visiteur, puis sa femme, vient lui rendre visite, et qu’on voit la porte vitrée en ombre s’ouvrir sur le voile de son lit…).
En bonne place dans l’histoire du cinéma chinois. 5ᵉ dans la Golden Horse list.

Le Printemps d’une petite ville, Fei Mu 1948 Xiao cheng zhi chun | Wenhua Film Company


Listes sur IMDB :
✓
✓



 Année : 1988
Année : 1988










 Année : 1990
Année : 1990


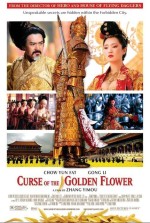
 Année : 2006
Année : 2006
 Année : 2006
Année : 2006









