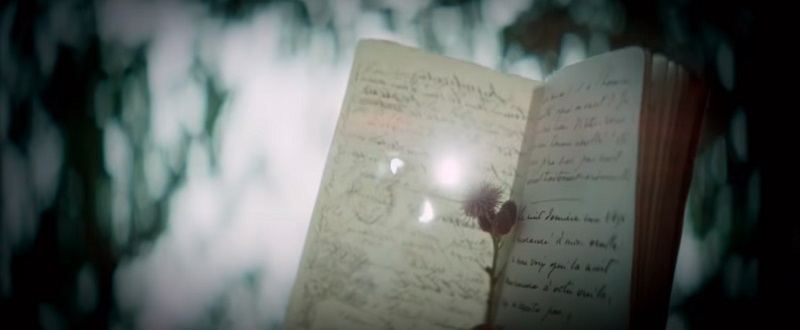Je passe rapidement sur le sujet ridicule du film (les nazis projettent d’obliger Churchill à pratiquer plus de sport qu’il ne se l’autorise pour sa santé) qui se goupille maladroitement (histoire d’amour inutile et à peine esquissée ; planting accessoire que l’on voit venir à des kilomètres et qui aura des tournures de deus ex machina en sauvant à point nommé la peau du personnage interprété par Donald Sutherland) et se dénoue dans un twist à l’image du film : peu crédible et rocambolesque.
Non, je voudrais surtout m’attarder sur la particularité de la mise en scène de John Sturges et le casting ronflant mais raté du film.
C’est parfois dans leurs plus mauvais films qu’on reconnaît à certains réalisateurs leurs faiblesses, et par conséquent leurs atouts, quand évidemment ils ont la chance de faire partie du cercle fermé des cinéastes ayant produit au moins un bon film ou un film à succès au cours de leur carrière.
Pour situer le personnage, John Sturges, c’est un réalisateur de grands espaces. On pense plus volontiers à des westerns comme Les 7 Mercenaires, Règlement de compte à OK Corral ou Le Dernier Train de Gun Hill, mais on peut citer aussi La Grande Évasion ou Un homme est passé… John Sturges, c’est le « location guy ». Toujours en tournage en extérieurs loin des studios. Et la première qualité du bonhomme, c’est sans doute de reconnaître ses limites : s’il se retrouve à filmer des films dans les grands espaces, ce n’est peut-être pas forcément que par goût du grand air, mais aussi sans doute parce qu’il se sait limité dans les espaces réduits d’un studio. Connaître les acteurs, avoir la patience de travailler avec eux, varier la mise en place dans les petits espaces, interagir avec les accessoires, puis découper ses plans pour échapper aux champs-contrechamps, choisir les bons décors, la bonne lumière, les bons objectifs, etc., tout ça, c’est une plaie pour certains. Et l’avantage des grands espaces, parfois, c’est que le grand air, ça fait pousser des ailes à tout le monde : la lumière est bonne tant que le soleil est un tant soit peu de la partie, les décors, même factices, auront toujours la force de la nouveauté et de l’exotisme qu’un film en studio aura plus difficilement, et un acteur peut même être bien meilleur en jouant avec le soleil dans les yeux plutôt qu’un projecteur qui n’est pas censé lui poser problème (c’est la méthode « Clint de l’œil » : se mettre toujours face au soleil pour avoir quelque chose de « vrai » à exprimer, et rien d’autre). Ce n’est sans doute pas valable pour tout et j’exagère comme à mon habitude aussi (les aléas climatiques, les particularités techniques, accès difficiles et nécessité de tout prévoir, etc.), mais ce qu’on peut reconnaître en revanche, c’est que Sturges fait résolument partie de ces cinéastes plus à l’aise en extérieur.
Le problème, c’est que L’aigle s’est envolé compte un nombre non négligeable de séquences tournées en studio. Et pour ne rien arranger, elles donnent le ton au film puisqu’on commence par elles.

L’aigle s’est envolé, John Sturges 1976 The Eagle Has Landed | Associated General Films, ITC Entertainment
J’ai souvent l’occasion de le dire, pour moi, un des éléments qui fait la réussite d’une mise en scène, c’est sa contextualisation. Raconter une histoire, ce n’est pas seulement agencer des événements, c’est aussi, à travers la mise en scène, savoir la rendre au mieux au temps présent. Au théâtre d’ailleurs, on apprend aux acteurs à jouer « au présent » et à jouer « la situation ». Ce n’est pas anodin, quand on tourne une séquence, une des difficultés, c’est d’arriver à jouer sur la continuité de ce qui précède, voire initier la suite, et ça implique par exemple d’arriver à faire ressortir en permanence les enjeux de la « quête » des personnages (ce n’est pas aussi simple, un acteur mal dirigé s’éparpillera et pourrait ne pas saisir la continuité logique du récit et de l’évolution de son personnage). Mais le plus important pour parvenir à capter ce « présent », à faire ressortir la « situation », c’est de faire vivre le hors-champ. Parfois, il suffit de montrer un décor, puis de changer sa caméra de place pour que l’on garde en mémoire le « lieu » précédemment visité. Cette mémoire fabrique une image cérébrale de l’espace scénique, et notre logique construit mentalement un lien entre le champ (ce qui est dans le cadre) et le hors-champ. Difficile de restituer un tel espace scénique quand il ne préexiste pas dans un décor « naturel » et quand il faut l’inventer en studio (d’abord le composer, puis le reconstituer à l’écran au moment du tournage). C’est en ça, souvent, que des films en extérieur, même avec des reconstitutions historiques, peuvent pour certains cinéastes être plus faciles à réaliser. La contextualisation ne se borne alors qu’à changer la caméra de place, d’angle de prise de vue ou à suivre les protagonistes dans leurs diverses « locations ».
La réalisation en studio et en intérieurs (ici, c’est la même chose) demande donc des qualités particulières qui ne sont manifestement pas le fort de John Sturges, et qui expliqueraient en partie son succès… en réalisant en extérieurs la plupart de ses (meilleurs) films.
Premier problème dans ces scènes d’introduction : on ne sait pas où on est. En Allemagne, on veut bien l’admettre puisqu’on se retrouve dans des bureaux d’officiers nazis. Mais précisément où ? On ne sait pas. Quelques plans d’introduction ou de coupe dans des couloirs. Et encore… En dehors de ça : pas de fenêtres, pas de vues extérieures ni même de sons extérieurs, pas d’évocations d’événements (même anecdotiques, hors-champ, pour faire vivre ce qui devrait exister en dehors du petit monde que représentent ces bureaux). Non, rien que des acteurs rendant visite à d’autres acteurs dans des salles sans fenêtre et avec peu ou pas de va-et-vient visible parmi les figurants à l’arrière-champ (les figurants sont d’ailleurs presque inexistants tout au long du film, signe que Sturges se fout bien de rendre une réalité et d’échapper, même en extérieur, à un petit effet « boule à neige »). Des bunkers ? Même pas, puisqu’à un moment on voit ce qui ressemble à des quadrilatères de lumières projetés sur le sol depuis des fenêtres invisibles…
Autre problème : ce n’est qu’une impression, mais les objectifs utilisés (à moins que ce soit la profondeur étrange des décors) m’avaient tout l’air de ne pas être les bons. Je ne suis pas spécialiste, mais il y avait quelque chose au niveau de la profondeur de champ, et que l’on ne retrouve plus dans le reste du film (même dans des décors comme des intérieurs de maison), qui donnait une impression étrange de ne jamais être à la bonne distance.
Le son ensuite. On sait que les Américains ont une certaine aversion pour les séquences doublées (en dehors de John Sturges, ce n’est pas un film hollywoodien, mais pas sûr que cela fasse une si grande différence), et j’ai comme l’impression (là encore, cela demanderait à être confirmé) qu’une bonne partie de ces premières séquences tournées en studio ont été doublées (c’est d’ailleurs aussi le cas de certaines scènes qui viendront après, en particulier le local avec qui Donald Sutherland se bat et qui semble être un vulgaire cascadeur à qui l’on a doublé les quelques répliques). Pourquoi un tel choix ? La difficulté des prises directes se pose en général plus volontiers en extérieur… La réponse est peut-être à trouver au niveau des accents allemands que s’infligent, pour je ne sais quelle raison, tous les acteurs interprétant ces officiers nazis. Le résultat de ces imitations ridicules était soit peu probant lors du tournage et aurait nécessité un doublage, soit le choix de jouer des accents allemands pour des acteurs britanniques et américains aurait été fait après le tournage… Quelles qu’en soient les raisons, le résultat est étrange et n’aide pas à « entrer » dans le film et à rendre crédible le monde qui est censé prendre forme à l’écran.


Un problème en provoque parfois une cascade d’autres : des acteurs préoccupés par leur imitation d’accent sont certainement assez peu impliqués dans l’essentiel de leur travail, à savoir rendre la situation. C’est un tout. Quand plus rien ne marche, ça peut tout autant être les acteurs qui ne sont pas bons, les mêmes qui ne comprennent pas ce qu’on leur demande, le réalisateur qui échoue à expliquer la situation aux acteurs ou qui se montre plus préoccupé par le menu de son déjeuner que par le tournage de son film. Quant à lui, le scénariste peut imaginer de vagues « effets » à rendre dans ses répliques, mais puisqu’elles sont mal écrites, elles ne sont jamais bien rendues ni même comprises par les acteurs chargés de les interpréter… On sent bien une volonté de proposer des situations psychologiquement lourdes, tendues, avant que la seconde moitié du film tourne au film d’action, mais force est de constater que ça ne marche pas du tout.
Dans certains cas, quand on a de telles séquences qui patinent, un bon montage ou l’ajout d’une musique peuvent sauver les apparences. Impossible de savoir jusqu’à quel point le travail sur le montage a joué un rôle dans ce désastre. Pour ce qui est de la musique, elle est tout bonnement inexistante dans ces premières séquences laborieuses. On imagine l’affaire : Lalo Schifrin est mandaté pour composer la musique, il ne sait pas quoi faire avec ces séquences ratées, alors il ne s’embarrasse pas et se concentre sur les scènes suivantes en espérant que personne ne vienne lui demander de proposer quelque chose pour le début du film. C’est le dernier film de John Sturges, et le moins qu’on puisse suspecter à son égard, c’est qu’il était probablement assez peu impliqué dans son travail… (Il ne se serait pas impliqué du tout dans la postproduction d’ailleurs, ce qui doit être une manière toute personnelle d’exercer son final cut.)
Une fois ce dur passage des séquences en intérieurs passé, ce n’est pas bien mieux par la suite. On prend l’air, ça devrait être le fort de Sturges, l’aigle s’est enfin envolé, mais certains des autres défauts du film persistent. Mal écrit, mal rendu ou mal interprété, c’est selon. Quoi qu’il en soit, jamais le film ne trouve le bon rythme, avec notamment un gros souci en ce qui concerne la gestion des ambiances pendant toute la première heure du film. On sent bien une volonté dans l’écriture à proposer à la fois un thriller jouant sur le mystère et le secret (les soldats allemands se feront passer pour des soldats britanniques sur le territoire anglais) avec quelques passages humoristiques et romantiques. Et rien de tout cela ne marche. Ce n’est même pas que c’est mal rendu, le problème, c’est que ce n’est même pas rendu du tout. Ils auraient pu jouer Othello en chinois que ça aurait été du pareil au même. C’est une chose de mal diriger un film, c’en est une autre de ne même pas essayer de le réaliser. Pour ce qui est du rythme par exemple, jamais on ne sent le moindre sentiment d’urgence chez les acteurs, ou même d’excitation, de détermination ou de précaution qu’implique un tel sujet.
Une fois sorti des séquences en intérieur, l’un des gros hiatus du film se fait ressentir avec l’apparition du personnage joué par Jenny Agutter. Donald Sutherland vient en espion allemand dans une ville perdue de la côte britannique, et la première chose qu’il pense à faire, c’est venir retrouver sa copine. C’est non seulement difficile à croire, mais vu comment leurs retrouvailles sont expédiées (avec très vite des mamours clandestins sur la plage), impossible d’adhérer à une telle liaison. On voudrait presque nous faire croire que le spectateur puisse immédiatement tomber amoureux de Jenny Agutter, et c’est vrai qu’elle est jolie, on l’emploie d’ailleurs principalement pour ça (de La Randonnée à L’Âge de cristal jusqu’à Equus qui viendra tout de suite après, elles jouent surtout les utilités dénudées avec des personnages sans réelle consistance), seulement pour la voir succomber au charme de Donald Sutherland (qui est loin d’être un Casanova), il nous en faudra un peu plus… Fellini ne s’y était pas trompé en le choisissant pour incarner son Casanova dont il voulait ridiculiser l’image : Donald est gauche en matière de séduction, ce n’est pas son emploi. Et le grand Donald n’est pas beaucoup plus convaincant à la boxe d’ailleurs (il met à terre le malabar susmentionné probablement doublé en lui opposant sa technique de boxe censée être imparable alors que de toute évidence Sutherland n’a jamais donné un coup de sa vie…).


À ce stade, on pourrait se demander d’ailleurs, si en dehors même des carences coupables de Sturges, il n’y a tout bonnement pas des fautes de casting à tous les étages. Ça commençait avec l’accent ridicule d’Anthony Quayle, puis tout au long du film, confiné dans son bureau d’officier nazi, avec Donald Pleasence qui peinera toujours à nous convaincre qu’il puisse être crédible dans son rôle (sérieusement, Donald Pleasence en officier nazi, il fallait oser… sans compter qu’un premier Donald — Sutherland — nazi, c’était déjà dur à avaler, alors une deuxième, c’est loin d’être crédible).
Robert Duvall semble quant à lui complètement perdu (difficile cela dit d’être impressionné par l’autorité de Donald Pleasence, surtout quand on se rappelle l’historique du duo dans THX1138 qui les ferait plutôt passer pour des précurseurs du couple R2D2/C3PO que de hauts gradés de l’Empire). L’œil souvent fuyant pour jouer les faux pensifs, à ne pas savoir si son personnage doit être déterminé dans sa mission ou au contraire résigné, contrarié, face aux ordres et contre-ordres qu’on lui soumet… Cela dit, 1976, c’est amusant de retrouver Duvall dans le rôle d’un officier nazi, parce qu’à considérer la longueur du tournage d’Apocalypse Now, il est possible que les deux tournages se soient succédé (le film de Coppola ayant commencé en mars et celui-ci ayant été tourné durant l’été, ça laisse une possibilité que Duvall ait même commencé par le Coppola). Un simple entraînement pour Robert avant de passer à son rôle de colonel Kilgore, le plus emblématique de sa carrière. Et l’occasion pour lui, peut-être, de comprendre que la réussite d’une interprétation, ça se joue parfois à un accessoire près : le cache-œil ? Mon œil… Non, le Stetson, ça sonne mieux.
Un casting, oui, c’est savoir qui doit porter le chapeau.
Et ironiquement, peut-être la seule réussite du film, c’en est un autre qui s’y connaîtra bientôt en Stetson : Larry Hagman aka J.R Ewing ! Non pas qu’il ne s’agisse pas non plus ici d’une énième faute de casting, mais vu le marasme ambiant, on peut reconnaître au moins à Larry Hagman la capacité dans le film à nous avoir fait… sourire. Vous avez bien lu : celui qui deviendra un des acteurs les plus pète-cul de la télévision, c’est aussi le seul qui arrive à nous faire rire dans cette histoire. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement volontaire ni même assumé. Il semble pourtant évident que son personnage a été écrit… peut-être pas pour être ridicule à ce point, mais au moins pour illustrer un type de personnages militaires, fils à papa, engagés là où l’on pense qu’ils poseront le moins de problèmes (étant entendu que ces fils à papa sont soit idiots, soit incompétents). On n’est pas loin du personnage de Duvall dans Apocalypse Now, à la différence près que le sien, celui de Duvall, s’il est une caricature, en plus d’être fou, est expérimenté. L’officier qu’interprète ici Larry Hagman est fou, dispose du même entrain inconscient que son cousin surfeur et amateur de napalm, mais… est inexpérimenté et cherche une bonne occasion de se faire une réputation. Cette inconscience ne saute d’abord pas aux yeux, mais Hagman aura son petit morceau d’anthologie quand il viendra, armé de sa légendaire bonne humeur, pas encore de son Stetson mais d’un casque ridicule, tenter une négociation, seul, avec les Allemands retranchés dans une église avec des otages. Il faut le voir presser le pas et l’air décidé d’un enfant de quatre ans, le ventre déjà bien bedonnant mis en évidence par une large ceinture portée à la sergent Garcia arborant une couronne de grenades qui aurait pu tout autant lui faire l’impression de boules d’un sapin de Noël avant de se rendre compte qu’elles pouvaient tout aussi bien lui exploser sous le nez… Si le film était jusque-là passablement ronflant, on doit reconnaître à J.R le don de nous avoir réveillés.
Treat Williams ne s’en sort pas si mal non plus, et Michal Caine, bien qu’en contre-emploi, s’en tire mieux que les autres grâce à son flegme et à un regard fixe et haut, préférable à adopter quand on est un acteur perdu plutôt que les regards fuyants de Robert Duvall qui ont tout de véritables appels à l’aide. Vous voulez savoir à quoi ressemble un acteur qui attend les indications de son metteur en scène ? Regardez Robert Duvall dans L’aigle s’est envolé.
Pas franchement une grande réussite donc. Et au fond, un sujet qui n’est pas sans rappeler Went the Day Well?, tourné pendant la guerre en Angleterre par Alberto Cavalcanti. Mieux vaut préférer ce dernier.