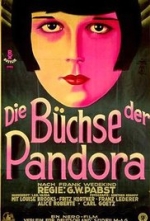Il faut le voir pour le comprendre. S’il y a des films qui influencent toute l’histoire du cinéma, vingt ou trente ans après flotte sur eux comme un nuage d’évidence, mais quand on a le nez dessus, il peut arriver qu’on ne comprenne pas tout de suite ce qui vient de se jouer sous nos yeux. Certains événements rendent tout ce qui précède illusoire et daté, mais c’est aussi ce qui se joue après qui permet de mesurer l’importance de ces événements dans l’histoire. Quand Fosbury concourt avec son saut atypique dans les années 60, tout le monde en rit, avant de le voir gagner le titre olympique à Mexico. Si aucun sauteur aujourd’hui n’oserait utiliser le saut ventral, un bon sauteur arrivera toujours à battre un mauvais sauteur en utilisant la vieille technique de papa. Le procédé, l’idée, est révolutionnaire, mais si derrière il n’y a qu’un athlète médiocre, il n’arrivera à rien. Il ne suffit pas d’être original pour prétendre révolutionner le monde. Fosbury a permis de faire progresser sa discipline de quelques centimètres qui lui ont permis avec du travail de changer complètement la technique de son sport, mais ce n’est pas la technique, seule et par son originalité, qui lui a permis de renverser les usages de sa discipline.

Flash Gordon, Mike Hodges (1980) | Starling Films, Dino De Laurentiis Company, Famous Films
George Lucas a fait la même chose avec Star Wars. Il avait compris que le public en avait assez des films sans fantaisie et qu’il serait prêt à venir en nombre pour voir de la science-fiction qui ne les prenait pas pour des imbéciles. Bien sûr, personne ne l’a pris au sérieux au début avec sa technique qui prenait tout le monde à contre-pied, et même après l’immense succès du film (encore aujourd’hui où il ne passe parfois que pour un amuseur), ceux qui riaient de lui ont tenté leur chance pensant pouvoir faire recette avec la même idée, quelques prétentions d’originalités… et rien d’autre. De la fantaisie, comme on en faisant dans les années 30 ou 40, pour un public jeune et stupide. Ceux-là n’ont pas compris la réussite (plus que le succès) de Star Wars, car comme le Fosbury, Star Wars s’était imposé certes grâce à une idée, un concept, mais le tout reposait sur une cohérence propre et solide, tout ce qu’il y avait de plus traditionnel et de conventionnel.
Si un film peut être vu comme l’alliance de plusieurs talents (devant se battre contre l’empire des studios, la facilité, le doute, la tentation du plus offrant…), la cohérence du tout, c’est la vision d’un seul homme. Il faut certes des conditions favorables, une sorte de vision personnelle, couillue et un peu chanceuse, mais ce travail-là, George Lucas était aussi capable de le fournir (et de la forcer, pour ce qui est de la chance). Son premier talent était donc de concevoir un de ces « sauts » (dans l’hyperespace), possédant assez d’innovation, d’originalité, d’audace, de folie, pour supplanter et ringardiser ceux qui l’avaient précédé, mais avec aussi assez de lucidité, de fluidité, pour « maintenir [son projet] dans un tout unique et cohérent ». Sa Force. Ce qu’on peut aujourd’hui appeler génie, c’est l’idée de s’affranchir totalement du monde dans lequel on vit. La science-fiction a rarement su aller dans ce sens, c’était plus souvent un principe laissé au merveilleux ou à la fantasy. Ce qui est une évidence pour ceux qui apprécient la saga ne l’est pas forcément pour ceux qui veulent s’en inspirer pour en récolter les fruits faciles et en reproduire le succès : pour eux Star Wars n’est qu’un vulgaire film de science-fiction, pour les autres, c’est autre chose. En 1968, le saut arrière était ridicule, laid. Et puis au fil des perfectionnements, il est devenu plus gracieux en même temps qu’il restait efficace. Ceux qui l’imitaient dans leur jardin s’y cassaient sans doute plus le cou que ceux qui reproduisaient sans génie mais sans risque le saut ventral…
L’un des choix les plus payants, et « non-originaux » pour Lucas, a été celui de faire appel à John Williams. Peut-être le plus important. Parce que c’était ce qui donnait le plus la couleur à son histoire, lui donnait une stature épique, monumentale, et non quelque chose de bricolée, de faussement moderne. Le film classique capable d’employer une musique rock, avec une partition chantée, n’a pas encore été fait. Il y a des domaines où il vaut mieux se fondre dans la tradition, plutôt que chercher par tous les moyens à paraître innovant et moderne. Il ne serait pas venu à l’idée de Fosbury d’entamer sa course d’élan sur les mains sous prétexte que ça ne s’était jamais fait (la comparaison commence à rancir, mais j’en garde sous l’aisselle). Ceux qui ne le croyaient pas capables de gagner une médaille auraient sans doute apprécié le spectacle.

Oups. La Guerre des étoiles, George Lucas (1977) | Lucasfilm, Twentieth Century Fox
Voilà donc ce qui ferait entrer Flash Gordon plutôt dans le panthéon du cirque cinématographique que dans celui de l’histoire du cinéma. Le film, s’il restera en mémoire, le sera surtout pour être un bedonnant et bidonnant ratage. Flash Gordon demeure le même héros insipide qu’il soit des années 80 ou des années 40. On ne change pas de la merde en or. Et on n’emploie pas un groupe de musique, tout génial soit-il par ailleurs, pour composer la musique d’un film. Il n’y a que les cons qui osent, audiardit-on ; et les futés font semblant d’avoir de l’audace. Quand ils en ont, il n’est question que deux ou trois idées sur lesquelles repose le « saut » tout entier.
Flash Gordon est un éclair dans le ciel qui jaillit comme un pet ridicule. Star Wars est au firmament des étoiles, au-delà des lumières de la voie lactée, dans un espace qui n’est plus qu’évidence et magie. Comme tout le monde dans les années 80, Flash Gordon ne faisait que jouer avec les figurines créées par Lucas. Mais Lucas, lui, avait comme inventé une matière impalpable, invisible de tous, incompréhensible, et pourtant, aujourd’hui, chacun peut encore en sentir et en voir les effets. Une religion presque, comme le souligne Coppola, sincèrement dépité de voir le public se tourner vers une histoire qu’il juge un peu niaise ; il n’avait pas compris ce que Star Wars allait changer.
N’évoquez donc plus le mystère de la matière noire, car pour le prophète elle a un autre nom : le côté obscur. Une force qu’aucune lumière, aucun éclair, ne saurait apprivoiser. Surtout pas celle de Flash. Star Wars reste Star Wars, Flash, un nobody ventripotent exhibé dans les cirques. L’un était né déjà tout rabougri ; l’autre avait été conçu comme un miracle, un événement qui ne cesserait alors de se réinventer à travers les yeux et l’imagination des générations amenées à le prendre comme référence.
C’est souvent après que l’on comprend. Lucas nous a retournés comme des crêpes, et depuis, notre suspension n’a jamais cessé.

Flash, je suis… ton…

 Année : 1968
Année : 1968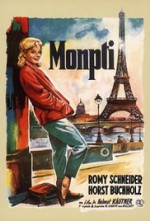
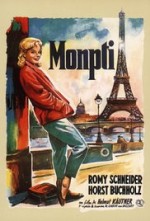 Année : 1957
Année : 1957
 Année : 1940
Année : 1940
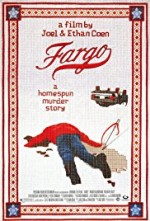


 Année : 1994
Année : 1994


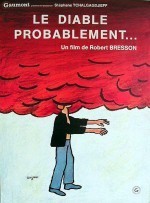
 Année : 1977
Année : 1977
 Année : 1959
Année : 1959


 Année : 1953
Année : 1953