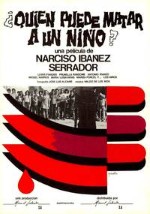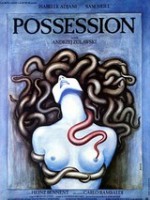Notes pour un septième voyage.
Toujours sympathique les relectures de chefs-d’œuvre, surtout sur grand écran. Amusant aussi de voir qu’à la Cinémathèque on tient tant à parler d’interprétation à travers le biais de la psychanalyse. Ne peut-on pas parler d’interprétation, de symboles, de références, sans ramener ça systématiquement à une escroquerie vieille d’un siècle ? Toutes les interprétations sont possibles, il n’existe aucune science pour en légitimer une plus qu’une autre. La mienne, j’essaie de la faire à travers un autre prisme : je préfère essayer de comprendre la force, la justesse, la puissance évocatrice de ce film, de ce qu’il éveille en une grande majorité de spectateurs, grâce à des mythes plus anciens, à des thèmes qui pourraient avoir tout de… psychanalytiques mais qui ne le sont pas.
Bref. Quelle (nouvelle) lecture après cet énième visionnage ? Eh bien, comme l’impression que Alien, c’est le mythe d’une petite fille défiant la volonté toute puissante de ses parents souverains. C’est une petite fille refusant l’ambition surhumaine de cette même autorité. Après la « mort de Dieu », et son absence dans le grand cosmos, que reste-t-il aux souverains cherchant à établir une lignée d’hommes en perpétuelle recherche de la mutation nouvelle qui leur assurera la « vie » éternelle, et maintiendra l’espèce entière au sommet de la constellation des vivants ? Eh bien, l’expérimentation médicale, génétique, voire eugénique. On en est encore à rabâcher le premier mythe de la science-fiction, Frankenstein. Mais ce n’est pas la mariée de Frankenstein, à laquelle on a affaire ici, c’est sa fille. Et si ce n’est pas le Minotaure, c’est Ariane qui finit par tirer son épingle du jeu.

Qui est Maman du Nostromo ? C’est la femme du pharaon, la grande prêtresse, chargée de faire appliquer les désirs de son défunt mari. Le Nostromo, c’est la pyramide (ou le labyrinthe) dans lequel le souverain une fois mort veut voir ses parents (femme, concubines, fils et filles) réunis pour une dernière procession en son honneur, un sacrifice, une opération, une mutation, une copulation, une alliance (comme celle ayant fait naître le Minotaure) censés à la fois lui permettre de gagner la vie éternelle via la « recherche militaire » et l’établissement d’un sanctuaire inviolable, mais aussi assurer la survie de l’espèce, mutée, grâce à l’apport de cet agent… étranger. L’alien. L’idée ici, c’est comme dans tous les sacrifices, de faire en sorte que les parents ignorent tout de desseins du souverain. Seuls la grande prêtresse (Maman) et un prêtre serviteur (Ash) sont au courant pour mettre en œuvre cette union sacrée capable d’engendrer un monstre, puis le sacrifice des frères et sœurs ayant eux-mêmes, dans une sorte d’inceste si familier des souverains antiques, donné naissance à cette créature d’un nouveau genre, à la fois alien et humaine, donc, demi-dieu, donc légitime à régner encore parmi les hommes.
Ripley, c’est donc Ariane et Thésée à la fois. Mais aussi un peu Alice qui découvre le monde souterrain des adultes dans le terrier. Son but est de s’échapper de la pyramide où doit s’opérer la mutation, une fois qu’elle aura compris son rôle dans cette machination. L’un après l’autre, l’agent étranger est uni à ses frères et sœurs, elle sera la dernière. Mais Ariane se rebelle (les mythes ne sont jamais allés que contre l’ordre établi). Et tandis que tous les autres échouent, elle parvient à se démêler des entrailles de la pyramide et immole dans le feu le fruit monstrueux des ambitions de son père. Ripley, c’est l’homme, ou la femme, qui se reproduit à l’identique. Sans mutation. Une reine, mais une reine humaine, à hauteur d’homme. C’est nous. C’est aussi, comme dans toute bonne histoire, le retour à la normale, mais non pas un retour à la tyrannie d’une seule volonté, le retour à une forme d’état apaisé, loin des forces gravitationnelles, coercitives, de la société. Ripley, c’est encore la révolution contre l’oppresseur et le diktat d’un seul homme. Ni dieu, ni père. Ripley, toujours, c’est nous. L’humanité au temps présent, héritière d’une longue lignée de survivants après des millions d’années d’évolution. C’est celle qui n’a pas encore enclenché, ou forcé, la prochaine mutation. L’humanité à un temps t, l’humanité en mode pause et qui se révolte encore face aux mutations inutiles. Ripley, c’est encore, Alice, la princesse fourmi encore vierge ayant réussi à s’échapper du terrier et s’envolant pour fonder une nouvelle colonisation… à moins de retourner chez elle, portant en elle l’échec de sa mutation, ayant refusé le mariage, une grossesse non désirée sinon par « l’autorité souveraine »… Rattrapée par la société de son père, offerte à nouveau à son emprise, le vol de la révolution ne dure toujours qu’un temps. L’appel à la mutation est toujours plus fort, car cette force souveraine, c’est celle de notre survie. L’alien, c’est d’abord cet adulte, ces parents, qui volent à l’enfant son innocence en lui privant de sa condition d’individu, pour lui rappeler à ses obligations dans la grande lignée des vivants et des souverains : vivre, c’est s’accoupler avec l’étranger, pour mettre au monde des monstres. La jeune reine peut s’effaroucher, mais si à la fin du premier acte, elle fait la nique à cet étranger qui voulait l’engrosser d’un monstre, elle y passera pour de bon à la fin de la prochaine bobine.

Fini les interpénétrations.
Petite subtilité de mise en scène découverte lors de cette révision. Ridley Scott nous annonce à un moment qui des 7 passagers survivra. Quand les trois explorent le vaisseau spatial extraterrestre émettant ses signaux d’avertissement, la séquence se termine par un gros plan du pilote fossilisé. On ne distingue pas grand-chose de lui, mais par un léger fondu, le montage suggère que Ripley se trouvera à son tour dans cette position, puisque le plan suivant, c’est elle, qui apparaît, pratiquement dans la même configuration. Et en effet, le film se terminera sur un gros plan tout à fait identique… Subtile le Ridley. (Quand a-t-il cessé de l’être ?)
Dernière remarque concernant l’emploi du suspense. Plus qu’un film d’horreur, c’est sans doute plus un thriller usant parfaitement des codes du suspense, au sens presque littéral. On sait que Hitchcock opposait les séquences tournées vers un principe de suspense et celles vers un principe de surprise. L’un des avantages du suspense, c’est qu’il permet de revivre (Replay) le même plaisir à chacun des nouveaux visionnages. Les surprises, les twists, ne marchent qu’une fois, et paradoxalement, si on y prend un plaisir lors d’un second personnage, c’est bien parce qu’on connaîtra ce qui suit et au lieu d’être surpris, on sera tendu dans l’attente de ce qu’on sait déjà de ce qui vient. Le suspense permet d’instaurer une ambiance tendue tout en connaissant la suite. La plupart des scènes du film jouent sur cette attente. À une exception peut-être : quand Ripley amorce la destruction du vaisseau, qu’elle revient vers la navette et y rencontre la bête, c’est une surprise. Même si, c’est une rencontre forcément attendue, quand Ripley décide de rebrousser chemin pour annuler le processus de destruction, c’est un retour en arrière jamais très bon dans une histoire. Alors que ça devrait être une période de tension maximale, à la revoyure, la séquence perd de son intérêt parce qu’on sait la première fois qu’elle y rencontrera la bête et retournera à la passerelle de commandement. Au contraire, par exemple dans la scène du repas, à la première vision, on pourrait être surpris bien sûr, mais en fait toute la séquence joue sur le même principe de suspense : la tension est redescendue, il ne se passe rien, et ce calme suspect doit éveiller une tension chez le spectateur qui comprend à ce moment que quelque chose va se passer, sinon la séquence n’aurait aucun intérêt. La surprise de la « naissance thoracique » n’est alors que l’achèvement de ce qu’on sait déjà, et il faut même noter le côté amusant de la séquence lors d’un nouveau visionnage, parce que la sidération des personnages à ce moment n’est plus le nôtre, on adopte presque à cet instant le point de vue du monstre, et on rit avec lui quand il glisse sur la table et s’enfuit. Il n’y a pas, ou plus, de surprise ; on jouit d’un plaisir sadique, enfantin même, comme quand une de nos blagues stupides a réussi son coup (boule puante, bombe à eau, coussin péteur…). Dans l’autre scène clé du film, le viol raté de la fin, on a encore affaire à une fausse « surprise ». À nouveau, si on s’éternise, c’est bien qu’il va se passer quelque chose, et on se doute d’autant plus qu’il se passera quelque chose, qu’on ne peut pas, nous spectateurs, nous enfuir ainsi sans avoir vu l’alien mourir dans l’explosion du Nostromo. On voit d’ailleurs la créature avant Ripley, et sa présence n’est une surprise que pour elle ; à nouveau, on prend ses distances avec le point de vue de la victime, et on gagne un peu à nous identifier à l’alien. Notre plaisir de spectateur est toujours un plaisir sadique, pas du tout lié à un enchaînement d’événements et de situations (donc à leur surprise relative) ; rarement, sinon dans des films d’horreur (et même dans Frankenstein — rappelons-nous de la scène avec la gamine et de la créature au bord de l’eau), on verra un film proposer de se mettre à la place d’un tel monstre (et dans les films suivant l’alien redevient un monstre à abattre). Le suspense marche à plein parce qu’on a aucun doute que dans ce duel final, la femme finira par l’emporter sur le monstre, mais si la situation marche autant, c’est bien que finalement on arrive à s’identifier un peu à un monstre sur lequel on sait finalement peu de choses. Ridley Scott évite ainsi une séquence d’action superflue et se concentre toujours sur la tension, l’attente et la peur de ce qui vient, l’idée de tâtonnement, d’embuscade. On comprend dès qu’elle enfile la combinaison que sa volonté est de le jeter dans le vide, toujours, aucune surprise, aucune lutte, ou improvisation. À la revoyure, c’est bon comme pour la première fois.
Vu le : 9 mars 1995 (A) + 6 autres fois
Revu le 28 septembre 2016 (tek)