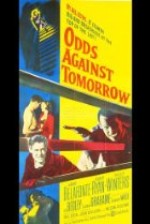Pixote – La Loi du plus faible
Titre original : Pixote: A Lei do Mais Fraco
Année : 1980
Réalisation : Héctor Babenco
Avec : Fernando Ramos da Silva, Jorge Julião, Gilberto Moura, Marília Pêra
Dans le genre chronique de l’adolescence et de la misère, le film coche pas mal de cases. De Los olvidados à La Petite Marchande de roses, en passant par le tout récent film vu Les Enfants de la crise, le sujet de l’enfance martyrisée laisse rarement indifférent.
Le jeu des acteurs fluctue au gré des séquences : les adultes (en particulier la prostituée) s’en sortent généralement mieux que les enfants (Babenco n’emploie pas, ou peu, l’improvisation, et les enfants jongleront souvent maladroitement avec des mots qui ne sont pas les leurs). Mais l’inconfort généré à l’oreille par un texte appris par cœur disparaît, rapidement gommé par la principale qualité du film : sa densité.
Une séquence vaut une nouvelle situation. L’ellipse permet d’avancer par sauts successifs sans avoir à tout expliquer. Et le tout est vite expédié. On comprend vaguement quelques enjeux liés aux conditions d’incarcération de la bande de jeunes. Les conséquences hors champ, les manipulations, la corruption de l’administration et de la police, tout ça jaillit d’un coup dans la vie de ces délinquants après souvent s’être manifesté dans l’ombre. Le premier d’entre eux (le plus jeune, celui qui donne le titre au film) s’impose au centre du récit plus parce qu’il est témoin et acteur malgré lui d’événements qui lui échappent, et avant de finir comme le dernier survivant d’une succession de tragédies.
Si le récit se fait d’abord purement descriptif et ne s’attarde pas sur les diverses étapes expliquant les conflits, c’est que le plus important est ailleurs : la trajectoire chaotique et criminelle que vont emprunter ces survivants d’une « maison de correction » violente et corrompue va poser les bases d’une morale radicale antiautoritaire. Loin d’être aidés dans ce centre, les jeunes délinquants doivent se serrer les coudes pour survivre ou au contraire se défendre face à des agressions pouvant jaillir à n’importe quel moment et de la part de n’importe qui (surtout les autorités pénitentiaires ou policières).

C’est alors tout naturellement qu’une poignée d’entre eux finit par se faire la malle et par n’avoir d’autre choix, d’autres perspectives, d’autres repères, que le crime pour survivre. Si le titre de film se focalise sur un seul de ces paumés, c’est que le film ne se contente pas d’être un film sur la misère et sur l’adolescence : le film à élimination sert à traduire la brutalité et l’urgence de vivre (jusqu’à l’absurde, ce qui pousse le groupe à adopter des comportements de desperado comme lorsqu’ils s’unissent avec une prostituée pour agresser, chez elle, ses clients) qui est le quotidien de ces jeunes en fuite.
Ni misérabilisme ni sensationnalisme. Le format de la chronique autorise donc une distance capable d’imposer au spectateur une morale largement politique (voire critique envers la société décrite) : comment la société (et un tribunal) jugerait-elle Pixote dans la vraie vie ? Certainement pas comme nous le jugeons. Situation après situation, le spectateur doit admettre qu’au-delà de l’excuse de minorité, le garçon est la victime d’un environnement dans lequel la société toute entière est pointée du doigt (et cela, quels que soient ses crimes).
La mise en situation d’événements tragiques au cinéma, une nouvelle fois, donne des outils à la société pour mieux comprendre les enjeux impliquant toutes ces formes de violence liées à la pauvreté : les individus, avec leur libre arbitre, sont peu de choses face aux forces destructrices qui agitent toute une société, tout un environnement. Ces violences sont directement générées par la misère souvent organisée par la corruption et l’appropriation des richesses d’une partie de la société au détriment d’une autre. Ce sont nos sociétés qui mériteraient d’être mises au banc des accusés, non ces tristes misérables qui en sont souvent à la fois les seuls coupables désignés et les premières victimes. La société qu’ils n’ont pas créée est une jungle dans laquelle ils n’occupent que le bas de la chaîne alimentaire. Ils sont les derniers servis dans le clan.
Le film est une mise en garde contre toute forme d’autoritarisme. Au début des années 80, le Brésil était en pleine dictature, et c’est presque étonnant que le film ait pu s’y faire tant la morale ne souffre d’aucune ambigüité. La leçon s’applique à toutes les époques et à tous les types de sociétés tentées par le mirage des autoritarismes… Les violences de la base sont le fruit de violences institutionnelles. Qui est responsable de ces violences institutionnelles ? Les élites. Celles que l’on ne voit pas dans le film, mais que l’on imagine hors champ.
Pixote – La Loi du plus faible, Héctor Babenco (1980), Pixote: A Lei do Mais Fraco | HB Filmes, Embrafilme
Sur La Saveur des goûts amers :
Listes sur IMDb :
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci (Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel