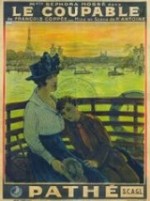Carlito ne chômait pas pour ses premiers longs métrages… À peine un mois après sa comédie des apparences tournée pour la Svensk Filmindustri, La Quatrième Alliance de Dame Marguerite, sort cette fresque grandiose produite par la Nordisk Film, probable toutefois que le tournage de Pages arrachées au livre de Satan ait commencé avant.
Ce qui frappe d’abord dans ce premier chef-d’œuvre de Dreyer, c’est sa modernité. Le terme est souvent employé quand il est question de noter les qualités intemporelles voire les supposées avancées techniques d’un film, mais puisqu’il est rarement utilisé pour le cinéaste danois (plus volontiers qualifié d’austère), ça ne me semble ici pas inutile de le préciser.
Le défaut majeur de son premier film, Le Président, était l’intérêt assez mal dissimulé que le cinéaste avait porté au procédé du flash-back au point d’en oublier le travail auprès des acteurs, leur laisser trop peu d’aisance pour s’exprimer, et le résultat en était un manque évident d’identification, de passion, d’émotion, d’implication du spectateur dans une histoire qui en plus d’être alambiquée proposait donc trop peu de matière pour s’émouvoir ou simplement s’intéresser. Carl Th. Dreyer identifie sans doute le problème et rectifie son approche pour ces Pages arrachées au livre de Satan.
S’il garde et améliore ce qui faisait la qualité du Président (essentiellement son travail sur le montage), il prête ici une application toute particulière aux acteurs, donc aux personnages, et ce malgré, encore, un procédé narratif un peu lourd déjà employé par Griffith pour Intolérance (le montage parallèle de plusieurs histoires jamais destinées à se rencontrer au presque). Le résultat est particulièrement efficace. Étrangement, si Dreyer laisse plus de temps à ses acteurs pour s’exprimer, il emploie aussi une méthode ou des effets qu’il utilisera avec insistance dans La Passion de Jeanne d’arc jusqu’à en faire pendant longtemps la « marque » Dreyer, autrement dit les très gros plans de visages extatiques, surexposés à la lumière, avec des acteurs faisant rouler les nuages (ou les auréoles) avec leurs yeux au-dessus de leur tête. La copie restaurée étant magnifique à la Cinémathèque (et étant situé très près au second rang), ces gros plans, avec tous leurs détails, leur netteté, ça fait quelque chose…

Gros plan de Clara Wieth (Siri) lors de son « sacrifice ».
En dehors de ces gros plans (d’ailleurs utilisés sans systématisme, mais bien toujours à bon escient, c’est presque là le génie), le film regorge d’éléments « modernes » qui poussent presque à la sidération tant le niveau de maîtrise du Danois est grand. Je reviens au montage, parce que s’il est déjà remarquable dans Le Président ou plus tard (surtout à la fin) dans Les Fiancés de Glomdal, ici, c’est du pur génie. Qu’on prête à Griffith une importance historique dans l’histoire du cinéma (et encore, il n’aura su que réemployer ou comprendre l’astuce et le potentiel de procédés imaginés par certains fantaisistes britanniques), il faut tout de même avouer que c’est un piètre metteur en scène (quoique, certains films d’après-guerre sont remarquables). Je ne ferai pas de comparaison avec Intolérance, car le Dreyer, contrairement à ce qui est parfois relevé, ne s’inspirerait pas du film, car les deux s’inspireraient en fait d’un film italien de Luigi Maggi de 1912 basé sur le même principe (Satan, montage parallèle) : Satan contre le créateur et le diable vert. On peut seulement s’appliquer à différencier Griffith et Dreyer sur un seul point : le talent. Parce que si le premier a toujours employé le même principe (et à une époque avec beaucoup de succès, comme on imagine celui qu’a pu avoir le premier singe qui s’est relevé dans la savane pour offrir au vent et aux regards de ses contemporains ses parties génitales), le second lui ne s’en est jamais servi, au milieu d’autres procédés, que pour servir le récit, et saura par conséquent s’en passer si besoin (comme le montrera la suite, au point qu’on rapprochera plus du tout Dreyer au montage alterné, et pourtant…).
Ce qu’arrive à faire Dreyer ici sur cette seule question du montage alterné est tout à fait prodigieux. Il n’invente rien, les inventeurs ne sont pas toujours les plus habiles pour manier les techniques qu’ils mettent au jour : le slapstick, le western, le thriller, le péplum (un peu), la comédie allemande, tous ces genres utilisent déjà très bien le procédé. Et pendant les trois premières histoires, Dreyer se contente (on pourrait presque dire) de montrer qu’il sait alterner d’un espace, d’un sujet, à un autre, pour donner du rythme au récit, contextualiser au mieux les personnages dans un espace plus ou moins lâche et dans une simultanéité reconstruite, ou induite (le principe du « pendant ce temps », c’est faire comprendre au spectateur que des événements sont simultanés ou quasi simultanés alors qu’on ne peut pas, à moins d’utiliser des procédés lourds comme le split screen, ou retourner au théâtre où c’est possible, montrer deux sujets en même temps). Là où ça devient de l’excellence, à la dernière histoire (il réserve le meilleur pour la fin), c’est quand Dreyer multiplie les sujets, les actions simultanées, pour augmenter la tension et le plaisir du spectateur. Là encore, il ne doit pas être le premier (je me rappelle vaguement que d’autres — mais c’est peut-être après — jouaient déjà à augmenter les actions comme on ajoute des instruments d’un orchestre de chambre pour finir par jouer une symphonie), mais ce qui impressionne, c’est l’exécution, la maîtrise, l’efficacité. Il prend son temps à décrire différents personnages qui seront amenés à intervenir à l’apogée de son film, à son dénouement, il noue, il construit, et tout d’un coup, les personnages se retrouvent ou presque (ici, il reprend les possibilités dramatiques qu’offre le télégraphe, et donc s’inspire ouvertement de Griffith) au même endroit ou au même moment pour dénouer tout ça. C’est beau comme la fin du Retour du Jedi (si, si).
On est donc complètement à ce moment dans le cinéma spectacle, le film d’action, avec lui, Dreyer, le supposé cinéaste de l’austérité ; et on a bel et bien quitté la fresque historique, le pompeux pour l’épique moderne, même si on peut aujourd’hui s’étonner d’y lire un panneau évoquer la contemporanéité des révoltes rouges (on est en 1920 et le scénario aurait été entamé pendant la guerre, et contemporain donc de la révolution russe).

Reconstitution d’une rue sous la révolution française (troisième épisode)
Autre point fascinant dans la maîtrise dont fait preuve Dreyer, c’est la méticulosité apportée aux détails de décors et de costumes. Loin sans doute de disposer des moyens américains ou italiens, Dreyer propose des reconstitutions non pas basées sur le grandiose, mais sur le détail. Pas de plans de foule, pas de décors monumentaux, l’accent est porté au foisonnement de détails souvent significatifs (pas forcément historiquement véridiques, mais qui saura ?). Après tout, qu’on dispose d’un décor immense ou d’une petite table pour disposer des objets, la taille de l’écran est la même… L’idée est de remplir au mieux cet espace qui est le même en principe pour tout le monde, pour tous les films… Le film ne manque pas pour autant de plans d’extérieurs, au contraire, mais l’astuce encore, est de ne pas tomber dans le piège du carton-pâte. Dreyer, son credo, c’est la vie, non le bigger than life. Et pour représenter la vie, on essaie de lui être fidèle, on essaie de reconstruire un espace cohérent, pratique, vrai, usé et aux proportions justes. On soigne encore une fois les détails, comme l’herbe entre les pavés (les rues pavées dans le film sont peut-être des quartiers non reconstitués, mais pour le coup, c’est une question de choix, de repérage, et de cohérence d’ensemble), comme la cire éparse coulée d’une bougie sur une table où repose encore une « foule » de petits détails significatifs, comme les pipes fumées ici ou là et en particulier dans une auberge où on sert encore sur une barrique une liqueur servie avec une bouteille au goulot tordue… Le choix des ustensiles vaut le détour. Les costumes n’ont rien de costumes de théâtre, chacun porte des particularités qui font penser immédiatement qu’ils ont servi et habillé plus d’une journée leur propriétaire. Les acteurs d’ailleurs, s’ils usent parfois de toute la gamme pantomimique de l’époque sont toujours employés dans des emplois qui leur conviennent. Ainsi pourrait-on presque voir les mains calleuses des gens du peuple, mais n’avoir aussi aucun doute quant à la « noblesse » des personnages de l’aristocratie. Histoire de maintien, d’abord, certaines femmes savaient encore se tenir, et leur corps était forgé par les corsets. Le casting a fait fort, tous ont une autorité propre (l’actrice interprétant Marie-Antoinette par exemple est très convaincante, avec un vrai visage de femme du monde, c’est-à-dire, plus distingué que réellement joli) et l’une d’entre elles, Jeanne de Tramcourt, était même la compagne du prince de Suède. Stanley Kubrick en serait presque jaloux à voir autant de soin porté aux détails…

Kubrick, parlons-en. Parce que si à la même époque, Abel Gance me fait furieusement penser à Coppola, Dreyer, par certains aspects, rappelle Kubrick. Quelques mouvements de caméra latéraux ou dans la profondeur pour découvrir un décor (passant d’une inscription révolutionnaire sur un mur pour s’approcher vers une porte et laisser apparaître au loin l’animation d’une auberge), décrire une situation, présenter un personnage (la femme de l’opérateur télégraphique finlandais, prise d’abord en gros plan, et la caméra s’éloignant prenant peu à peu de la distance et la regardant évoluer dans la cuisine). Mais le plus évident, c’est le choix d’une grande profondeur de champ. Quand on sait composer l’espace, le remplir de détails, bouger et couper au bon moment, ralentir aussi l’action pour offrir au regard un véritable tableau animé (Dreyer pourtant semblera dire que cet aspect du film ne le satisfaisait pas), ces deux-là, parce qu’ils savent cadrer et saisir le monde comme personne, arrivent à nous proposer quelques « compositions » sidérantes ; non par leur démesure, mais par le soin encore apporté à chaque détail comme si tous les éléments de décors trouvaient leur place à l’écran, proposant une curieuse harmonie qu’on y montre le désordre ou l’ordre des choses. La lumière, autre aspect que partagent les deux cinéastes : les ombres y sont rares, et on privilégie au contraire la surexposition (préférable quand on cherche la profondeur de champ sans doute) presque systématique (plutôt étonnant pour un film mettant en scène Satan, comme peut l’être le choix de la luminosité dans un film d’horreur).

Naimi, avant de rejoindre l’armée finlandaise (façon princesse Leïa)
Voilà pour la maîtrise formelle. Un dernier mot sur l’histoire, parce que si aucune des quatre ne transcende réellement son sujet, l’idée de départ est plutôt osée, au point que l’église a crié au blasphème (représentation du Christ, manigances plutôt détestables de Dieu envers Satan, l’Inquisition…). C’est plutôt amusant, et ça va encore et toujours contre l’idée d’un cinéaste (Ordet et La Passion de Jeanne d’arc obligent) dévotieux. Autre blasphème, les révolutionnaires, qu’ils soient français ou rouges, sont dépeints comme des personnages antipathiques, voire malfaisants. Dreyer, le réactionnaire du centre. Ni Dieu, ni maître.
Dommage d’en rester toujours aux mêmes œuvres quand il est question de Dreyer. Comme souvent quand on creuse, on se rend compte qu’on se limite qu’à ce qui ressort de plus évident, de plus récent, ou de plus commenté. En plein âge d’or du cinéma scandinave (entre 1913 et 1924 selon certaines sources), c’est bien vilain de passer à côté de toutes ces perles. La cinémathèque proposera en été 2017 une rétrospective Mauritz Stiller[1][2] ; l’occasion donc de voir certains de ces procédés si bien maîtrisés par Dreyer, voire d’autres tout aussi efficace, ou oubliés… employés lors de cette période si cruciale dans l’établissement d’une grammaire cinématographique.
J’en ai fini avec Carlito.
SLUT
[1] rétrospective Mauritz Stiller à la Cinémathèque française (juin-juillet 2017) ; article de Blandine Étienne sur le cinéaste.
[2] films commentés de Mauritz Stiller



















 Année : 1917
Année : 1917
 Année : 1924
Année : 1924



 Année : 1929
Année : 1929