Voilà le film jusqu’à maintenant le plus intéressant de cette rétrospective soviétique. Par certains côtés, l’histoire de départ rappelle celle du Village du péché tourné l’année précédente et où apparaissait déjà Emma Tsessarskaïa, à savoir une femme de la campagne qui se marie avec un homme qui fichera vite le camp et qui se liera (elle) pendant l’absence de son mari avec un autre homme. Si le précédent film traitait du thème de l’inceste, dans mon souvenir, ici on est plus dans l’adultère. La plus vieille histoire du monde : celui qui part à la chasse perd sa place. D’ailleurs, on pourrait également faire le rapprochement avec un film tourné trente ans après, Le Passage du Rhin où un prisonnier français s’amourachait d’une jeune Allemande : notre belle ici se lie avec un prisonnier autrichien.
Le film est tout acquis à la cause de la paysanne, ça n’étonnera personne, mais peut-être un peu plus de son amant. L’amour bourgeois serait presque considéré comme contre-révolutionnaire tandis que l’adultère, en voilà une valeur d’avenir sur laquelle le communisme pourrait s’appuyer (!). C’est que l’amant, bien qu’étranger, est un grand gaillard qui amasse une somme de travail importante aux champs et finira par rejoindre les rouges. « Dis, tu as entendu parler de Lénine ? C’est un homme juste. » Et puisque l’amant se laisse convaincre par la cause communiste (c’est un bon garçon), notre paysanne (bientôt maman d’un petit autrichien) rejoindra les mêmes forces révolutionnaires. Quant au mari absent, lui, s’était écrit, s’embrigadera chez les blancs (méchant garçon).
Rien d’exceptionnel dans cette histoire, elle a au moins le mérite d’être assez simple, voire archétypale. On est en 1929 et le cinéma muet un peu partout dans le monde a atteint un niveau d’expression qu’il ne retrouvera jamais, et pour cause. La manière dont Chtrijak (ou son directeur photo, ou son monteur, ou tout ce petit monde à la fois) arrive à rendre au mieux cette histoire est tout bonnement exceptionnelle. Oublié le grotesque et l’insignifiance du montage des extractions, il en reste une influence, plus gancienne presque, basée sur l’efficacité d’un montage, certes parfois sensoriel ou excessif, mais surtout concis, rapide. Et la concision au cinéma comme dans tout art narratif, c’est la possibilité de viser l’efficacité et de raconter beaucoup avec peu d’éléments. Jusque-là rien de bien innovateur, sauf que le talent du découpage de Chtrijak, c’est que si la concision bien souvent sert à accélérer le rythme et à donner profusion d’éléments s’additionnant les uns aux autres dans une visée strictement quantitative du récit (on parlera alors de densité), lui fait ici tout le contraire, autrement dit, son découpage sert à ralentir l’action, la tendre, parfois la répéter en en variant légèrement la forme, un peu comme en musique avec ses motifs répétitifs. Pour faire simple, le cinéaste qui viendra bien après et qui est connu pour ralentir l’action, c’est Sergio Leone. Mais il y a d’autres exemples, moins évidents, où des cinéastes, peut-être poussés par les indications scénaristiques, se sont essayés au ralentissement de l’action tout en adoptant un montage rapide. On est en Union soviétique, et l’image qui vient immédiatement en tête, c’est celle du départ de Jivago laissant sa Lara seule dans sa datcha (le ralentissement léger de l’action serait plutôt un procédé du classicisme, alors que l’accélération artificielle, on peut l’imaginer, aurait un côté peu noble employé dans des films usant d’effets faciles et sensationnels). La scène n’est pas forcément très ralentie, mais Lean prolonge la scène, insiste sur le drame d’une telle séparation en prenant son temps tout en offrant assez de matière au montage pour les yeux du spectateur, au point que la forme illustre au mieux le fond puisqu’elle prend son temps pour une scène importante dans le récit. On a exactement la même scène ici, et Chtrijak prolonge bien plus la séquence, la ralentit pour en faire un épisode tragique majeur de son film. Il y a un petit côté wagnérien dans la forme, on pense que ça va se terminer, et hop, la musique repart avec le même motif un peu différemment, pour répéter une émotion et bien insister, et tout cela n’en finit pas, et on prend plaisir à suivre ainsi la douleur de nos héros décomposée en petites rondelles temporelles. L’effet recherché est évident, quand on parle de tendre l’action, viser une certaine forme de suspense (non pas lié à la peur sur quoi Hitchcock plus tard s’appuiera essentiellement, mais ici sur la compassion, le déchirement de la séparation, la pitié aristotélicienne…), c’est pour émouvoir le spectateur, surligner les passages du récit qui font appel au pathos.
Pour ralentir l’action toujours, Chtrijak ira jusqu’à utiliser des ralentis sur les pattes de chevaux au galop, et qui montés avec d’autres actions produira un effet émotionnel immédiat et efficace sur toute une bonne partie de la séquence.

Les gros plans, là encore, feraient presque plus penser à du Sergio Leone qu’à du Eisenstein. Il y a toujours chez Eisenstein une volonté de tirer ses portraits vers le grotesque (principe du montage des “attractions”), voire des images statiques de personnages qui exultent ou qui sont parfois étrangers à l’action principale. Chez Leone comme ici chez Chtrijak, ces gros plans servent d’abord les personnages centraux, si les images peuvent être figées c’est qu’elles répondent plus à une sidération ou à une quelconque émotion du personnage « en attente » souvent d’une action ou d’une réaction placée hors champ, et si on peut suspecter Leone de tirer parfois vers le grotesque, ce sont des visages impassibles, tandis que chez Chtrijak, c’est surtout plus pour montrer les tourments d’un personnage principal, comme pour nous inciter à compatir avec lui et nous aider à percer ce qu’il ressent. Alors le “grotesque” ou l’excentrique ne sont pas totalement absents du montage, mais cet aspect est plus laissé aux plans sur les villageois ou sur le mari pour renforcer l’antipathie qu’on éprouve pour lui. D’ailleurs, au retour de ce mari encombrant, Chtrijak, choisira la meilleure manière pour nous en faire une figure négative : contre-plongée alors qu’il reste perché sur son cheval et toise les villageois de sa détestable hauteur blanche…
On trouve également quelques mouvements d’appareil efficaces : timides travellings arrière à la Kubrick (sur un personnage regardant face à lui) comme pour rester sur une émotion, de face, et forcer la mise à distance en changeant ostensiblement la valeur du plan ; ou des travellings d’accompagnements dont un magnifique, en gros plan et de côté, avec le sujet qui marche devant des villageois qui eux restent statiques en arrière-plan, renforçant le contraste et la séparation symbolique entre ce qui bouge (nous, avec le personnage principal en mouvement) et ce qui reste statique. De tels procédés ne sont pas rares aujourd’hui, mais quand on emploie plus que ça et avec la fluidité d’un steadicam, l’effet recherché en devient nul. Quand on allie au contraire des images plus volontiers statiques à de rares plans en mouvement, l’effet est bien plus garanti.
Voilà comment on fait d’une histoire un peu banale un grand film. Il n’y a pas d’histoires stupides, ou de propagande, il n’y a que des films bien ou mal racontés. La forme doit se mettre au service du fond. Et c’est ce que Chtrijak parvient magnifiquement à faire ici.









 Année :
Année : 


 Année : 1923
Année : 1923









 Année : 1928
Année : 1928
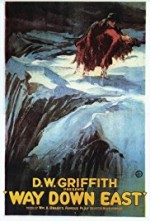










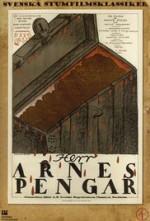







 Année :
Année : 



