Un homme, une femme, un pote, une bijouterie

La Bonne Année
Année : 1973
Réalisation : Claude Lelouch
Avec : Lino Ventura, Françoise Fabian, Charles Gérard
Probablement le meilleur Lelouch, mais je ne m’infligerais certainement pas le reste pour m’en convaincre. Tout Lelouch est là, le meilleur, sans les excès. Du moins, il faut reconnaître certaines bonnes idées bien exploitées, et une distribution, un trio surtout, qui marche comme rarement.
Lelouch, c’est quoi ? Les femmes, les copains, le cinéma, la technique, les voitures, les histoires de hasard… Et surtout, trop souvent, des poncifs à l’œil, des bons sentiments dans des magasins de porcelaine… Bref, c’est lisse et sans consistance. On attend là où ça gratte un peu, et ça vient jamais. Ça ne gratte pas plus ici, mais il faut savoir accepter de temps en temps les petits défauts d’un cinéaste plein de bonnes intentions. Et en dehors de quelques leloucheries qui parsèment le film, on prend d’abord plaisir à voir Lino Ventura et Françoise Fabian se tourner autour, ou encore le même Ventura et Charles Gérard se chambrer. Parce que Lelouch, c’est aussi ça, les face-à-face. Tout semble toujours affaire de séduction chez lui, même entre potes. De mémoire, dans Un homme et une femme, l’expérience tournait à vide parce que ça manquait de personnages : l’intimité, ou l’exclusivité, la frontalité, d’un face-à-face confine parfois à l’ennui, alors qu’ici Lelouch use de quelques artifices pour au moins servir de prétexte à revenir à ce qui l’intéresse. Plus tard, ce sera le contraire, on verra « défiler des stars pour Lelouch ». Ici, le juste milieu est parfait à tous les niveaux, et c’est parfois tellement compliqué à structurer un film autour de ces rapports qui peuvent paraître évidents alors que quand ça manque et que par exemple ces « stars » ont peu de scènes en commun, ça saute aux yeux, on peut donc bien lui reconnaître cette réussite dans La Bonne Année.
On oubliera aussi un certain maniérisme dans la narration. Chose qui passera toujours chez un Godard parce qu’il a du génie. Lelouch n’aura au mieux que des coups de génie. Le petit péché mignon dans son cinéma, c’est sa trop grande confiance aux séquences qu’il écrit. Au théâtre, on dirait qu’il s’installe. Or si au théâtre, c’est aux acteurs de faire avancer le rythme, au cinéma, c’est à travers le montage (le découpage) qu’on avance. Son trop grand amour sans doute pour ses acteurs, qu’il se plaît à mettre en situation. Seulement Lelouch pense à ces situations pour elles seules au lieu de chercher à les intégrer dans une logique d’ensemble. Ce qui produit chez lui un rythme lent, ou creux, vide, mou, lisse, stagnant. Impression confirmée par ailleurs par le manque d’intérêt qu’on peut avoir pour les personnages décrits : la bienveillance permanente que porte Lelouch pour ses acteurs, voire ses personnages, avec pas une once de vice (sinon des vices réels montrés comme des vertus : libertinage, goût du vol et de l’escroquerie). Ça fait peser sur ses films une forme de positivisme naïf, posé là comme une évidence, mais que les spectateurs prendront plus volontiers pour une injure à leur goût, eux, pour des personnages plus torturés, plus malades, plus fous ou malsains. Le désamour ou l’agacement des films de Lelouch à mon avis vient pour une bonne part à cette naïveté un peu pesante et systématique. Lelouch mettrait en scène un meurtrier qu’il finirait par être tellement fasciné par lui qu’il en ferait un personnage positif. Et ça c’est louche, Claude. Les évidences, les facilités, et le positivisme, le public il a horreur de ça. Les questions, il veut que ce soit lui qui se les pose. Pour ça, il faut éviter les poncifs, les leçons de morale, et surtout nuancer à la fois les personnages et la morale que le spectateur pourrait en tirer. Pourrait, parce que tout doit être suggéré. Et Lelouch, à la suggestion, il ne connaît rien. Il dit tout, il montre tout. C’est un obsédé des évidences, et il veut en plus que chacun assiste à ses grandes découvertes. « Ce matin, j’ai enfoncé une porte qui était déjà ouverte ! » Merci Claude. Et sinon, le hors-champ ? est-ce que tu nous laisses de temps en temps nous questionner sur ce qu’on voit, réfléchir, faire appel à notre propre imagination, Claude ? Non. Tout est là. On a des stars, on a son œil derrière la caméra, et on doit s’en contenter parce que rien que ça… c’est formidable.
Et pour cette fois, il n’a pas tout à fait tort.

Parce que ses acteurs sont formidables, c’est vrai. Parce que son intrigue sent bon le petit polar sans prétention, un peu comme un Bob le flambeur revisité par un étudiant en cinéma. Ah, les casses à la française… Dans lesquels, on prend plus plaisir à cuisiner qu’à déguster. Melville, le rythme, il l’a. C’est un rythme lent, pesant, qui intrigue et fascine. Lelouch, c’est le rythme zéro, celui de la vraie vie, celui des bavardages, celui des dragues un peu lourdes mais polies des types maladroits qui ne savent pas y faire et qu’on laisse faire parce qu’ils se rêvent en romantiques. Comme Ventura dans le film. Lelouch aime quand ça pétille, eh ben là, l’effet nounours de Ventura, mêler aux échanges croquignolets avec son acolyte, c’est l’alchimie parfaite. On accepte le faux rythme parce que le reste est beau.
Lelouch fait donc confiance aux acteurs (parfois trop jusqu’à s’en rendre esclave), et ça marche. Françoise Fabian explique la méthode : Lelouch filmait d’abord la séquence telle qu’elle était écrite, ensuite il leur demandait d’improviser et de s’amuser. Au montage, Lelouch n’aurait jamais gardé la première prise. L’un des trucs de Lelouch, il est là. Il aime les acteurs, et il trouve moyen de les mettre dans des bonnes conditions quand ils sont bons. Ce n’est rien de plus ni moins que de l’improvisation dirigée (il aura recours à d’autres artifices, de mémoire, pour diriger les acteurs plus tard, et arriver à leur faire dire ce qu’il souhaite). Lino Ventura aurait ainsi été l’auteur de certains poncifs qui seraient peut-être plus efficaces si on ne sentait pas la volonté permanente d’en trouver. Mais l’improvisation, ça limite tout de même les possibilités de trop en faire dans ce domaine. Et on ne s’improvise pas Audiard ou Jeanson.
Autre aspect positif du film, la technique. On refuse parfois de l’admettre parce que Lelouch ne fait pas sérieux et qu’il a un petit côté délégué de la classe dans une classe de casse-pieds géniaux dont l’enthousiasme peut irriter, mais oui, Lelouch, c’est aussi la nouvelle vague, autrement dit, aussi, la capacité de filmer avec des dispositifs légers sans pour autant faire artie ou expérimental. La technique au service de l’acteur… et de l’amour. Dans l’imaginaire, il y a l’avant, quand les cinéastes, c’était des types avec un cigare, assis sur une chaise aux côtés de mille techniciens et dirigeant de loin les acteurs, et l’après. L’après, ça pourrait être Godard dans un chariot filmant un travelling pour À bout de souffle ; ou ça pourrait être Lelouch à l’œilleton dans toutes les positions. Le génie technologique français n’a pas seulement inventé le Minitel ou le Bi-Bop, mais la caméra mobile (enfin réinventé). Kubrick et Pollack auraient été très impressionnés par les gesticulations du cinéaste sur ce film. Et pas seulement je serais tenté de dire. Dans l’emploi de certains objectifs en intérieur, jusqu’au traitement des couleurs en intérieur, on y retrouve un petit quelque chose de kubrickien, c’est vrai (notamment lors du repas de réveillon chez Françoise Fabian).
Un dernier mot sur un procédé de montage, presque expérimental, audacieux (comme peut l’être Lelouch, c’est-à-dire mêlé d’un enthousiasme un peu fou), mais pas forcément exploité jusqu’au bout. Lelouch nous propose deux ou trois fois des bribes de scènes qui se révèlent être des possibilités non pas narratives (ou quantiques…) mais personnelles : ce qui pourrait ou aurait pu se produire si Ventura agissait autrement. Toutes ces séquences sont bien intégrées au montage, sauf la première, celle dans la prison. Peut-être parce qu’on ne comprend pas tout de suite… (Un autre procédé est une leloucherie typique : la fausse bonne idée d’employer le noir et blanc pour les séquences au « présent », et les autres en couleurs pour le cœur du film.)
La Bonne Année, Claude Lelouch 1973 | Les Films 13, Rizzoli Film
Liens externes :



 Année : 1970
Année : 1970






















 Année : 1972
Année : 1972





















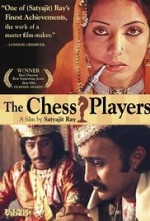 Année : 1977
Année : 1977