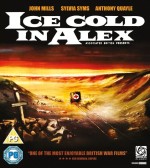Réponse à Renaud/Morrinson (Je m’attarde) concernant l’interprétation du film :
Je pense que toutes les interprétations sont possibles, c’est l’intérêt de la chose presque. Je ne me rappelle d’aucune idylle par exemple (sauf avec la blonde baby-sitter — qui n’apparaît pas dans la nouvelle, je crois), et je doute que tout cela ne soit qu’un rêve. Je n’ai pas non plus pensé à un récit passé > présent. Pour moi, il s’agit bien d’une journée complète, on ne sait pas d’où il sort, et ce passé auquel il court, ou plonge, il le retrouve à travers ses rencontres, mais bien au présent, après sans doute un traumatisme ou quelque chose de ce genre. Je l’ai vu comme un type qui après une séparation ou une tragédie personnelle, après un séjour à l’asile, serait peut-être sorti, aurait perdu la mémoire, et se repointerait chez lui comme si de rien n’était en ayant oublié les dix dernières années de sa vie, et en devant alors faire face aux réactions médusées des gens qui l’ont connu.
Ça me semble évident, mais c’est peut-être parce qu’il m’est déjà arrivé de rêver ça : me retrouver là où j’avais vécu gosse, comme un point zéro marquant, avec tes habitudes, où tu voudrais bien revenir, mais où tu sais que tu ne pourras jamais.
Il y a un petit côté Alzheimer chez lui et, dans mon interprétation, c’était bien quelque chose de pathologique, une amnésie, liée très probablement à un traumatisme, une dépression, etc. Ensuite, ce n’est qu’une interprétation ; encore une fois, l’intérêt du film, c’est que rien n’est explicité et que chacun peut se créer sa sauce interprétative. Si quelqu’un explique le film en ayant tout compris et en imposant une seule version possible (je ne me rappelle plus très bien de ce que dit Thoret, mais c’est probable qu’il ait envie une nouvelle fois d’expliquer, trouver des symboles vaseux, etc.), ça n’a plus d’intérêt. Ça fait partie de ces histoires, presque mythologiques, qui deviennent universelles en en disant assez sur la vie et le monde tout en gardant une part de mystère. Il est normal alors que ça ne touche pas forcément certains spectateurs puisque c’est comme une boîte vide : si on n’y amène rien, si ce qu’on y voit ne nous inspire rien, ça sonnera… vide. Mais si on s’y laisse entraîner, si on commence à y venir avec ses propres bagages émotionnels, son histoire, ses peurs, ses obsessions, et qu’on y trouve toujours un écho dans le film, la boîte vide s’est remplie, et chacun aura une boîte différente. C’est le génie de l’art, capable de s’adresser à tout le monde, parfois, tout en s’adressant spécifiquement à chacun, comme un effet de miroir. Il suffit que l’angle donné ne soit pas le bon et on ne s’y reconnaît pas.
Thoret s’y est sans doute très bien vu et vu son imagination, sa capacité à voir des symboles, des références ou des révolutions partout (ou des intentions — surtout là où on peut difficilement parler d’auteur), c’est compréhensible qu’il adore le film et le mette au même rang que Le Lauréat. Il n’aurait pas tout à fait tort d’ailleurs. Quelle que soit l’interprétation que lui en fait, on ne peut pas nier que les deux films ont une approche “européenne” du cinéma (influencé par Blow up, je crois surtout). C’est-à-dire que tout à coup, les histoires n’avaient plus peur d’exposer l’ombre des choses, les mystères, l’incompréhensible, ou pour revenir à Antonioni, l’incommunicabilité. Toutes les années 70 seront sur ce même ton jusqu’à ce que Spielberg et Lucas y mettent un terme.
J’apprécie souvent ce genre d’histoires a priori absurdes qui refusent toute explication, sorte de machin existentialiste qui ne ressemble à rien, parce que ça me semble être un regard à la fois particulièrement déformé et pourtant si vrai de la réalité (Shakespeare ne disait pas autre chose, par exemple, déjà, tout comme Calderón avec La vie est un songe ou Cervantès à la même époque). Et ça, au XXᵉ siècle, ça a été pas mal transmis en France en tout cas par le théâtre de l’absurde. En attendant Godot, c’est tout aussi bizarre, existentiel et sans explications possibles. Pour reprendre le titre d’un machin de Peter Brook : tu as un espace vide, et c’est à celui qui regarde de le remplir, grâce aux suggestions de la scène ou de l’écran.