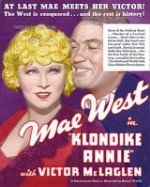Les Voyages du cœur

Un cœur pris au piège

Titre original : The Lady Eve
Année : 1941
Réalisation : Preston Sturges
Avec : Barbara Stanwyck, Henry Fonda
— TOP FILMS —
Autant j’avais moyennement apprécié Les Voyages de Sullivan pour son message bidon et ses digressions, autant là je suis conquis par ce vaudeville bien ficelé. Preston Sturges oublie Capra et se recadre en produisant un film dans son époque, en alliant romance et burlesque pour en faire une screwball comedy.
Il m’aura fallu tout de même attendre la fin de la première partie sur le paquebot, très bien écrite, plutôt conventionnelle et assez peu burlesque, pour me poiler vraiment. Il fallait bien ça pour oublier que j’étais en train de regarder un Preston Sturges… Le quiproquo à ce moment est parfaitement mis en place. Le personnage de Barbara Stanwyck vient se venger et se moquer du candide fils à papa interprété par Henry Fonda. Pour une fois, dans une comédie, l’acteur des Raisins de la colère trouve le bon ton, c’est-à-dire, arrive à jouer au premier degré : aucune ironie chez lui, et c’est justement ce qui est tordant.
La scène romantique imaginée par « Lady Eve » avec son Jules et le cheval derrière est hilarante. Là encore, si Stanwyck se retient de rire, Fonda, lui, garde le même sérieux malgré le cheval qui veut absolument poser pour la photo dans cette scène au clair de lune, ou presque. La scène dans le train n’en est pas moins bluffante. Et durant la scène de réception, c’est la répétition qui fait rire, l’excès, et toujours ce premier degré, cette candeur incrédule du personnage de Fonda. Une candeur assez inhabituelle parce que c’est généralement un sentiment attribué aux jeunes filles. Ce personnage de Fonda a tout de la riche fille à marier séduite par tous les mâles alentour… au masculin. Et il sera candide jusqu’à la dernière seconde, puisqu’il n’aura toujours pas compris la supercherie… Comme souvent, c’est Stanwyck qui mène le bal.
Le comique le plus évident est l’héritage du burlesque. Autant se servir des codes mis en place durant le muet. Il y a le choix. Le buddy movie à la Laurel et Hardy ; la catastrophe ambulante à la Buster Keaton ; l’imbécile heureux à la Roscoe Fatty Arbuckle… ou le couple. L’homme et la femme étaient le plus souvent déjà mariés, à la Feydeau ; lui, vagabondant en quête de plaisir et de vice, elle, l’attendant avec son rouleau à pâtisserie (comme dans l’excellent Mighty Like a Moose de Leo McCarey). Le parlant rendait possible les échanges verbaux, et non plus de coups et de poursuites, ce qui a permis de voir plus généralement des couples en train de se former. La comédie romantique, ou la screwball comedy pouvait naître. Les racines du genre sont évidentes. C’est le burlesque. Et pour une fois Sturges est dans cette lignée. Les comédies romantiques sont des films initiatiques à elles seules : le voyage est celui du cœur. Pas besoin d’y adjoindre une quête superficielle comme celle d’un gros lot ou de la « recherche du cœur du pauvre », l’incertitude de la romance est là, et suffit amplement. Quand on n’est ni Lubitsch, ni Wilder, ni Capra, il faut bien s’en contenter pour faire de bons films.

Un cœur pris au piège, The Lady Eve, Preston Sturges 1941 | Paramount Pictures


Listes sur IMDB :
✓
✓
✓