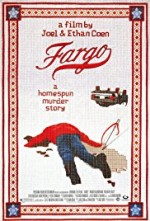En voilà un bon film sorti de nulle part. À première vue, un polar russe, ça sent la violence à plein nez et on peut rechigner à grimper dans le tram de peur d’y rencontrer des trognes qu’on voudrait voir nulle part. Et pourtant, malgré la brutalité des situations, il y a une force de grâce improbable et une de ces évidences propres aux grands films, simples, qui émanent de ce Brat. Pour l’expliquer, les références sont encore et toujours faciles à faire : ici, on y verrait presque un croisement étrange entre Le Samouraï de Jean-Pierre Melville et Vanishing Point.
Le second, je le prends souvent en référence comme le film ultime réussissant à inspirer cette fulgurance tragique palpable dès les premières minutes et qui égraine le sablier du destin sans accrocs jusqu’à la fin. Il y a de ça ici donc, une sorte de rythme insistant, lapidaire, fait de scènes brèves mais lentes avec une trajectoire unique, sans détour. L’impression ressentie est d’autant plus vivace que l’ensemble du récit est ponctué par des montages-séquences* sans grand génie, mais efficaces, pour aller à l’essentiel, se passer de scènes sans intérêts qui nous auraient détournées de l’essentiel, le sale, la trajectoire étrange de ce personnage sorti de nulle part, mais qui sont toutefois nécessaires ainsi, sous la forme de simples évocations. Parce que parfois, si les ellipses sont nécessaires (et le film les emploie à merveille), il faut aussi parfois rester entre les deux, et c’est bien ça à quoi est utile le procédé du montage-séquence. Ça permet aussi d’illustrer la passion insistante et presque hors de propos de ce jeune tueur pour la musique (rappelant l’amour que Delon peut porter à son canari dans Le Samouraï — mais qui cache, là c’est vrai une utilité —, ou celui de Jean Réno pour ses plantes dans Léon — je dis ça de mémoire, mais on le retrouve ailleurs, c’est presque un cliché).
Le rapport au Samouraï donc, il est surtout lié au personnage principal. La trajectoire du jeune tueur ici est moins condensée ou ramassé sur un épisode, car si le personnage de Delon est déjà un tueur professionnel, Danila va le devenir, introduit dans le milieu par son frère. Mais la suite est très intrigante, car l’habileté dont il fait preuve dans ses nouvelles activités criminelles est presque surréaliste, irréelle. Et si on y croit, c’est que Danila fait preuve en toutes circonstances d’une intelligence remarquable et d’un sang-froid infaillible. On sait de Danila seulement qu’il revient de la guerre, et n’a donc aucune attache en dehors de son frère en ville, qu’il connaît d’ailleurs assez peu, et les relations qu’il entretient ainsi avec les autres, pratiquement toutes nouvelles, prennent étrangement la forme d’une rencontre avec un être venu d’ailleurs, un dieu (ou une sorte même d’agent du diable comme dans Théorème), voire un extraterrestre (Le jour où la Terre s’arrêta, Starman) ; l’effet est d’autant plus troublant qu’on ne sait rien de lui et qu’il a tout d’un étranger pour son frère (qui ne se privera pas d’ailleurs de le trahir). Ce qu’on sait en revanche, c’est que malgré les activités louches dans lesquelles il va tremper sans sourciller et avec une assurance bluffante, il a une morale, un honneur… Sorte de Dexter avant l’heure. Le jeune homme ne tue que les enfoirés, et sauve les gens honnêtes. Le tout sans jamais s’interroger sur ce qu’il fait, comme si c’était une évidence, et sans mesurer les conséquences forcément embarrassantes que cela n’évitera pas de lui provoquer. C’est ce côté irréel qui fascine. Et si le procédé n’est pas nouveau, il y a une petite subtilité qui change tout et finit de nous rendre le personnage sympathique et crédible : non seulement, il sort de la guerre (ce qui pourrait expliquer vaguement, non seulement sa maîtrise des armes et des assauts, mais aussi une forme de désinvolture voire de psychopathie), surtout il est très jeune, a tout du type ordinaire, l’autorité, l’assurance en plus. Aussi, au contraire d’un Delon sinistre, ombrageux, dans le Samouraï, le personnage ici serait plus dans un registre tiède, indolent, distant, secret, mais décidé, affable, voire sympathique. C’est d’ailleurs grâce à ce caractère, qu’il noue contact avec deux femmes, qui ne lui inspireront pas une grande passion, mais soulever au moins son intérêt, qui lui fera croire, apparemment à tort, qu’il pouvait espérer autre choses d’elles : les évidences ne sont pas valables que pour nous. Et quand les deux lui échappent, il “prend acte”, ne semble là encore montrer aucune passion particulière…, et décide de partir. Comme il est arrivé, presque. Un bon gars, on pourrait presque être amené à penser… Un ange venu d’ailleurs. La grande faucheuse, la justice.
Inutile de préciser que pour un tel personnage, il faut un acteur (jeune) remarquable. Celui-ci dégage une puissance, une maturité, une autorité et une précision qui laissent admiratif.
Dernier point particulièrement bienvenu : le film n’use nullement d’effets tape-à-l’œil, la violence n’est jamais accentuée par la mise en scène, au plus a-t-on droit aux traditionnelles scènes de préparatifs tout en inserts sur les armes, mais ensuite, pas d’éclats, c’est violent, ça tire, ça tue, mais à l’image du viol, on coupe rapidement, et quand on montre, on le fait plutôt à la Haneke, de manière froide, distante, sans gros plans, ni montage, ni trompette. Au contraire, la musique, puisqu’elle est au centre de tout, n’est là que pour illustrer le monde intérieur de Danila, comme indifférent à cette violence, à celle-là même dont parfois il est responsable.
Très réussi, ou miraculeux.
(L’acteur principal et le réalisateur sont morts relativement jeunes. Le premier dans un glissement de terrain, le second d’un arrêt cardiaque. Fallait bien une fin tragique à ce film…)





Le Frère, Aleksey Balabanov 1997 Brat | Kinokompaniya CTB, Gorky Film Studios, Roskomkino





















































 Année : 1992
Année : 1992
 Année : 2007
Année : 2007
 Année : 1981
Année : 1981
 Année : 2006
Année : 2006