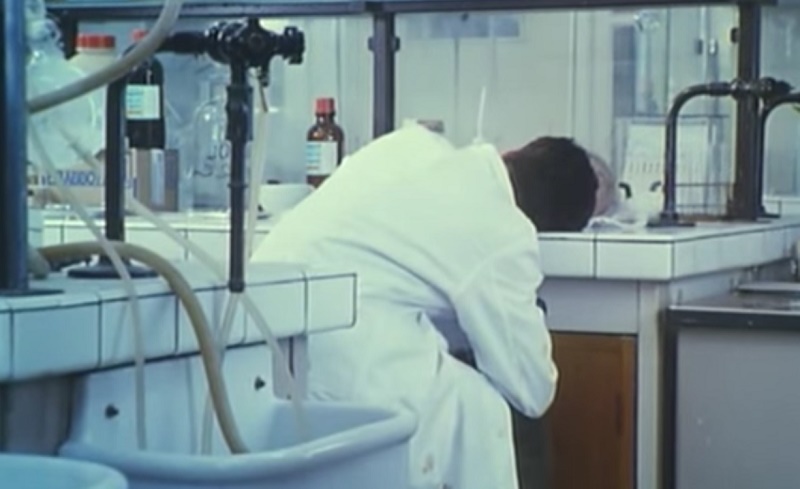Je n’ai jamais été bien passionné par les films muets. Et ce n’est pas celui-ci qui y changera grand-chose. Cela étant, puisque je commence à bien connaître les films et le style de Naruse, voir l’un de ses premiers films est vraiment d’un grand intérêt, et on va faire le point. On peut y déceler ce qui fait déjà le charme de ses films suivants, et donc comprendre ce qu’est le style de Naruse. Il faut bien le dire, cela m’a fait prendre conscience d’un certain nombre de choses qui ne m’avaient pas sauté aux yeux, alors qu’en y regardant d’un peu plus près, elles paraissent évidentes…
D’abord, les personnages principaux des films de Naruse sont toujours des femmes. Presque toujours le même type de personnages. Femme plus ou moins seule, hôtesse de bar, geisha (on va voir que pour un Occidental, c’est parfois très compliqué de faire la différence et même de comprendre ce que ça implique, la culture japonaise à ce niveau était particulièrement éloignée de la nôtre). Ce personnage principal féminin est souvent d’une grandeur d’âme implacable, d’une probité sans reproche, souvent réservée (en tout cas un vecteur pour Naruse pour instaurer ces ambiances tristes et poétiques, contemplatives, qu’on appelle mono no aware). Elle subit toujours les événements avec un grand courage et une grande dignité (il y a toujours quelque chose de noble dans le comportement de ce personnage, alors qu’il ne s’agit bien souvent que de la classe moyenne japonaise). Tout ça est régi certainement par des codes, des usages, propres aux relations sociales dans ce pays : le respect et la hiérarchie sont des notions majeures, plus que chez nous où, depuis quelques décennies, tout est beaucoup moins structuré et strict. Les personnages appartiennent toujours à la classe moyenne japonaise, et j’ai même l’impression qu’on a souvent affaire à un même quartier de Tokyo, celui de Ginza.
Ensuite donc, les lieux. Ce n’est pas du tout le cas dans ce film La Rue sans fin (même si l’on est toujours à Ginza, il me semble), mais très souvent les scènes se limitent à quelques lieux bien définis, et pour autant indéfinis pour qui n’est pas familier avec les usages nippons. Ça se limite à la maison, au bar, et à la rue, mais pas n’importe quel type de rue. Et c’est là que tout le génie des films de Naruse s’exprime. Et là où il faut s’accrocher. Pour nous, la maison est le symbole de la vie strictement et exclusivement intime (une conception du foyer qui date en quelque sorte de l’invention du libéralisme en Hollande avec l’enrichissement des « foyers » grâce au commerce avec l’Orient, avant cela, la conception du foyer en Europe n’était peut-être pas si différente de ce que l’on peut voir dans certains foyers japonais des films de Naruse). Le bar, au contraire, c’est le symbole du lieu public. Pour nous, il s’agit donc de deux lieux diamétralement opposés. Mais au Japon, ce n’est pas si simple. Les maisons, en tout cas dans la plupart des films de Naruse, les maisons sont des lieux de passage. Parce qu’il s’agit parfois de maisons de geishas (Okiya), de commerces (une teinturerie par exemple dans La Mère, et les clients se présentent juste au comptoir qui mène à la rue de derrière, mais il n’y a pas de séparation évidente entre le monde public et privé), peut-être d’auberges, de pensions, de magasin… Le fait est que pour un Japonais, quand il regarde le film, il va tout de suite reconnaître un type de lieu, même par les dialogues, le lieu sera défini par un mot, mais qui n’a pas d’équivalence en français (comment traduire okiya, par exemple ?). Cela vaut aussi, et sans doute plus encore, pour ce que nous appelons des « bars ». On peut imaginer que pour un Japonais qui arrive en France, il soit difficile de saisir la différence entre un bar, un café, un bar-tabac, une brasserie, un restaurant, un traiteur, un grand restaurant, un self-service, un fast-food, une boulangerie, un restaurant d’entreprise… Pour nous, c’est presque tout autant compliqué de comprendre les maisons et commerces liés à la boisson, à la détente et à la restauration, d’autant plus qu’on ne peut traduire par les équivalents en français. Chaque établissement japonais a sa particularité, sa fonction, parfois même comme en France, un établissement peut regrouper plusieurs types d’établissements ou être spécialisé en un certain type de nourriture ou de boisson, si bien qu’il est impossible de s’y retrouver. Et c’est là que comprendre les films de Naruse, toutes les subtilités de ces films, semble réellement être vain pour un Occidental. On comprendra les grandes lignes, mais pas mal de ces subtilités resteront incomprises et étranges.
Et Naruse accentue ce flou entre espace intérieur et extérieur, lieux intimes et publics, en filmant souvent un espace depuis un autre.

Les espaces exigus, parfois intimes comme une chambre à coucher, toujours ouverts vers l’extérieur, ici dans A l’approche de l’automne | Toho Company

Un espace intérieur filmé depuis l’extérieur grâce à un « 4e mur » quasi béant, ici dans Une avenue au matin, Mikio Naruse 1936 | P.C.L. Eiga Seisaku-jo

Un espace extérieur filmé depuis l’intérieur grâce à un « 4e mur » quasi béant, ici dans Délit de fuite, Mikio Naruse 1966 | Toho Company

Passage de plat entre la cuisine et la salle, entre privé et intime, ici dans La place de la femme 1962 | Toho Company

L’entrée de la pension dans Chronique de mon vagabondage, Mikio Naruse 1962 | Takarazuka Eiga Company Ltd.

Les boutiques ouvertes sur la rue, ici dans A l’approche de l’automne | Toho Company

L’amour des ruelles marchandes et… désertes, privé ou intime ? Ici dans La place de la femme 1962 | Toho Company

L’amour des ruelles marchandes, ici dans Angry Street, Mikio Naruse 1950 | Tanaka Productions

Ruelle privative ou rue escarpée, ici dans Nuages flottants, Mikio Naruse 1955 | Toho Company

La ruelle, souvent un lieu d’intimité, de confidence ou comme ici de dispute dans Courant du soir (Mikio Naruse 1960 | Toho Company)

Les commerçants ont l’habitude de nettoyer les ruelles devant leur boutique (acte intime dans un espace supposé public), ici dans A l’approche de l’automne 1960 | Toho Company

Même chose, ici dans Frère aîné, sœur cadette, Mikio Naruse 1953 Ani imôto | Daiei Tokyo Daini

Dernier exemple de cette confusion avec les bains publics, présents dans nombre de films de Naruse, ici dans A l’approche de l’automne 1960 | Toho Company
Parmi les subtilités des espaces bien définis, je commence par Ginza. Il s’agit en fait de l’un des quartiers principaux de bars à hôtesse et maisons de geishas de Tokyo où se situent beaucoup de films de Naruse. Ce genre de quartier avec ses petites ruelles est appelé hanamachi (ville fleur), et même si dans tous les films de Naruse, les personnages principaux ne sont pas que geishas, on retrouve souvent cette ambiance. Peut-être est-on toujours dans les mêmes coins de Ginza, peut-être cherche-t-il toujours les mêmes types de quartiers, peut-être était-ce juste la norme, la disposition réelle des maisons ? Je n’en sais rien…
Le week-end, durant l’après-midi le centre du quartier est réservé aux piétons…, mais seulement le début des années 60. Donc après la grande partie des films de Naruse, mais peut-être est-ce là un indice pour comprendre qu’autrefois ces quartiers avaient un charme particulier sans les véhicules motorisés…
L’okiya est donc la maison de geisha. Il s’agit d’artistes, elles ont le rôle de divertir. Bien sûr, leur talent ne se limite pas au chant et à la danse, mais aussi à la conversation (parfois un peu plus). Et ça se complique quand on sait que leur rôle s’est modifié, voire diversifié, au cours du XXe siècle. Entre celles qui sont restées fidèles à la tradition, celles qui se sont mises à fréquenter les « bars », et tout ça en sachant aussi qu’au milieu du siècle, la prostitution a été officiellement interdite…
Izakaya est une sorte de bar où l’on peut boire, s’enivrer et manger (il correspond sans doute plus aux pubs en Grande-Bretagne). On y va entre collègues après le boulot ou avant d’aller ailleurs pour manger. La bouffe est généralement partagée entre les clients d’une même table. Trois manières de consommer : sur un tatami (assis en seiza), autour d’une table, ou au comptoir du bar.
Il y a aussi le kyabakura (ou bar à hôtesses), tenu parfois par une Mama-san (un manager femme). Dans Une femme monte l’escalier, Hideko Takamine est appelée Mama.
On a encore les snack-bars, dans lesquels les hôtesses flirtent avec des clients dans un lieu plus petit (ce n’est pas de la prostitution…). Il me semble que dans Une femme monte l’escalier, toujours, le personnage d’Hideko Takamine, l’établissement qu’elle achète à son compte est un snack-bar.
Bref, on voit bien que sans équivalent, c’est presque impossible de comprendre ces films… Il faudrait apprendre à connaître tous les types d’établissements, que ce soient les maisons, les bars, les restaurants, et reconnaître les mots japonais qui les définissent (par exemple, il y a cinq ou six noms différents pour les restaurants japonais, étant donné qu’on ne mange pas le même type de nourriture).
J’en reviens donc à ce que je disais sur les trois types de lieux dans les films de Naruse : la « maison », le « bar » et la rue (là aussi, j’aurais presque envie de mettre des guillemets). Pour un Occidental, il n’y a rien qui oppose plus une maison privée d’un bar public. Au Japon et dans les films de Naruse, il y a comme une harmonie entre ces deux lieux, un peu comme s’ils s’emboîtaient l’un dans l’autre. Certaines maisons sont semi-privées, collégiales, comme des pensions, on entre au moins jusqu’à l’entrée « publique » sans frapper, et on attend d’être invité à rejoindre le reste de la maison, qui est, elle, surélevée (là, on doit quitter ses chaussures pour des sandales et rester en chaussette sur les tatamis).
Et de la même manière, les « bars » sont souvent des sortes de clubs où se rencontrent des habitués. Si l’on vient seul…, on peut avoir de la compagnie au menu, avec ces hôtesses de bar, sortes de geishas des temps modernes. Il s’agit donc de lieux bien moins publics que ce que l’on connaît chez nous. Ce qui fait que dans les films de Naruse, tous les lieux sont à la fois publics et privés. Cela dépend en fait des circonstances. La chambre à coucher par exemple, la journée, on peut y servir le thé à un visiteur…, ce qui en fera la chambre à coucher, c’est seulement quand, au coucher, on met le futon sur le tatami. L’ambivalence de ces deux types de lieux, c’est la marque des films de Naruse : on passe sans cesse de l’un à l’autre ; le privé et le public sont toujours très liés. On se croirait presque dans une pièce de théâtre classique où les personnages font des entrées en scène en étant annoncés. Que ce soit la maison ou le bar, c’est le lieu où l’action se passe et au-dehors on a les « autres » qui sont susceptibles de venir se présenter assez facilement sans pour autant que ça tue l’atmosphère intime du lieu. Il est intéressant de noter que dans les films japonais (chez Naruse en tout cas), on a plus regard de l’intérieur qui voit entrer un nouveau personnage, alors que dans le cinéma occidental, on verra plus souvent les personnages se déplacer eux-mêmes pour se rendre à un lieu et rencontrer d’autres personnages (si j’étais audacieux, je comparerais le récit nippon à un ovule et le récit occidental à un spermatozoïde…).
Il existe enfin le troisième type de lieu chez Naruse : la rue. Elle fait le lien entre les deux premiers, peut-être pour souligner un peu plus leur similitude, leur ambivalence. Mais attention, si dans la Rue sans fin, on a encore des rues bondées, presque toujours par la suite Naruse préférera des petites ruelles, voire des rues, des ponts, sans circulation. Et là encore, l’harmonie est respectée. Encore une fois, on a affaire à un lieu public, mais l’atmosphère est privée, intime. On retrouve presque systématiquement des dialogues à deux personnages (un peu à la Wong Kar-wai) et quand ils sont trois dans le Repas[2] par exemple, il ne s’agit que du môme d’un des personnages qui joue pendant que sa mère cause avec le personnage principal (il est présent sans faire partie du cercle intime de la discussion). Paradoxalement, la rue devient le lieu intime par excellence, parce qu’on y a exclusivement des scènes à deux, comme l’antichambre ou le boudoir où l’on ira confesser ses tourments à la voisine ou une vieille connaissance.
C’est là que pour comprendre le style de Naruse, La Rue sans fin est intéressant (rien que le titre…). Ce n’est pas encore tout à fait du « Naruse ». Les rues sont larges, grouillent de monde et de circulation ; en plus, Naruse se plaît à donner un caractère descriptif, presque documentaire au film en multipliant les plans de foule, de la rue pendant les transitions. Un style de plan qu’il abandonnera totalement par la suite, dans une recherche, toujours, d’économie (des moyens et des effets).
On peut se demander si à ce moment, Naruse n’a pas encore trouvé son style, sa voie, sa route (sa rue) ou s’il ne cherche pas tout simplement à copier ce qu’il a vu dans les films occidentaux (pour les films de l’époque qui ne sont pas tournés en studio). Parce que dans ce film, il n’y a pas que les rues qui sont filmées comme il ne le fera plus jamais par la suite. Il y a surtout les scènes d’intérieur qui n’ont rien à voir. On s’étonne de voir des voitures dans La Rue sans fin (on est pourtant en 1934, et on n’en verra que rarement par la suite, alors que les trains seront plus répandus par exemple… pourquoi ? mystère… est-ce que les trains font plus japonais, est-ce que ça correspond plus à son idée de faire des lieux à la fois publics et privés ?…), mais surtout, on y remarque des portes ! Les personnages semblent incapables d’ouvrir ces énormes portes… Par la suite, les portes disparaîtront presque de ses films (on en voit parfois à l’entrée d’un bar, mais jamais en gros plan comme c’est le cas dans ce film). Il préféra, plus tard, revenir aux bonnes vieilles portes coulissantes (shoji ou fusuma). Est-ce que c’est un désir de sa part de retourner à des films plus « japonais » ? Cherchait-il comme ça à affirmer son style ? Mystère. On en voit, par exemple, beaucoup plus chez Ozu, dans les entreprises notamment.
Autre chose qui m’a marqué dans ce film, c’est l’incroyable similitude dans le style de jeu des acteurs du muet, et plus tard dans ses films parlants jusque dans les années 60. Quand en Occident la rupture a été totale entre le jeu de pantomime et le parlant qui allait mettre dix ans à adopter les techniques réalistes de l’Actors Studio (et attendre encore quinze ou vingt ans pour que ces techniques se généralisent dans l’ensemble du cinéma américain), avec ce film muet de Naruse, on découvre qu’au Japon, il n’y a pas eu ce genre de révolution. Dans ce film, les acteurs ne jouent pas la pantomime. Mieux, la mise en scène, à travers son découpage, sa mise en place, est déjà assez proche de ce qui sera mis en place dans les films parlants (beaucoup de panneaux dans le film muet et au contraire peu de dialogues dans les films parlants…). Les Japonais garderont longtemps ce type de jeu précis, avec des codes, des jeux de regards, des postures, des ports de tête, une manière de se positionner par rapport à un autre acteur… C’est d’ailleurs étonnant de rencontrer des plans, des transitions, des postures, des jeux de regards, des axes de caméras qui reviendront sans cesse dans les films suivants. Pour exprimer un sentiment, mettre en place une même situation, on ne s’embarrasse pas, on utilise les mêmes méthodes. C’est comme si les acteurs japonais avaient des codes, des lazzis, comme autrefois les acteurs de commedia dell’arte pour jouer des personnages récurrents de la scène. Et là, étant donné qu’on a toujours affaire aux mêmes types de personnages (parfois aux mêmes acteurs), on peut facilement imaginer qu’il y a des codes, des poses, utilisés traditionnellement pour exprimer un sentiment, une situation. Chose impensable à la même époque en Occident (quoique). C’est amusant de voir, par exemple, des acteurs différents adopter les mimiques d’un acteur dans un film plus récent de Naruse. La femme qui baisse la tête en signe de résignation ou de docilité ; la vieille mère qui fait une moue et qui dodeline de la tête, l’air de dire « non, mais tout de même », surprenantes, ces similitudes. C’est dommage que là-bas, mais déjà à cette époque en Occident, on ait perdu ces méthodes de jeu. Ça limite le champ d’action. On ne peut plus jouer que d’une manière naturaliste, oubliant les « emplois », les personnages récurrents, familiers, les archétypes…
Il y a enfin la notion de mono no aware, habituellement utilisée en littérature, mais dont Naruse se serait inspiré pour créer des ambiances pour ses films. Et c’est vrai que quand on voit ces films, on cherche toujours à mettre des mots sur des choses qui en Occident n’en ont pas. On parle de contemplation, d’ambiance, de film lent, poétique… Ça devient plus compréhensible quand on peut identifier une notion vague avec une expression, même si ça reste impossible à traduire.
Alors le mono no aware, qu’est-ce que c’est ? Voici quelques tentatives de définitions en français :
D’abord, on le traduit parfois par « Le pathétique des choses », d’autres fois par « un sentiment profond des choses », ou encore par « Choses propres à émouvoir ».
Et voici deux définitions trouvées sur le Net :
« Les textes fondamentaux du Zen font de l’acceptation et de la transcendance du monde le point nodal de l’art de vivre qu’ils proposent, tandis que l’art narratif japonais traditionnel célèbre le monde tout en y renonçant. De nos jours, on emploie souvent le terme mono no aware pour décrire cet état d’esprit. Selon le mot de Tamako Niwa, il s’agit de “la tristesse sereine” qui nous envahit à la vue du monde. On l’utilise également pour décrire l’acceptation tranquille d’un monde en transition, le plaisir innocent et éphémère goûté à l’activité quotidienne ou encore le contentement procuré par la précarité de sa propre existence. »
« Appréciation généralement teintée de tristesse de la beauté éphémère qui se manifeste dans la nature et la vie humaine. »
Moins orientée vers la mélancolie et plus philosophique, voici la définition qu’en donne René de Ceccatty : « l’aware est une sorte de suspension de jugement, un retrait de la conscience, qui, à l’origine, prend la forme d’une exclamation de surprise devant l’apparition d’un sentiment nouveau ou d’un pur phénomène extérieur. Ce retrait, cette suspension, permet, précisément, la mise en place intérieure d’une autre catégorie de temporalité. Le sujet se retire de l’activité du monde qu’il observe et décrit de façon plus ou moins concise. »
Comme d’habitude, plus on comprend les choses, plus on se rend compte qu’il reste finalement encore plus de choses à découvrir… La rue est sans fin.