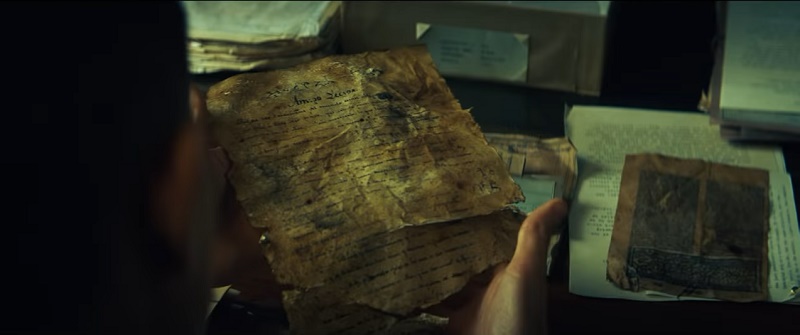On pourrait comparer ce sixième film de James Gray (après vingt ans dans la profession) à certains films de fin de carrière de n’importe quel cinéaste reconnu et apprécié pour ses premiers films et installé depuis dans un système, le sien, ou celui des studios, ou d’un autre, indépendant, underground… Car vient toujours un moment où on finit par se demander si un cinéaste se répète à l’infini et reproduit à envie les mêmes procédés par confort, facilité, paresse ou habitude. Tout ça pour contenter son public, son boss, sa femme, les critiques ou lui-même, bref, tous ceux qui attendent de lui que film après film, il reproduise le miracle de la création, et pour que rien ne compromette sa position au sommet de la pyramide où il se sait en sursis comme les autres. Produire ou cesser d’exister.
Quand on a affaire à un Woody Allen ou à Frank Capra par exemple, aptes plus que d’autres à relancer la machine au fil des siècles avec leurs propres idées ou avec celles des autres, quand on a affaire à une certaine forme de génie qui en impose, on peut encore à l’occasion des nombreuses productions retrouver le souffle perdu d’autrefois, convaincre en faisant même jusqu’à oublier les succès premiers. Mais quand on est indépendant, qu’on produit finalement assez peu et s’interdit ainsi de rebondir rapidement après un échec, ou simplement quand on ne possède pas le talent que l’on croyait avoir démontré dans ses premiers films, on peut craindre petit à petit que ce qui était perçu autrefois comme des atouts devienne des faiblesses, et qu’user des mêmes procédés qui ont fait un jour notre succès finisse par ne plus suffire, et qu’arrivés au bout d’une demi-douzaine de films, ou de quelques décennies de carrière, on en vienne à ne plus prêcher que les convaincus, à surfer sur une réputation et un crédit gagné bien plus tôt. Le vilain vice de l’expérience, de l’establishment. Or ce serait beaucoup plus simple si le savoir-faire, l’expérience, le réseau, n’avaient pas au fond une si grande importance dans la réussite d’une carrière et des films ; car en fait, les navets — dans cette perspective de cinéastes reconnus radotant les vieilles recettes — y sont plutôt rares, et c’est tout le problème de juger des films moyens, paresseux, qui loin d’être de grands films peuvent surtout satisfaire à la fois critiques et publics… Sur un malentendu. Sur l’autorité.

The Lost City of Z, James Gray 2017 | Keep Your Head, MICA Entertainment, MadRiver Pictures
C’est un peu l’interrogation qu’on est en droit de se poser avec James Gray avec The Lost City of Z. Quand le jeune James Gray propose sa vision sombre d’une société bien définie au milieu des années 90, c’est rafraîchissant, c’est fait avec peu de moyens, mais c’est propre, maîtrisé, et Gray arrive à convaincre avec un savoir-faire certain, plutôt avare en effets tape-à-l’œil, mais efficace. On n’oserait alors pas parler pour un jeunot de classicisme. On sent cependant que le gars, seul dans son coin, arrive à produire quelque chose de qualité, avec un ton bien à lui qu’il semble avoir adopté des films noirs d’antan ou de certains films européens jamais trop orientés par la nécessité de contenter un public peu exigeant. James Gray est en marge d’une époque qui met de préférence en lumière les agitations de personnages hauts en couleur et d’un système qui ne fait plus que des films de genre à l’exception peut-être de celui qui pourrait le plus lui correspondre, le polar. Ce genre qu’on appelait autrefois le crime film et que depuis on nomme film noir vit des temps difficiles, pourtant le style James Gray fait tellement “recette” que tout le monde semble reprendre cette tonalité à son compte comme d’autres de leur côté essaient de reproduire les tonalités des films de Tarantino… Mais celle qui s’inspire le plus et qui est la plus préparée à adopter ce retour, à travers Gray, d’un style dépouillé, sobre, sombre et presque sociologique du film noir, c’est la télévision. L’ambiance, le jeu épuré, l’intensité refoulée, la reconstitution millimétrée, les nombreux personnages…, toutes ces caractéristiques qu’on applique rapidement au style Gray se retrouvent désormais ailleurs, souvent dans des séries US, et c’est bien là qu’on pourrait craindre que le bonhomme ne soit pas en capacité à se renouveler. Quand vous avez un coup de génie en réinventant le hot dog en songeant simplement y ajouter de la moutarde, votre idée de départ vous procure une grande réussite mais bientôt la concurrence se met à adopter votre propre recette de hot dog et voilà qu’il vous faut proposer autre chose au public. La tentation, la facilité, c’est alors de se présenter comme l’inventeur du véritable hotdog moutarde ; et pour varier la « recette », on innove et on lance… le hamburger à la moutarde.
Au tournant des années 2000, le cinéma découvre le numérique, les jeunes préfèrent les fantaisies ou les intrigues high-tech, et le public qui n’était déjà pas bien nombreux pour les films de Jimmy déserte les salles pour la télévision. Reste donc à James Gray de se lier à un système pour survivre : courir les festivals ou, à l’image d’un Steven Soderbergh, se laisser aspirer par les studios tout en prétendant rester indépendant. Jimmy semble avoir de plus en plus de mal à produire ses films et il finit par s’acoquiner avec des stars pour avoir une chance de lancer ses projets. C’est l’option de Soderbergh qui est alors choisie. Tout le monde est gagnant, c’est comme dans les milieux d’affaire où les contribuables paient quand les financiers et les donneurs d’ordres trinquent (au sens littéral). D’un côté les stars ont tout intérêt pour leur carrière, leur respectabilité, à tenir parfois à bout de bras des films susceptibles de concourir aux Oscars et non au box-office (il y a un temps pour tout), et de l’autre, le réal a besoin d’eux pour continuer à faire des films en se laissant corrompre par le moins mauvais des systèmes — c’est ce qu’est être un “vendu” selon Jimmy, mais Jimmy le dirait sans doute autrement. Même les indépendants ont leur système, et les seuls misfifts qui existent, ce sont toujours ceux qu’on ne voit pas, ou plus.

Voilà, peut-être, comment James Gray peut en venir à proposer à son public, vingt ans après ses débuts, un film d’aventures. Non, James Gray ne s’est pas converti aux sirènes des gros marchés, ça ne peut être qu’un film d’aventures à la sauce Jimmy Gray. Un véritable film de James Gray. Autant dire que Damien Chazelle (ce jeune vieux) pourrait proposer une comédie musicale, que ça resterait un film de Chazelle, que Scorsese pourrait réaliser un film pour enfant que ça resterait un film Scorsese, que Spielberg pourrait adapter Hergé que ça resterait un film Spielberg… On est au pays où tous les rêves peuvent devenir réalité, si bien que dans l’imaginaire américain, même les losers ont tenté leur chance (au loto), et certains ont fini par réussir. James Gray peut donc suivre la tradition de l’antihéros américain (même si son personnage ne l’est pas), car un loser qu’on présentera dans un film d’aventures comme un gagnant, peu importe, on s’en moque, l’important c’est bien que ça reste un film… James Gray. Et à la longue, à défaut de pouvoir dire que Jimmy est un génie, on pourra toujours lui faire dire : « L’antihéros, c’est moi ! »
Les histoires du cinéma adorent leurs renégats, leurs losers magnifiques.
Et c’est bien le problème. Gray est-il plus un cinéaste médiocre avec de hautes ambitions ou un loser génial à la Coppola, Erich vont Stroheim ou Welles ?

Jusqu’à The Immigrant, je dois avouer que j’étais plutôt séduit, convaincu, presque béat devant le peu de nuances qu’offrait le cinéma de Gray. Les stars incorporées semblaient encore tenir la route dans The Yards ou dans La nuit nous appartient. Il restait une forme de logique dans les projets de Jimmy, il ne se laissait pas corrompre par un système qui n’est pas le sien, il tenait bon, la route… et l’aventure, il semblait la fuir et se satisfaire de ses études de mœurs vues désormais à la TV. Et puis, que fait-il depuis deux films ? Des fresques. Une dramatique et historique pour The Immigrant ; épique, historique et biographique ici avec The Lost City of Z. En changeant de registre, James Gray s’est mis en danger… Une nécessité pour tout cinéaste passé vingt ans de carrière à produire les mêmes joujoux. Mais il a aussi pris le risque que les défauts de son style (quand on aime, certains de ces défauts peuvent devenir des qualités) apparaissent comme des « trucs », des facilités, auxquels le spectateur sera de moins en moins sensible. Il faut parfois reculer… pour tomber. L’excursion vers des genres nouveaux pour le vétéran en quête de nouveauté, comme pour tout artiste qui n’aurait plus rien à dire mais qui se verrait poussé par la nécessité de l’ouvrir, eh ben c’est toujours l’option la plus facile. La prise de risque passe alors par un assujettissement à un système qui n’est pas le sien, un travestissement léger de « son style » mais aussi du « genre » en question comme s’il y avait une vertu naturelle à sillonner à l’écart des usages ou entre les lignes.
Est-ce que l’exercice de style, l’audace bercée au rocking-chair, convainc au moins ?

Ce serait plutôt non. Si on enlève le savoir-faire, l’exécution, sans quoi le film ne serait pas plus satisfaisant, reste peu de choses. Ni divertissant ni enthousiasmant sur quelque plan que ce soit. Parce qu’il manque l’élan, la nécessité, la fraîcheur, la vie. Parce qu’à tous ces cinéastes confirmés qui disent avoir des difficultés à monter des projets « personnels », arrêtez de nous la faire : vous n’auriez aucun problème à monter des projets à trois francs six sous comme vous l’aviez fait avec vos premiers films, et c’est bien parce que vous cherchez à vous exiler dans vos jungles, à vous dresser au-dessus d’impossibles projets pharaoniques, à vouloir monter vos éléphants blancs, qu’aucun producteur et distributeur ne peut vous prendre au sérieux. C’est le paradoxe : pour convaincre à nouveau, le cinéaste vétéran en plein doute pense qu’il devra s’éloigner de son cinéma pour en proposer un autre, toujours plus épique, plus lourd, supposément plus ambitieux. Mais tout le monde n’est pas Cecil B. DeMille. Un bon film se passe bien souvent de grandiloquence. Un bon film, c’est avant tout un bon sujet. Une bonne histoire. Et les bonnes idées ça ne coûte pas un kopeck à une production. Les meilleurs cinéastes l’ont toujours compris. Et ç’a toujours été des risques qu’eux pouvaient se permettre.
Il y a des cinéastes qui sont à l’aise à filmer des ongles de pieds dans des boîtes à chaussures et il y en a d’autres qui ont des aptitudes pour filmer les grands espaces, les envolées lyriques, les grandes trajectoires épiques avec une maîtrise sans faille de la narration. Jimmy Gray pourrait maîtriser tout ça, en vrai, mais sans grand génie. Pas ici. Pas encore. Surtout, il n’est jamais aussi meilleur que dans une seule chose, qui peut faire illusion dans des petits films c’est vrai, c’est quand il crée des ambiances sombres, lourdes, dans lesquelles il peut noyer ses personnages, souvent perdus, au sein même de leur propre monde. Dans la reconstitution aussi, James Gray sait y faire… Rien à dire ici sur tout ça. Là où Gray se noie en revanche, c’est dans le traitement des personnages car l’obscurité habituelle de ses films ne devient plus ici qu’un accessoire, un code ou une patte personnelle qui perd tout son sens dans un tel projet. Avec tout ce fric dépensé sur un territoire qui n’est pas le sien, Gray est incapable d’insuffler de l’énergie, de l’absurde, de l’ironie, du lyrisme à cette histoire. D’abord, parce que contrairement à ce qu’il aurait sans doute cru au départ, son sujet en est dépourvu. Le côté loser du personnage, c’est lui qui veut le voir ainsi : le sujet ne s’y prête pas au départ. L’explorateur dont il raconte l’histoire n’est pas un rigolo, ce n’est pas parce qu’on ne trouve rien qu’on est un loser. Pour un explorateur qui reviendra avec des découvertes d’importance, il y en aura cent autres qui auront moins de chance. Si ceux-là n’existaient pas, celui qui reviendra, lui, avec quelque chose n’existerait pas plus — Gray tombe dans une vision un peu simpliste, et pardon « américaine », du succès, qui est de croire qu’il y a des gagnants et des perdants (des gars de l’ombre participent non pas à ce que d’autres gagnent à leur place mais à ce que tout le monde gagne : le Graal, c’est la connaissance partagée par tous, pas la gloire d’un seul homme). L’idée de mettre en scène un loser pourrait par ailleurs passer si son acteur ne jouait pas une tout autre partition que celle prévue par le cinéaste.

Il y a toujours un danger à raconter une épopée ratée. Le loser finit peut-être parfois par être celui qui tente de le mettre en scène. S’il y a une forme de réussite dans la grandiloquence absurde d’un Fitzcarraldo, on voit surtout ici une épopée boursouflée de l’inutile, grandiose non pas par l’absurdité de sa quête ou par l’obstination de son personnage principal (les losers, au moins depuis Don Quichotte, ont toujours fasciné) mais bien ridicule par l’ambition vaine et sans grande cohérence du cinéaste qui la met en œuvre. Non, Fawcett n’est pas un loser.
Après, comme Gray le dit lui-même, on pourrait laisser au film le bénéfice du doute et le regarder pour autre chose qu’une épopée de l’inutile (je ne l’ai pas vu comme ça d’ailleurs — d’où le danger d’assurer le service après-vente et de s’autoriser à « expliquer » ce que le public se plaît toujours mieux à faire). Gray termine son film d’ailleurs par des indications bienveillantes à l’attention de son personnage principal, disant en gros que Fawcett n’était pas en quête que d’un mirage… « Je fais un film sur un loser, mais en fait, non, ce n’est pas ça, ce n’en est pas un, la preuve : on a trouvé des traces d’une civilisation perdue sur les lieux mêmes où l’explorateur situait sa cité… » Faudrait savoir Jimmy. C’est un loser ou ce n’en est pas un ?

Alors d’accord, Gray se dit très concerné par l’idée de peaufiner son récit. Pourtant, tout ce qui apparaît justement dans son film, c’est que son histoire ne tient pas la route et/ou qu’il est incapable de nous la présenter telle qu’annoncée (il le dit en interview, ses films n’ont jamais été compris de la manière que lui les avait écrits). James Gray voudrait y voir un personnage enfermé dans l’étroit costume que d’autres auraient taillé pour lui ; je n’y vois aucun personnage assujetti au regard des autres ou de sa condition, de son rang. Je n’y ai vu qu’un cinéaste prisonnier des pièges habituels des « histoires vraies » ou des biographies au cinéma, dont la plus grossière est celle qui consiste au respect presque dévot de « l’histoire » et de ses « grands (ou petits) hommes ». Une quête qui s’avère souvent n’être qu’un mirage pour nombre de cinéastes, et qui bien souvent tourne à l’hagiographie la plus simple, si ce n’est au classicisme vide et pompeux. J’y ai vu aussi un acteur principal (plutôt médiocre d’ailleurs) délaissé par son metteur en scène et qui cherchait à jouer de son autorité forcée (oxymore) comme n’importe quel type qu’on a préféré aller chercher dans l’équipe de football du lycée plutôt que dans le club de théâtre, tout ça pour le plaisir de parader et de jouer les héros en Amazonie. L’idée d’absurde et de héros zéro suggérée après coup par le cinéaste aurait pu être là, tendre vers une forme de bêtise héroïque telle que dépeinte dans Starship Troopers ; mais manque à cette interprétation un côté matamoresque, ou une fragilité, qui annoncerait déjà cet échec. Il faut à ce type de récit une part d’inéluctabilité qui, si elle manque au départ, peine à convaincre par la suite. Ce parti pris aurait été de toute manière tellement loin de l’univers et des tonalités habituelles de Gray, qu’il nous aurait été difficile d’y croire. La démesure d’un Herzog, l’absurde des Coen ? Non, je pense Gray en être incapable. Rien ne laisse ici penser le contraire en tout cas.
Résultat, le film se regarde au premier degré, comme une aventure exotique, échouant à la fois à nous satisfaire dans ce qu’elle aurait pu nous procurer d’épique, mais aussi et surtout à nous convaincre dans l’exercice difficile du film de loser. Une sorte de Barton Fink d’Amazonie, c’est peut-être ce qu’aurait voulu en faire James Gray, sauf que Charlie Hunnam, sans être la star des films précédents, n’est pas un acteur conforme à l’ambition de Jimmy. Pour ce qui est du récit, ou de la manière dont est racontée cette « histoire vraie », tout est ampoulé, vite expédié. Tout est certes joliment montré, mais toujours trop soigné, trop bien exécuté, et surtout trop bien fait dans les règles ou dans le style, celui qu’on attend de Gray quand il filme cinquante personnages dans une boîte à chaussure ou un seul sur un trottoir humide à contempler dans la nuit l’orteil d’un autre (ah non, ça, c’est le prochain Lynch).
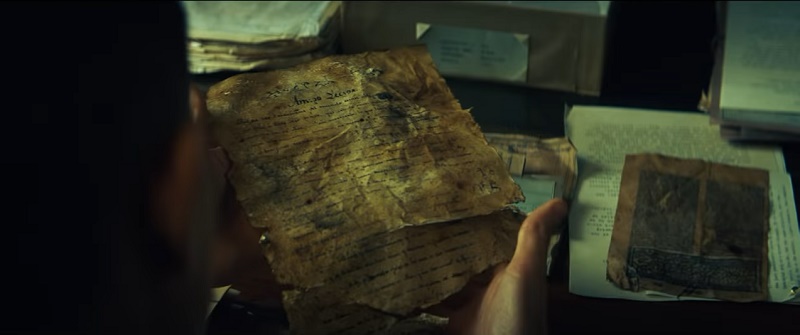
Car manque à tous ces cinéastes embourgeoisés, bien souvent, l’irrespect. L’irrespect des conventions, de ces conventions qu’ils ont souvent réussi à bousculer lors de leurs premiers éclats. Parfois on se répète en se focalisant sur des petites évidences qui laissent penser au final qu’une histoire et que la manière dont on tâche de la mettre en œuvre, ne fait qu’enfoncer des portes ouvertes ; d’autre fois, et c’est plus rare, on se répète avec la même brillance. Parce que les génies peuvent dire cent fois la même chose sans tomber dans la facilité. La pertinence et l’à-propos des grands auteurs. Ce n’est pas la répétition qui pose problème, c’est la fadeur de ce qu’on dit. Le confort, la convention. Le respect. Il y a ceux qui suivent les courants, finissent par les rejoindre, et il y a ceux qui ne cesseront jamais de les prendre dans le mauvais sens, et à raison, non pour faire différemment des autres, mais parce qu’il se trouve que c’est là qu’il y a quelque chose à dire et à creuser.
Quand on adapte les histoires des autres, quand on se réfugie derrière l’argument confortable des faits pertinents car historiques, quand on se lance dans un projet qu’on ne sait soi-même s’il est poussé par une envie de plaire à un plus grand nombre ou si on tient à rester en marge, quand on accepte d’aller à la facilité dans le casting pour s’assurer l’aval des distributeurs et du public (avec la satisfaction trompeuse de ne s’être pas compromis jusqu’au cou en n’ayant pas impliqué les plus grosses stars du moment), eh bien on maîtrise moins son sujet, on se repose sur ses acquis ou sur des procédés qui assurent peut-être une certaine visibilité au film mais qui lui interdit tout génie. Les acteurs correspondent moins aux personnages qu’on a en tête, on se passionne moins à leur direction parce que des acteurs reconnus sont censés être… professionnels et être capables de sentir la situation ou la logique d’ensemble d’une histoire… Oui, après des années de travail, après un retour critique qui n’a jamais cessé de remettre en question nos capacités à mettre en scène les sujets qu’on sortira au hasard de la hotte, on tombe dans la facilité, on en vient à penser, comme le personnage de Robert Pattinson auprès duquel Fawcett revient plusieurs années après leur première expédition pour lui proposer de repartir : « À quoi bon prendre des risques, on est si bien chez soi ? Comment ? ma barbe ? mais c’est une barbe de respectabilité et de sage, non d’aventurier. » Oui, quand on gagne de l’autorité, et qu’on parvient à réunir des équipes censées être responsables et créatives, on cède à la facilité, aux certitudes, et chacun est tellement bien à sa place, tellement performant, tellement loin de ses zones d’inconfort, à quoi bon faire des efforts et regarder si tout le monde est à l’unisson, si quelqu’un ne propose pas quelque chose d’innovant ailleurs, si ce qu’on fait tient vraiment la route… À quoi bon ? Si on tient Darius Kondji, à quoi bon lui demander de faire autre chose que ce qu’il a toujours fait ?… À quoi bon ? La respectabilité, on l’a. Et les losers, ce sont les autres. Ce sont ceux qui prennent des risques et qui disparaissent dans la jungle. Celui-là, c’est l’autre, celui qu’on ne voit jamais. Au mieux, c’était celui qu’on a été en commençant dans le métier, parce que pour se faire remarquer de la Royal Cinematographical Society, il faut bien en prendre des risques, il faut bien affirmer son style par rapport aux autres… Alors, non, pour rien au monde, on ne tenterait d’hypothéquer tout ce crédit. On s’assied sur la pyramide et on regarde si on vient nous y bousculer. On respecte pharaon, ne prenons pas le risque d’écorner cette image. Et on se répète, on reproduit les certitudes d’autrefois, on creuse son sillon, et on se laisse envahir par le confort des habitudes. Puis, le prétexte pour se donner l’illusion qu’on est encore capable d’audace, ce sera de changer de « genre », de monter des projets « ambitieux ». Pour ces cinéastes installés dans leur confort, « ambitieux » ne veut plus dire que « colossaux », des Pacific Rim sans robots, parfaitement personnels, des éléphants blancs qui profiteront à tous, bref… « coûteux ». Et ce sera toujours l’argent des autres. Explorateurs comme cinéastes lèvent des fonds pour satisfaire leurs petits caprices, leurs certitudes ; et leur échec, s’il est personnel, fera au moins leur richesse alors que d’autres se ruineront pour eux. Le loser magnifique, il est là, pas sur pellicule. C’est un loser qui gagne toujours à la fin. Alors oui, c’est cet escroc qu’il faudrait mettre en scène, pas l’explorateur qui peut, aussi par ses échecs, faire avancer les connaissances. Ne pas trouver, c’est aider à ce que d’autres puissent le faire, ailleurs, en d’autres temps, en d’autres circonstances, alors que l’escroc n’est pas capable d’un tel sacrifice : l’escroc doit vivre, respecter son rang, s’asseoir dans sa boîte avant de rejoindre une autre plus grande qu’il aura fait construire par d’autres. L’escroc contre le loser, la voilà l’opposition. Digne d’un film d’antihéros.

Alors, la lumière, l’espoir dans tout ça ?… « On va la faire sombre et un peu orangée, c’est ce qui a toujours bien marché dans mon cinéma. Et Darius est là. — Oh, pardon… de quelle lumière vous parliez déjà ? »
Quand Gray insiste sur l’incapacité de ses personnages à sortir des boîtes dans lesquelles la société se plaît à les y enfermer, il a raison et ça ne concerne pas seulement ceux de son film. Un cinéaste qui veut « produire », se doit de faire des films comme un explorateur se doit d’aller au bout de son idée quitte à tout perdre. Mais un cinéaste doit aussi reconnaître l’environnement dans lequel il est à l’aise et apprendre à se renouveler dans ce cadre. Il y a toujours des exceptions, et j’attends la suite pour Jimmy, mais l’épopée qu’il semble vouloir adopter pour ses deux derniers films ne me paraît pas convenir tout à fait à son style et présager en tout cas de bien enthousiasmant pour la suite. Il y a peut-être comme chez Cassavetes une sorte d’épopée de l’âme dans les premiers films de Gray concentrés dans des environnements beaucoup plus restreints. Ici, Gray a perdu le fil et semble avoir oublié l’essentiel, la carte qui impose à tout raconteur d’histoire de suivre un parcours clair et bien défini pour son personnage principal. Dans l’interview accordée à la Cinémathèque en fin de projection, James Gray faisait la distinction entre ce qui est « vague » et « ambigu. » Une histoire doit être ambiguë pour questionner le regard, l’intelligence, tendre l’attention du spectateur. J’ai peur que James Gray soit beaucoup plus ici vague qu’ambiguë, en particulier dans la définition de ses personnages. Il y a la question claire de la quête bien sûr, mais pour le reste, rien. Le cœur du problème il est bien là : ce sont ces définitions, ces trajectoires, qui donnent de la chair, de la cohérence (parfois à travers les incohérences ou les… ambiguïtés d’un personnage) à une histoire. C’est un principe d’identification auquel aucun raconteur d’histoire ne peut échapper. Qu’a-t-on ici en guise de présentation pour exposer notre héros ? Une chasse à courre qui sera plus pour James Gray l’occasion de proposer à son public une scène d’action pour le happer à son siège en commençant son film plutôt que des séquences servant de départ à une psychologie en mouvement, de mise en route d’une personnalité avec ses contradictions, ses aspirations. L’appel de l’aventure, qu’on dit… Et l’aventure, si Fawcett la voit d’abord ailleurs, c’est bien la trajectoire de ses hésitations qui est mal rendue, un peu comme si on condensait les aspirations d’un Lawrence d’Arabie et son attrait presque naïf pour le désert en dix minutes et qu’on passait le reste du film à en faire un illuminé magnifique et capricieux… Un personnage évolue, et le rôle du metteur en scène est bien de souligner, mettre en évidence, ces trajectoires, parce que l’aventure à suivre pour le spectateur, les sinuosités narratives du long fleuve dramatique, il est là, pas dans l’exotisme ou la seule finalité d’une quête. Le loser ne l’est pas dans l’inaccomplissement de sa quête, mais bien dans la manière de la mener. Peu importe qu’il réussisse au final, car l’échec, c’est avant qu’il faut le trouver.

Le sujet, pour ce que cherchait à en faire Gray, était sans doute déjà mal foutu (c’est le problème trop souvent des « fables » héritées d’histoires vraies), mais le cinéaste s’est montré incapable de le tordre pour l’adapter à ses désirs. En plus de ça, sa direction d’acteurs n’est pas à la hauteur, avec des interprètes ne donnant jamais rien de plus qu’attendu dans un tel film « d’aventures » : un homme forcément vaillant, aidé des siens, qui lutte contre des opposants multiples, forcément tous incapables de comprendre les enjeux cachés derrière sa formidable quête… Bel exemple de ton sur ton, car le sujet est là, et Gray et ses interprètes ne donnent rien de plus que ce qu’il annonce. Le sous-texte dont parlait Gray n’apparaît jamais dans son film. Et c’est bien ce qui lui manque.
James Gray est après vingt ans un élève modèle toujours aussi respectueux des bonnes règles à suivre. Il est au premier rang et rares sont ceux qui oseront l’y déloger.
Classique. Mais pour combien de temps.




















 Année : 2017
Année : 2017

 Année : 2017
Année : 2017