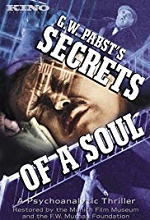Les Chagrins de Satan
Titre original : The Sorrows of Satan
Année : 1926
Réalisation : D.W. Griffith
Avec : Adolphe Menjou, Ricardo Cortez, Carol Dempster
Une confirmation : il y a les pionniers qui, un jour, ont la bonne idée et font décoller une pratique nouvelle, mais une fois que cette pratique commence à mettre en œuvre ses propres codes, c’est souvent une nouvelle vague de pionniers, moins techniciens, plus artisans ou artistes, qui prennent le relais. Griffith est à l’origine de la popularisation de l’idée qui résume peut-être à elle seule la révolution du récit cinématographique : le montage alterné. Il n’est pas le premier à l’avoir pratiqué, mais il a été le premier à en avoir compris l’efficacité sur le public et à faire reposer ses films principalement sur lui. Depuis plus d’un siècle, il est rare de voir un film se passer de ce procédé si représentatif de sa pratique (on trouve peu d’exemples d’un tel procédé en littérature par exemple, et au théâtre, Shakespeare y avait souvent recours, notamment dans Richard III ou dans Le Marchand de Venise, mais on ne peut pas dire qu’on associe le dramaturge au procédé). Dans les années 10, Griffith a longtemps été à la pointe. Le fait qu’il ait une longueur d’avance sur tous les autres lui a permis de capitaliser sur cette avance et proposer au public au milieu de la décennie des grosses productions qui assureront son succès. Puis, après-guerre, les pionniers ont laissé place aux génies. Moins d’innovations ; plus de compétence en mise en scène et en récit. Seul Chaplin avait été à la fois pionnier (aussi dans le montage) et génie artistique. Une fois que les concurrents de Griffith ont adopté le montage alterné, sans en abuser comme dans certains films faciles à faire (comme les westerns), ils ont pu proposer autre chose. Surtout, les failles et les limites créatives de Griffith, tant dans le récit qu’à la mise en scène, se sont faites de plus en plus évidentes.
C’est ce qu’on voit ici. Le sujet est une resucée du mythe de Faust comme il en existe des centaines à la même époque (l’année du Faust de Murnau). Alors que le montage alterné s’était surtout révélé pertinent dans les thrillers ou les films d’action, Griffith l’utilise ici pour un genre qui vit ses dernières heures avant l’arrivée du cinéma parlant qui goûtera peu ses outrances et son manque de vraisemblance : le mélodrame (il sera remplacé par les drames romantiques souvent historiques — le mélodrame étant presque toujours contemporain incorporant, comme ici, une dimension plus universelle, grossière et biblique). Le montage alterné pourrait s’appliquer à tout, on pourrait dire, sauf que si c’est en effet assez souvent exact, il n’en reste pas moins que le procédé ne pourra jamais dynamiser artificiellement une histoire sans relief qui ne décolle jamais. On comprend la logique de départ de Griffith : opposer deux personnages (deux écrivains sans le sou amoureux l’un de l’autre) enfermés chacun dans leur chambre avec l’idée insoutenable (non) qu’ils puissent être réunis. Ce qui marche pour un thriller de dix minutes ne peut pas marcher dans un premier acte. C’est bien trop tôt. Une présentation doit servir à poser les bases d’un récit, pas à créer une tension entre deux personnages pour lesquels on ne s’identifiera par conséquent jamais. Griffith ne sait pas raconter une histoire comme d’autres à la même époque (même pour des mélos) et le montage alterné ne peut plus tout résoudre ou contenter le public habitué à en voir. Si son prologue biblique est visuellement réussi, dès qu’on retombe sur terre avec les deux personnages principaux, Griffith rate complètement leur introduction et Griffith s’enlise en ne parvenant pas à sortir de la logique statique mise en place. Habituellement, dans une présentation de personnage, et cela dans tous les genres narratifs, l’action qu’on choisit de raconter définit au mieux les personnages, leurs désirs, leur parcours. Si l’idée de montrer les deux à leur table de travail peut faire sens, les cantonner pendant toute une longue première partie résumant une seule et même journée enfermés dans les mêmes lieux n’aide ni à donner un élan au film, ni à définir les personnages principaux (on se définit par nos actions, voire par nos intentions, et dans ce cas, le récit évolue à travers les conflits, les oppositions, les révélations successives comme dans n’importe quel huis clos). Adolphe Menjou, censé proposer le pacte avec l’écrivain sans succès et lancer véritable l’intrigue, arrive trop tard alors qu’on s’est déjà endormis. La suite est tout aussi laborieuse. Il ne se passe pas grand-chose ; Griffith donne l’impression de meubler dans un récit qui fait du sur-place ; et en dehors du génie d’Adolphe Menjou, capable d’exprimer avec la plus grande simplicité n’importe quelle note (souvent ironique, toujours classe), tout le reste est terne et sans intérêt.
La fin intègre maladroitement quelques nuances visuelles inspirées de l’expressionnisme, et je crois ne pas avoir aperçu une seule fois un coin de ciel en une heure et demie de film (ou de réalité ; je crois même avoir reconnu le décor d’une rue du Lys brisé) ; signe qu’en dehors des problèmes de récit, en ce qui concerne la contextualisation, Griffith ne répond plus aux standards attendus de l’époque (ailleurs, à Hollywood, on tourne largement en studio et « in location », histoire de donner du souffle au récit et… d’alterner pour reproduire l’illusion d’une réalité — intérieur/extérieur). On se demande bien qui a eu l’idée saugrenue d’aller en Californie pour profiter de la lumière, vraiment, je ne vois pas…
1926, on réalise des chefs-d’œuvre toujours plus convaincants partout dans le monde avant que le son rebatte complètement les cartes, mais Griffith n’est déjà plus à la page depuis une demi-douzaine d’années. Il continuera pourtant à proposer quelques films au public, aujourd’hui oubliés.
Les Chagrins de Satan, D.W. Griffith (1926) The Sorrows of Satan | Paramount (copie impénétrable)