
Tempête à Washington
Titre original : Advise & Consent
Année : 1962
Réalisation : Otto Preminger
Avec : Franchot Tone, Lew Ayres, Henry Fonda, Walter Pidgeon, Charles Laughton, Don Murray, Peter Lawford, Gene Tierney, Burgess Meredith
Il y a donc une époque durant laquelle aux États-Unis les secrétaires de département (l’équivalent des ministres) se faisaient nommer et devaient ensuite montrer patte blanche devant une commission d’investiture dirigée par le Sénat (il est question ici de valider la candidature du secrétaire d’État chargé de la politique étrangère). C’est tellement plus exotique que de promouvoir prosaïquement les grands financiers de sa campagne et de se servir du Sénat comme d’une simple chambre d’enregistrement…
Le passé comme ennemi
Sur le plan institutionnel, la leçon est d’importance. L’éclairage apporté concerne aussi certains usages de la petite politique américaine (le genre d’usages que les partis finissent par dévoyer à des fins différentes de ce pour quoi ils ont été créés).
L’événement censé être anodin d’une validation de candidature prend des proportions plus imposantes qu’attendu face d’abord aux conséquences et aux enjeux de la situation internationale (on est au tournant de la nouvelle décennie, et même si le roman initial évoque une autre période, ce début des années 60 est marqué par des tensions accrues avec l’Union soviétique, l’envoi de Spoutnik et de Gagarine dans l’espace, la bombe nucléaire qui commence à proliférer dans le monde, etc.). Mais c’est surtout ensuite le passé communiste supposé du personnage incarné par Henry Fonda qui sera la pierre d’achoppement compliquant sa nomination au poste de secrétaire d’État. Cet aspect obsessionnel renvoie aux années noires du maccarthysme. L’époque ayant changé, l’enjeu de cette nomination oppose deux logiques peut-être absentes du roman : le risque de l’infiltration et le pragmatisme d’un secrétaire d’État capable d’éviter la guerre. Preminger, aidé de son scénariste, a sans aucun doute permis de poser un regard beaucoup moins caricatural, plus incertain et plus cynique sur les enjeux et les préoccupations parfois paranoïaques entourant cet événement.
Il est suggéré que l’auteur du roman, jamais marié, aurait pu être homosexuel. Or, au passé trouble du candidat, s’ajoute un jeu d’influence qui finit en chantage impliquant le président de la commission de candidature : il n’est alors plus question d’accusation de communisme, mais d’homosexualité. Le passé comme ennemi. J’ignore la manière dont à la fois les communistes et les homosexuels sont dépeints dans le roman de cet auteur conservateur lui-même suspecté d’avoir été secrètement homosexuel ; il est certain en revanche que Preminger les traite comme des victimes. Au pire, le spectateur américain de l’époque pourra y voir des repentis.


Rôle de la mise en scène
C’est tout le rôle de la mise en scène qui se pose ici. Réaliser un film, ce n’est pas que placer sa caméra ou choisir des acteurs, c’est aussi lui conférer la direction vers laquelle aller quant à l’interprétation des personnages et à la couleur à donner aux enjeux du film. Je suis en train de lire Les Tommyknockers de Stephen King. Vers la fin du roman, la sœur du personnage féminin principal vient à sa rencontre parce qu’elle refuse de donner des nouvelles alors que leur père est mort. Un peu à l’image d’un Hitchcock dans Psychose, King passe une longue période à décrire son personnage avant de s’en débarrasser. À la lecture, la sœur est imbuvable. C’est pourtant dans ses excès qu’il est réussi. Odieux, haut en couleur, tandis qu’on se délecte de ses agressions verbales et de son tempérament volcanique dans le roman, il pourrait faire l’objet dans une adaptation d’une des pires représentations de la femme acariâtre à l’écran et aurait toutes les chances de dégoûter le spectateur. Il y aurait pourtant un moyen de lui faire « passer la rampe ». Au théâtre, on apprend aux jeunes acteurs à défendre coûte que coûte leur personnage, quel qu’il soit. Rendre sympathique, éclairer un caractère est loin d’être un caprice de star qui s’efforcerait de ne pas froisser son image auprès du public. Cherchez les films que vous appréciez avec des personnages imbuvables. Les méchants, les salauds, les tyrans doivent exercer une certaine fascination sur nous à l’écran. On aime Richard III, on aime Joe Pesci dans Les Affranchis, on aime Dark Vador. Le tempérament de cette sœur odieuse chez Stephen King doit être préservé, mais l’interprétation doit aussi la sauver de la médiocrité, de l’excès et de la caricature. Sans chercher à en faire un personnage de comédie, le but consistera à trouver un entre-deux qui attire le regard du spectateur, l’intrigue, comme le personnage de Patty intrigue dans La lune était bleue.
Comme tous les bons cinéastes, c’est ce vers quoi tend Preminger dans ses meilleurs films et en particulier ici dans Tempête à Washington. Qui pourrait croire que le candidat à l’investiture pour le département d’État joué par Henry Fonda puisse faire preuve de déloyauté envers son pays ou être un homme malhonnête le rendant inapte à la fonction ? Les actions passées sont une chose, comme les mensonges sous serment. La sincérité, en est une autre. Non, en voyant ce que font Preminger et Henry Fonda de cet homme, impossible de lui imaginer de mauvaises intentions. Il y a une scène magnifique (probablement pas dans le roman) dans laquelle le candidat semble parti pour faire la leçon à son fils. Oui, il a menti et ce n’est pas bien. Pourtant, dans certaines situations, et en cas de force majeure (quand il en va de l’intérêt supérieur de l’État), cela devient nécessaire. Il faut cependant accepter humblement les conséquences éventuelles de ces actes. (L’argument ouvre toutefois droit à toutes les justifications… de la part des pires crapules, mais disons qu’ils auront moins de scrupules à user de ce discours et seront moins enclins à faire profil bas.)

Roman/mise en scène
Il aurait été si simple de faire du candidat le pourri de l’histoire et gageons que dans le roman, la perception du personnage est tout autre. Si Henry Fonda échappe au déshonneur d’un personnage ayant flirté avec le communisme, le rôle du pourri de l’histoire revient à un des seuls acteurs capables de jouer autant les comédies que les drames, de jouer les entre-deux indéfinissables et de rendre sympathiques, truculents, les pires salauds possibles : Charles Laughton.
Le sénateur de Caroline du Sud interprété par Laughton tire les ficelles, s’immisce dans la commission d’investiture en fournissant des éléments à charge contre le candidat : aujourd’hui, on dirait qu’il trolle. Mais il ne trolle pas sans atouts dans sa manche. Il y a fort à parier que dans le roman initial, il soit présenté de manière positive par l’auteur, comme une sorte de garant de la moralité et des valeurs républicaines face à ces dégénérés de communistes.
Le roman semble en revanche, malgré ses aspirations conservatrices, adopter le regard positif et bienveillant qu’emploiera Preminger pour le candidat au passé communiste sur le président de la commission, victime, lui, de chantage : son passé n’est plus communiste, mais homosexuel.
Le récit décrit efficacement l’aliénation et le dilemme auquel sont condamnés les homosexuels, emprisonnés derrière les murs du secret. Le message est limpide : ces hommes forcés de taire leur orientation sont les victimes des intolérances de la société, pas des pervers. Si l’homme politique finit traumatisé par l’éventuelle révélation de son homosexualité, c’est qu’il a organisé toute sa vie professionnelle et familiale autour d’un mensonge. Il se mentait plus à lui-même qu’aux autres. Difficile de jeter la pierre à un tel personnage. (Par ailleurs, les brèves apparitions d’homosexuels dans le film évitent également la caricature : pas de cage aux folles ici.)
Chaque camp semble ainsi agir comme de véritables chefs de la mafia pour faire céder leurs opposants, avec chacun ses coups fourrés : accusation d’un passé communiste pour l’un, chantage à la révélation d’un passé homosexuel pour l’autre. Elle est jolie la politique. On se croirait presque dans du Shakespeare.
Plus que jamais, mettre en scène, c’est faire des choix, définir des orientations. Et paradoxalement, c’est aussi insister sur une forme de juste milieu ou d’indécision. Cela consiste donc ici à « défendre » tous les personnages. Anciens communistes comme homosexuels.
Dans le film, notamment, le président semble moins coupable que dans le roman : on souligne plus le fait qu’il est fatigué (alors qu’il vient d’être élu ?) et qu’il s’attache obstinément à la nomination de l’homme qu’il pense être le plus qualifié pour le poste (dans le roman, il semble clair que l’auteur voit ce président libéral comme une menace et un futur allier des Soviétiques, tandis que dans le film, c’est un choix rationnel pour nommer un homme capable d’éviter une escalade en période de guerre froide). L’instigateur de ce chantage visant à faire céder le président de la commission implique ainsi plus volontiers un sénateur de la majorité décidé à passer en force pour faire accepter la nomination du candidat du parti (ou du président)…
Autre différence probable : la dernière partie du roman semble faire du vote une formalité en défaveur du candidat, alors que tout le suspense du film repose au contraire sur une égalité et un twist mettant fin à la procédure de désignation. (Si dans le roman, le président ne meurt pas, ce serait une légère incohérence à noter dans l’adaptation. Même si l’on a vu depuis qu’élire des grabataires à la Maison-Blanche n’avait rien d’exceptionnel.)
Sur la forme, je ne serais pas loin de penser que Preminger a initié, malgré lui sans doute, une esthétique, un type de récit qui donnera la décennie suivante les films paranoïaques ou les thrillers mettant en scène des journalistes ou des hommes politiques, à commencer par Point limite, encore avec Henry Fonda, ou par Sept Jours en mai. La multiplicité des décors, le passage rapide d’un lieu à un autre, l’absence de personnage central, tout cela donne au drame un rythme particulièrement haletant. L’histoire serait basée sur la perte d’une aiguille à tricoter dans une série d’hospices qu’avec un tel entrelacement d’événements se répondant les uns aux autres d’une séquence à l’autre que l’on regarderait sans broncher.
La réussite de Preminger face à Lumet ou à Frankenheimer par exemple, c’est sa capacité à tourner simplement dans des décors naturels. Pour sortir des bureaux où se trament le plus souvent ces histoires politiques, il faut être un champion pour trouver les meilleurs coins possible et les justifier avec des lignes de dialogues. Et si, quand on vient réunir tout ce monde dans des pièces en intérieur, on s’arrange pour trouver la meilleure scénographie à tout cela, le spectacle est assuré malgré l’austérité supposée du sujet. (En même temps, qui irait prétendre que les pièces de Shakespeare souffrent de sujets trop austères ?)

Les 4 dimensions de la mise en scène
Voilà qui me fait dire qu’il y a quatre dimensions à la mise en scène.
D’abord, j’identifierai ce que je qualifiais autrefois spécifiquement de « réalisation », autrement dit, tout ce qui est lié à la caméra, l’aspect technique, la mise en lumière, le découpage technique, etc.
Dans cette ancienne qualification, la réalisation hardware s’opposait à la « mise en scène », censée être software : elle concerne tous les aspects mouvants, moteurs, acteurs au sein de la diégèse, par conséquent, la direction des acteurs et du sous-texte, la définition des actions autour de la scène principale, la détermination des enjeux secondaires, et les interactions de toutes sortes à l’intérieur et en dehors du champ.
Viendrait ensuite la scénographie (confiée à un art designer ou à un chef décorateur) : les cinéastes s’impliquent plus ou moins dans ce secteur, mais presque toujours, sauf dans un système de studio, ils se contentent d’avoir le dernier mot sur tout ce qui est en rapport avec le choix des décors intérieurs comme extérieurs, le choix des accessoires et leur utilisation par les acteurs ou dans le cadre.
Enfin, il conviendrait de mettre le « regard porté » à part : j’en parle plus haut, réaliser un film, c’est faire les choix consistant à donner les directions aux acteurs qui ne les enferment pas dans des caricatures, donner une patte personnelle, parfois humaine, cynique, amusée sur l’histoire mise en scène. C’est le facteur le plus subjectif et le moins identifiable. Certains peuvent identifier la patte d’un cinéaste, des motifs personnels, entre conjectures et fantasmes, on sait jamais ce qui appartient au cinéaste ou à celui qui le commente. Sans ce regard porté, pourtant, le cinéma n’est plus un art.
Voilà pour une définition personnelle du rôle de la mise en scène.
Parce que quand les critiques (ou les autres) parlent de mise en scène (ou de réalisation), on sait en définitive rarement de quoi l’on parle. Rester vague permet de brasser des évidences ou des concepts rassembleurs. Et quand on ne joue pas de l’effet barnum, on confond le « regard porté » avec les éléments de l’intrigue en prêtant au cinéaste des intentions qu’il n’a pas. Non, dans une histoire, la plupart du temps, même quand vous êtes le seul auteur, la direction que vous donnez aux événements contés reste limitée à ce que vous pouvez dire aux acteurs. Les enjeux sont déjà établis par une histoire, un scénario, et la morale suggérée par l’intrigue même ou par la direction d’un dénouement. De ce qu’un cinéaste peut alors transformer à sa guise pour que les événements portés à l’écran se conforment à ce que lui veut y voir quitte à changer des éléments de l’intrigue ou du scénario, on en sait, en général, peu de chose. Alors on suppute, et l’on a raison de le faire, mais il faut en admettre la portée limitée.
C’est ce que j’ai fait ici en ne m’interdisant pas quelques suppositions à propos des différences entre le roman et l’adaptation, en prêtant à Preminger des intentions qui pourraient ne pas être les siennes. Quand les divergences abondent entre un roman et son adaptation, et quand le réalisateur se trouve être le producteur ayant acheté les droits du livre, je crois qu’on peut s’autoriser à penser que Preminger est l’auteur d’une bonne part de la direction prise par l’histoire. La plupart du temps, critiques et cinéphiles ne disposent pas autant d’indices autorisant ce niveau d’audace interprétative…


Transparence
Pour finir, j’avais évoqué certains films de Preminger dans mon article sur l’histoire des transparences au cinéma. Preminger fait mieux que bien d’autres cinéastes. Il est réaliste, il y a assez peu de doute quant au fait qu’il se méfiait de ces séquences tournées en studio. De plus en plus. C’est même probablement pour échapper aux studios qu’il est venu tourner Bunny Lake a disparu en Angleterre. Un plan tourné dans un habitacle de Tempête à Washington m’avait échappé pour mon article. Le plan est très court.
Presque toujours, Preminger se limite à montrer les automobiles arriver dans des séquences avec un personnage qui en ressort pour vite se rendre à l’intérieur d’un bâtiment. C’est ce qu’il fait quand le président de la commission rejoint la boîte gay new-yorkaise. À une différence près : le cinéaste nous gratifie de ce plan rapproché très court semblant avoir été réalisé à la sauvette dans la rue (depuis l’habitacle ou l’extérieur). Il y a presque déjà du Haskell Wexler là-dedans. Une fraction de seconde si utile pour contextualiser l’ambiance d’une ville et une transition dans un récit. Une image prise sur le vif comme on vole une image dans un bar homosexuel au début des années 60…
L’Europe te tend les bras, Otto.
Mobile.
As-tu songé à dire « Au revoir, tristesse ? » Non. Alors, reviens.
Tempête à Washington, Otto Preminger (1962) Advise & Consent | Otto Preminger Films, Alpha Alpina
Sur La Saveur des goûts amers :
Listes sur IMDb :
Liens externes :



















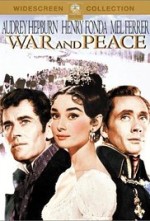








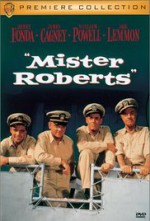
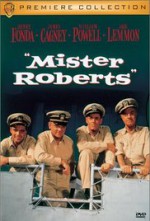 Année : 1955
Année : 1955