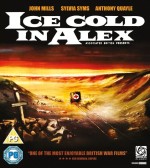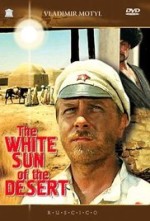Du grand art. On touche au chef-d’œuvre incontestable. Rien qui dépasse. Une histoire singulière. Un thriller mythique perdu entre deux dunes. Et une tension sans cesse maintenue par l’art exceptionnellement maîtrisé de la mise en scène (Prix du Jury à Cannes et Teshigahara en course pour l’oscar du meilleur réalisateur — une première, semble-t-il, pour un film étranger).
Jumpei est un maître d’école qui profite de trois jours de congé pour se livrer à sa passion, l’entomologie. Il rêve de trouver dans le désert une espèce inconnue qui fera sa renommée. Se retrouvant coincé à ne pouvoir rentrer en ville, un villageois lui propose de trouver quelqu’un pour l’héberger. On l’amène à une étrange bicoque perdue au milieu des dunes, plongée comme dans un trou et à laquelle on accède par une échelle rudimentaire. La « femme de maison » qui l’accueille ne quitte plus les lieux depuis que son mari et sa fille y ont été ensevelis et s’évertue depuis à lutter contre l’invasion du sable et l’extrême humidité qui rongent chaque jour un peu plus l’habitation.
Le lendemain, Jumpei se lève pour quitter son hôte mais l’échelle pour remonter à la surface du monde a disparu. Il comprend qu’il est tombé dans un piège et qu’il va devoir aider la femme à remplir des sacs pour le compte d’une coopérative de villageois qui revend ce sable salé, interdit dans le bâtiment, sur le marché noir (on fait la même chose aujourd’hui au Maroc…).



On comprend petit à petit. Pas beaucoup de dialogues. Très peu d’explications. C’est comme un puzzle qu’il faut réagencer au fil des informations qui filtrent. Lentement, comme le sable qui dégouline du toit, comme l’humidité qui remonte du sol… Tout le début est un mystère. Pourquoi la femme s’évertue-t-elle chaque nuit à libérer la maison du sable ? Que font les villageois de ce sable ? Mais l’essentiel (une fois que ce qui n’est pas loin d’être la base d’un thriller est lancé) ce sont les rapports entre les deux personnages. Lui, condamné comme un chien à rester tenu en laisse ; elle, acceptant sa condition d’esclave. Pour elle, rien n’existe en dehors de ce trou. Tout ce dont elle avait besoin, c’était d’un homme pour continuer sa laborieuse et absurde tâche (on retrouvera d’ailleurs la même idée, proche de l’obstination des dévots, dans Profonds désirs des dieux). Elle fait donc tout pour mettre à l’aise celui qui est appelé par les villageois, d’abord « son aide », puis « son mari ». Les parois sont infranchis-sables, friables. Plus il tentera de s’évader, plus il s’enfoncera. Il est comme perdu sur une île déserte, piégé tel Ulysse par les vents contraires, piégé par la nymphe Calypso qui le retiendra plusieurs années sur son île : sept ans, comme les sept années de disparition dont il est mention ici dans le dernier plan du film. Résigné, impuissant, réduit à la condition d’insecte.
Ils sont rationnés en eau, il faut donc apprendre à moins la gaspiller. Le sable s’incruste partout et irrite la peau. La pourriture aussi. Ce n’est pas seulement un trou, c’est une sorte de four humide. Une prison de sable capable de vous ensevelir à la moindre tempête ou tremblement de terre. Une véritable aventure et ce n’est qu’un huis clos.



Le caractère absurde de leur tâche rappelle le mythe de Sisyphe, condamné à monter un bloc de roche au sommet d’une montagne le jour de la marmotte. Pas loin non plus de Beckett, comme prisonnier de Godot. Huis clos prétexte à opposer deux individus, à les placer comme sous un microscope, façon big brother télévisuel, et attendre de voir ce qu’il se passe. Le pourquoi de leur présence dans cet enfer de sueur et de silice importe finalement peu et restera plus ou moins un mystère. C’est un peu aussi le sens de certains thrillers sadiques. Des Chiens de paille à Délivrance, en passant par l’Obsédé, voire Saw, Cube, les motivations des “sadiques” sont quasiment inconnues. Voire gratuites. Le plaisir d’avoir l’emprise sur l’autre. Cette emprise qu’ont les villageois sur le couple, leur permet de leur demander de s’exécuter telles des bêtes devant eux : peut-être alors permettront-ils à Jumpei de quitter ce trou pour voir la mer. Ça en dit long sur la condition humaine dès lors qu’on a le pouvoir absolu sur l’autre, dès lors qu’on sait qu’il n’y a pas de loi sinon celle imposée par le bourreau ou le tyran.
Jumpei trouvera le moyen de s’évader, à l’occasion d’une négligence de ses ravisseurs. Mais qui l’attend chez lui ? Pourquoi partir ? Aimait-il seulement les hommes ? Quel genre d’insectes sont-ils ? On n’apprendra rien de sa vie d’avant. Ce n’est pas un personnage, c’est une image de l’homme. D’ailleurs, il semble avoir trouvé mieux ici que les insectes pour « se faire un nom ». Ayant trouvé l’origine de l’humidité, il pense pouvoir développer l’invention de citernes se remplissant la nuit par capillarité avec l’humidité contenue dans le sable. La fin est tout aussi absurde que le fait de vouloir préserver une maison de l’ensevelissement. Tout est vain. Toute tâche semble parfaitement inutile. Est-il enfin libre pour autant ? Libéré de ces formulaires énumérés au début du film comme pour signifier que nos existences ne sont plus légitimées que par ces bouts de papier ? A-t-il trouvé une infime partie de liberté, ici, dans ce trou comme on trouve de l’or en filtrant des tonnes de sable à travers un tamis ? A-t-il accepté sa condition, comme elle, et comme un chien qui se moque bien d’être tenu en laisse tant que sa gamelle est pleine ? N’est-il pas ici, comme à la ville, lié à sa condition d’exploité ? N’est-ce pas une vie tout aussi vaine de devoir travailler pour s’éloigner de ses soucis ? Pour garder ce qu’il reste à sauver de l’oubli ? Comme dans En attendant Godot, les questions se remplissent par sacs entiers et les réponses ne viennent jamais. L’interprétation, c’est comme l’humidité qui remonte par capillarité et qui finit par s’imposer sans que jamais on ne la voie travailler ; elle s’immisce partout en nous, mais on ne peut lui donner aucune consistance tangible, aucun sens. Toutes les explications sont valables et aucune n’est véritablement appliquée dans le récit qui garde ainsi son mystère et sa dimension universelle.
Voilà pour l’histoire, son mystère.



L’autre atout majeur du film, c’est évidemment sa mise en scène. La musique criarde. Violons tout sauf mélodieux, qui rappellent sensiblement Shining. Les inserts évocateurs, presque subliminaux du sable, des dunes presque vivantes, sensuelles. Ces gros plans, parfois très gros plans de parties du corps pour signifier l’animalité des hommes, suggérer la difficulté de vivre ou le désir. Ce serait presque plus un sujet et une approche qu’affectionne Imamura. La sensualité est mise en scène de manière admirable dans deux ou trois scènes. Pas de dialogues ou très peu. Juste le langage des corps. Pas de champ-contrechamp. Chaque plan est une invention visuelle. Ces deux corps qui s’attirent l’un à l’autre, se désirent. Il n’y a pas d’amour, pas de passion ou de schéma de séduction classique (je te séduis, je te gagne, je te prends…). Ce n’est pas l’acte sexuel comme récompense et le stéréotype du héros délivrant la princesse. C’est une pulsion animale. Condamnés à vivre là, ensemble, ils vivent sans se connaître, parce qu’ils n’ont pas ou plus d’histoire. Ils ne sont plus que des mains servant à remplir des sacs de sable. Quand ils ne travaillent pas, ils mangent, cherchent à se prémunir du sable et de la moisissure. L’accessoire, la culture, l’appétit de l’autre, viennent au bout de quelques mois. Avant ça, leurs corps peuvent se retrouver, se désirer follement, poussés par l’instinct. Mais ils ne s’aiment pas. C’est une passion charnelle, délivrée de tout sens moral, de psychologie ou de remords (elle est veuve, et lui n’a, pour ainsi dire, pas de passé : c’est un homme quelconque — l’homme). Deux insectes capturés au hasard et plongés dans un bocal pour satisfaire à notre curiosité et à nos caprices… Les entomologistes, c’est nous. À cet instant, les très gros plans sont un microscope. En 1964, avant Oshima et son Empire des sens, ces gros plans de corps suintants, étouffants, se désirant l’un à l’autre, ça devait être quelque chose.
Si on devait retourner la fin de la Planète des singes, à la place de la Statue de la liberté, on pourrait bien y voir ce film projeté sur une toile, émergeant tout juste d’un monde qui a déjà recouvert tout le reste. Certaines œuvres sont des châteaux de sable échappant à leur triste destin. Érigées dans la simplicité, elles se figent dans leur perfection en des chefs-d’œuvre non éphémères. La Femme des sables est de celles-là.
Teshigahara aura essentiellement mis en scène les histoires de Kôbô Abe.