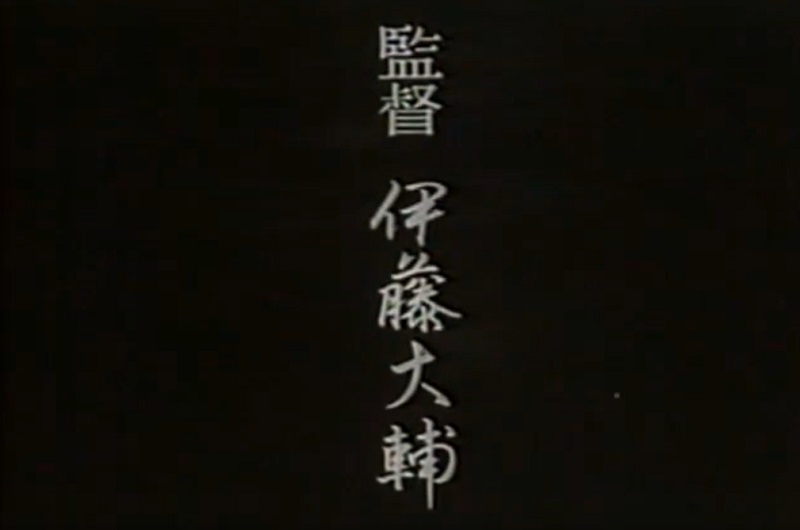Daisuke Itô est connu pour avoir réalisé un des films les plus importants de l’histoire du cinéma nippon, Carnets de route de Chuji, film de samouraï en trois parties dont il ne reste aujourd’hui que des fragments (on en voit un extrait sur Youtube et une copie d’un peu plus d’une heure circule sur le Net*). De ce qu’on peut en voir, ce film muet de 1927 était sur-dynamique ; il aurait lancé par ailleurs quelques codes du genre. La carrière d’Itô est pourtant mal connue et plutôt chaotique bien que s’étalant sur plusieurs décennies. L’un des derniers films muets (disponible) de Daisuke Itô, Le Chevalier voleur (1931), adapté de Eiji Yoshikawa est une vraie merveille du genre, puis, semble-t-il, son influence se fait moins grande au temps du parlant. Il adapte et écrit des scénarios qui semblent le faire sortir de son domaine de prédilection puisqu’il signe le scénario des Coquelicots par exemple pour Mizoguchi, mais réadapte aussi Yoshikawa avec une des premières versions de Miyamoto Musashi pendant la guerre, et on le retrouve en 1951 à réaliser Five Men of Edo. En 1959, il réalise un honnête Samurai Vendetta avec Raizô Ichikawa et Shintarô Katsu, aide à l’adaptation en 1963 de La Vengeance d’un acteur, participe à la réalisation d’un film de la série des Zatoïchi, puis un moyen mais remarqué L’Histoire de Tokugawa Ieyasu, pour finir après plus de quarante ans de carrière en participant à l’écriture du dernier volet crépusculaire et un peu inutile de Miyamoto Musashi par un Uchida à l’aube de la mort. Tout cela pour essayer de situer le réalisateur d’Une femme de Meiji, parce que le film semble bien résumer un peu le chaos, ou la variété si on reste positif, de ce que représente le travail méconnu (et comme pour beaucoup d’autres, très largement indisponible sinon perdu) de Daisuke Itô : une prédilection certes pour les films en costumes (jidaigeki), mais un réalisateur qui ne semble pas avoir toujours profité des meilleures conditions pour exprimer les talents, les audaces techniques, dont il avait su se faire le spécialiste au temps du muet.
Le début de cette histoire tournée en 1955 se perd en dialogues pendant une demi-heure dans des intérieurs et des situations qui ont eu vite fait de me faire piquer du nez. On aurait pu être chez Mizoguchi, mais l’histoire, adaptée d’un roman de Matsutarô Kawaguchi (connu pour mettre au cœur de son récit des artistes, comme dans Les Contes des chrysanthèmes tardifs, Tsuruhachi et Tsurujiro, Les Musiciens de Gion, Shamisen and Motorcycle, mais qui est aussi l’auteur des Amants crucifiés, des Contes de la lune vague après la pluie, Les Baisers…) met longtemps à se mettre en place. Itô est alors comme une mouche qui tournicote dans une pièce en cherchant une issue, à coups de travellings d’accompagnement, de biais, en profondeur, en arrière… Ne manquait plus qu’un travelling en looping pour passer l’ennui et, ô miracle, alors qu’on ne s’y attendait plus, une fenêtre s’ouvre…
Itô est content, sa caméra prend l’air. La maîtrise formelle laisse rêveur. Chaque plan ou presque est un ravissement, un exploit, une trouvaille. Utilisation parfaite de la profondeur de champ (c’était déjà le cas dans les intérieurs, il faut le reconnaître, avec un soin du détail, de l’arrière-plan, du hors-champ), des décors à couper le souffle, tant par leur ampleur discrète (un peu à l’image d’un Guru Dutt à la même époque en Inde) que pour la méticulosité de la reconstitution. Le rythme se ralentit aussi, pour s’attacher à d’autres détails qui procèdent d’un vrai choix de mise en scène, du genre de ceux qui ne se refusent pas à prendre ses distances avec une histoire, un scénario, ou des passages obligés d’un récit… Itô raconte alors une nouvelle histoire en dehors, ou au-delà, de la trame convenue ; le récit déambule entre les lignes comme entre les séquences « à faire », s’efforçant presque toujours à dévoiler le hors-champ de l’histoire attendue, à proposer un contre-pied, à ralentir voire attendre que quelque chose se passe ou se finisse, à couper ce qui peut l’être, et au contraire en laissant s’éterniser une situation sans que l’on comprenne d’abord pourquoi, avant de voir que c’est justement pour s’attacher à dévoiler quelques précieux détails du comportement des personnages. Voilà ce qu’on attend précisément d’un travail de mise en scène, montrer entre les lignes, dévoiler un sous-texte, proposer une vision, faire preuve d’audace et de maîtrise, de conviction…
Pour la scène du « meurtre » par exemple, à l’image de ce que Uchida fera à la fin du Mont Fuji et la lance ensanglantée : pas de musique dramatisant l’action, pas d’outrance de jeu ; pas de coup pour coup (ni de dialogues du tac au tac, il dévoile l’errance des corps, l’incertitude, les hésitations) ; un jeu du hors-champ qu’Itô fait apparaître en montage alterné (des ivrognes passant dans le coin et ne se souciant pas de l’action principale) ; et au contraire le souhait de casser les codes et les rythmes de jeu pour forcer une forme de naturalisme effrayant pour coller à la sidération du personnage féminin ou à la situation dramatique.
C’est à partir de ce climax que le récit bascule dans une autre dimension. Tout est dilaté, ou plutôt, les éléments attendus sont rétrécis voire escamotés, et quelques détails significatifs sont allongés. Un basculement permanent entre jeu d’identification et de distanciation s’opère (à l’image de la profondeur de champ, on joue sur l’opposition entre le lointain et le contigu), encore commun au cinéma de Guru Dutt (ou de Welles), qui casse les repères du spectateur. L’effet de réalisme en est renforcé, mais un réalisme sidérant, profitant à des situations paradoxalement plus dramatiques, voire plus épiques (on n’est plus dans des intérieurs communs ou des scènes où ça bavarde, on a affaire à des situations de danger, de recherche, de peur…). Cette longue séquence finale dans un théâtre est un classique de dénouement purement cinématographique avec plusieurs sujets traités en montage alterné (Coppola en est un habitué).
Daisuke Itô peut faire saliver avec Carnets de route de Chuji, un temps considéré comme le plus grand film japonais, on a au moins un aperçu de sa virtuosité dans Une femme de Meiji. Une même volonté parfois d’élever sa caméra (voire parfois de proposer des plongées, ou encore de reculer sa caméra sur une situation dramatique, parfois pour intégrer un autre personnage regardant le premier — ce qui est encore une manière de s’élever, prendre ses distances, de la hauteur) et surtout cette passion (commune à bien des cinéastes pourtant) pour les travellings (d’accompagnement en particulier).
De ce petit drame pas forcément grandiose, Itô arrive sur le tard à en insuffler une ampleur inespérée. On pourra toujours dire qu’il manque une certaine cohérence, une unité, ou… que je n’étais pas bien réveillé au début du film ; mais il faut aussi savoir apprécier le génie des compositions chaotiques au savoir-faire remarquable. Le sujet n’avait rien de bien passionnant, c’est bien le talent de Itô qui est parvenu au bout du compte à faire de certaines séquences des petits chefs-d’œuvre.
*le film sera projeté à la Cinémathèque française fin 2018 dans le cadre de son hommage au cinéma nippon. (Une précédente projection a eu lieu en 2011).