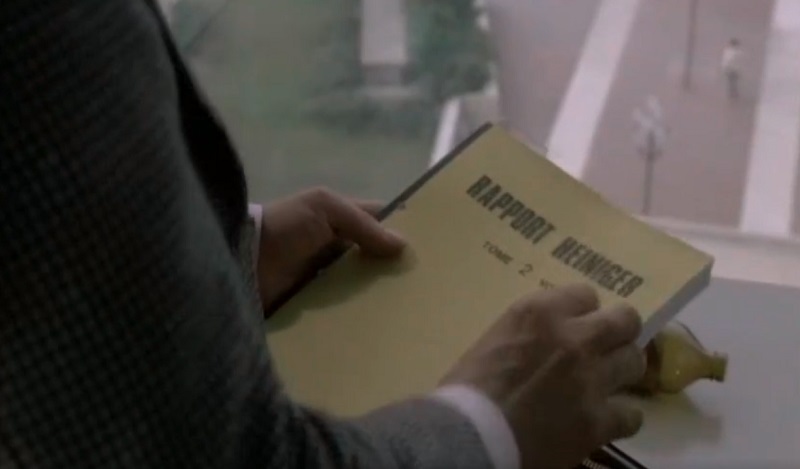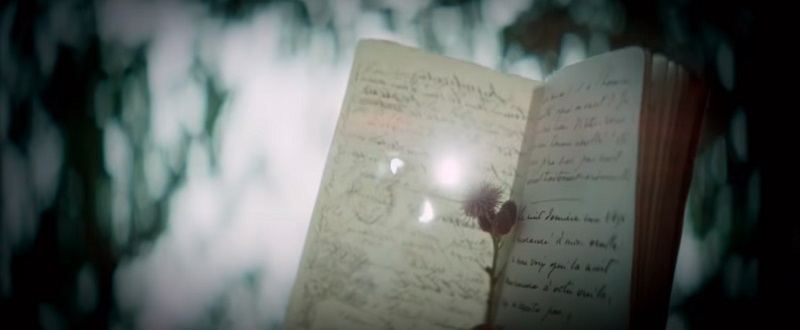La France kigagne

Je me marre… La politique des auteurs et ses limites.
J’ai toujours été conciliant avec Bruno Dumont parce qu’il propose des choses et n’a pas peur du ridicule. Parfois, il a fait mouche, d’autres fois, il se plante. Et il ne faut pas le rater quand il se plante, évidemment. On voit ce qu’il semble vouloir faire avec France. Le scénario n’est pas si mauvais. Les acteurs non plus, même si je trouve Léa Seydoux plutôt antipathique de manière générale (et si ici, à divers moments, elle peut se révéler touchante, au contraire de Blanche Gardin, insupportable). Mais sa réalisation est une vraie catastrophe.
Cette HD avec lumière crue, ces plans très étranges en voiture, ces reproductions de reportages totalement ratées, cette reproduction assez peu convaincante du monde politico-journalistique parisien, et cette direction d’acteurs plus qu’aléatoire quand le cinéaste a affaire à des acteurs professionnels, ce n’est pas beau à voir.
D’un autre côté, le film de Julia Ducournau souffre de défauts opposés : mise en scène à la hauteur, direction d’acteurs plutôt bonne, mais le scénario, attention aux turbulences… Les dialogues, ça peut aller, mais la construction de l’histoire, la motivation des personnages, la cohérence d’ensemble, ben… c’est franchement horrible à voir. Une constante dans le cinéma d’horreur peut-être.
Les intentions sont bonnes, et si je suis conciliant avec Bruno Dumont, je le serai tout autant envers un cinéma français qui tenterait de retrouver une forme de grand guignol depuis longtemps oubliée. Conciliant, jusqu’à certaines limites… Ce n’est pas de la science-fiction, mais on se situe entre l’horreur, le thriller, le grotesque, et dans la forme, c’est un peu comme si David Cronenberg rencontrait Gaspard Noé. Dommage donc que ce soit tellement si mal écrit… Qu’est-ce qui reste de la proposition de départ qui laisse entendre qu’on se rapprocherait d’un Crash à la française ? L’amour des voitures, que devient-il au fil de récit ?
De manière très étrange, le film fournit deux introductions. Une pour expliquer la plaque de titane que possède le personnage dans la tête (implant purement cosmétique, il n’a strictement aucune utilité dramatique). Et un autre qui va déclencher la folle suite de crimes perpétrés par le personnage principal… Personnellement, je qualifie ce genre d’expositions des hamartia, des événements traumatiques sur lesquels les événements qui suivent trouvent leur raison d’être (Aristote en parle dans La Poétique et sans doute ailleurs). Quand il y en a deux, Aristote appelle ça « l’erreur du karatéka » : une hamartia, deux hamartiaux. Ouille. Pour résumer la chose, jugez de l’effet produit : une impression bizarre que le récit manque de maîtrise. À moins que le second événement devienne une conséquence directe du premier (une hypothèse loin d’être évidente).
De la série B à la française, du grand guignol bien gore, je crie de joie. Mais Julia Ducournau pourrait au moins s’appliquer à élaborer une histoire qui tient la route. Une demi-douzaine de films pourrait se produire dans la foulée par an tellement le travail d’écriture est bâclé. Présenter ça comme du grand cinéma, voire du cinéma d’auteur, envoyer ça dans un festival général et le primer, faut pas pousser (bébé dans le bain d’orties). Rien de bien original à voir des films de genre mal écrits, mais n’en faites pas des films d’auteur et enchaînez-les à la pelle. Que vive la baguetteploitation ! Parce que si l’on continue à laisser penser que ces films sont dignes d’être envoyés dans un festival non dédié au fantastique, on arrivera jamais à multiplier ce genre de productions en les faisant passer pour ce qu’elles sont : des séries B. Et je reviens à ce que je dis souvent : même si l’on a la chance en France de bénéficier de crédits à la création, et une création diverse, on manque en revanche, en dehors des comédies, d’une authentique production de série B à échelle industrielle et à vocation commerciale, voire internationale. C’est seulement quand on dispose d’une vraie industrie de série B, qu’on peut voir se dessiner des mouvements et des cinéastes qui sortent du lot. Au lieu de les faire sortir des écoles de cinéma à papa et de juger les intentions mises en avant plus que le talent ou la popularité.
On va dire que c’est le charme des films d’auteur à la française. Des films qui se remarquent davantage à travers leurs défauts. Maintenant, je ne sais pas jusqu’à quel point Julia Ducournau prétend être « autrice ». Et je ne sais pas jusqu’à quel point on peut se montrer conciliant avec ce type de cinéma… Au moins, Titane m’aura procuré quelques bonnes tranches de rigolade (oui, le grand guignol, on a droit de rire sadiquement, c’est de la catharsis, messieurs, dames). Mais qu’une Palme d’or soit décernée à une tentative de série B grand-guignolesque, comment dire… Le cinéma n’a-t-il vraiment rien de mieux à proposer de nos jours ?
France, Bruno Dumont 2021 | 3B Productions, Red Balloon Film, Tea Time Film
Titane, Julia Ducournau 2021 | Kazak, Frakas, Arte
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel