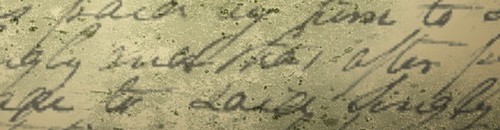Juillet – Décembre 2025
décembre 2025
« Hommage ».
La haine des étrangers, l’amour des bêtes. BB s’en est allée. Mamie raciste avait été une des seules stars devenue un phénomène tant en Europe qu’aux Etats-Unis et dans le bloc de l’Est. La femme et l’artiste. La défenseuse de la cause animale et la connasse. BB, ou la banale duplicité du monde.
novembre 2025
Fish Tank, Andrea Arnold (2009)
commentaire :
L’Emploi du temps, Laurent Cantet (2001)
commentaire :
Désiré, Sacha Guitry (1937)
L’habit fait vraiment le moine. Mettez un costume quelconque à Guitry et il y perd la moitié de son charisme. Et comme, le charisme de l’acteur, c’est son talent, Guitry y est ici plutôt… quelconque. Reste l’esprit et le talent… du dramaturge et des acteurs (surtout les actrices) « d’emploi » comme Arletty, Pauline Carton et Saturnin Fabre.
Le Ciel partagé, Konrad Wolf (1964)
commentaire :
octobre 2025
Frankenstein, Guillermo del Toro (2025)
commentaire :
Un nouveau départ, Elaine May (1971)
Assez décevant. J’avais créé une liste il y a quelques années intitulée « les films qui cartonnent sauf chez nous ». Le film pourrait y être ajouté : assez largement loué à l’étranger, plutôt inconnu en France. C’est une habitude pour les comédies. Walter Matthau n’est pas un inconnu, mais Elaine May était une vedette de la télévision américaine où elle faisant la paire avec Mike Nichols. Probable que le film a pu bénéficier d’une publicité bien plus important localement, alors qu’il est probablement sorti dans l’indifférence en France. Ajoutez à ça que chez nous, on fonctionne à travers la politique des auteurs et que les préjugés n’y sont pas moins développés qu’ailleurs, et ça plombe un peu plus le potentiel du film. Une fois tout cela dit, reconnaissons aussi que l’humour fonctionne parfois strictement dans un environnement, et cet environnement n’est pas le mien. Le sujet est amusant, c’est assez bien construit, mais le rythme est trop lent, la mise en scène parfois trop statique. C’est une farce, un vaudeville, si on joue ça au rythme de la « nature », les acteurs paraissent en faire des tonnes. Et ça ne manque pas. Si les Français, contrairement à ce que croient les Américains, préfèrent Woody Allen à Jerry Lewis, c’est que les films de Woody Allen obéissaient à la tradition des comédies américaines en jouant à mille à l’heure tandis que Lewis se rapproche plus de l’absurdité d’un Tati. Je ne doute pas que ça plaise à certains (dont les Américains, je l’ai vu en salle, et l’Américaine de service qui nous empoisonne à commenter toutes ses séances à haute voix était bien seule à rire aux éclats), moi je n’ai même pas décroché un sourire… Étrangement, je serais curieux de découvrir, May, l’actrice, mais plutôt dans des films dramatiques. Si on peine à trouver crédible son personnage, c’est qu’on devine trop bien que c’est une fille sociablement intelligente (tout le contraire du personnage). (Elle changera de registre comme réalisatrice quelques années plus tard, avec Mikey et Nicky, avec la même réussite…)
Retour à Séoul, Davy Chou (2022)
En dehors de la dernière séquence des retrouvailles, assez émouvante, le film est pénible à voir. Surtout à cause du caractère particulièrement insupportable du personnage principal. Conséquence tant de son écriture que de l’interprétation. C’est certain que planter des Français (en particulier Parisiens), avec leurs mauvaises manières et leurs intonations qui ont l’air de dire « je t’emmerde » à chaque phrase en face d’étrangers tentant d’arrondir les angles, gênés par ce sans-gêne, ça fait prendre conscience de nos travers (comme ceux des Coréens, dans un excès contraire, à refuser la confrontation). En revanche, si cela est peut-être tout à fait juste et pertinent, personne n’a envie de voir ça dans un film. Et le fait de se sentir déraciné n’est pas une excuse pour être odieux avec ses hôtes… La structure du récit montre un peu trop à mon goût qu’il est inspiré de la réalité. L’actrice se débrouille pas mal (surtout si on considère que manifestement, elle parle coréen couramment pour être binationale, et a par conséquent dû faire croire qu’elle baragouinait deux mots de coréen), mais pour rien au monde, on aurait envie de passer cinq minutes avec (désolé, chères voisines parisiennes, je ne peux pas encadrer vos manières, votre air supérieur ou négligé, et j’imagine que ça doit être réciproque tant mes intonations d’homme des cavernes des banlieues doivent bien valoir les vôtres). « Yeon-Hee » est un joli prénom…
Lady of Burlesque, William A. Wellman (1942)
Greta Garbo rit, logiquement, Barbara Stanwyck… smurfe. En dehors de cette étrangeté, un film de coulisses qui hésite entre les numéros de music-hall et le whodunit abracadrabantesque. Une fois que ce dernier l’emporte, on n’y comprend plus rien. Agatha Christie s’en retourne encore dans sa tombe. J’attends la battle de smurf avec Barbara pendant que Greta se marre…
(Note au traducteur de la Cinémathèque : « Burlesque » se traduit plus volontiers par « music-hall ». Un peu comme le « smurf », c’est un faux-ami.)
Roxie Hart, William A. Wellman (1942)
Jolie histoire, excellente mise en scène et des acteurs précis sous la direction de Wellman, mais rien n’est drôle en fait dans cette farce. Connu pour être un des films préférés de Kubrick, on y retrouve effectivement l’humour pas drôle du cinéaste new-yorkais quand il s’attachera les services de Peter Sellers (acteur, par ailleurs, rarement amusant). Ce serait même difficile à expliquer pourquoi la farce fait pschitt. La proposition de départ ne semble pas tenir la route. Je parle de farce, d’ailleurs, mais peut-être s’agit-il au fond plus d’une satire… Dans un cas comme dans l’autre, la comédie ne pardonne pas. La sauce est toujours difficile à prendre, et souvent, impossible de déterminer ce qui déraille…
septembre 2025
Aux frontières de l’aube, Kathryn Bigelow (1987)
commentaire :
Pixote – La Loi du plus faible, Héctor Babenco (1980)
commentaire :
Les Enfants de la crise, William A. Wellman (1933)
Le code nous aura privés de ce genre de films, réalistes, assez clairs politiquement concernant l’état de la société en pleine Grande Dépression… Et quand on y songe, encore une fois, l’Amérique aurait tout aussi bien pu, comme l’Allemagne, tomber dans le fascisme. Ce n’était que partie remise. Un peu moins d’un siècle plus tard, on y est. Les belles rencontres auxquelles nos trois protagonistes ont encore droit (toutes des figures d’autorités) seraient aujourd’hui des figures de l’autoritarisme : un policier chargé de trier les clandestins à l’arrivée à Chicago et se montrant plus que compréhensif, un juge qui décide de mettre un terme à l’errance des trois adolescents en leur apportant enfin toute l’aide dont ils ont besoin. L’Amérique était en crise, mais elle s’est vite redressée grâce à une politique de l’investissement que partout, aujourd’hui, les pays tentés par l’illébéralisme se refusent à appliquer pour en continuer une autre qui profite aux plus grandes fortunes. L’Amérique était en crise, l’Europe était malade de trop de haine. Mais l’Amérique, cette fois, n’y échappe pas. Nous non plus, d’ailleurs. Les motifs d’espoir, parfaitement justifiés, présents dans le film passeraient pour être peu crédibles dans la société actuelle. Peut-être qu’ils l’étaient également à l’époque d’ailleurs. Vidor réalisera l’année suivante un film dans la même tonalité humaniste : Notre pain quotidien. Et j’aurais les mêmes réserves. Je préfère quand le spectateur se retrouve acculé face à un constat terrible et injuste l’obligeant, lui, à se révolter. Lorsque c’est le cinéma qui illustre ce champ des possibles, qui montre la lumière derrière le brouillard qui nous étouffe, on se dit peut-être un peu trop que tout ira pour le mieux. Et l’on ressort de la salle ramolli. Mais l’espoir, il est sur pellicule ; la vraie vie, elle, continue d’être révoltante et l’on ne la voit plus.
Merci à Billy de nous avoir privés, lui, du talent de la demoiselle : il se mariera l’année suivante avec elle et l’on ne la verra plus claquer des talons et plisser du nez à l’écran.
Les Forçats de la gloire, William A. Wellman (1945)
Film typique d’un grand cinéaste sans réel intérêt, sinon purement descriptif. Wellman fait un excellent travail pour donner corps à ces chroniques de guerre. Mais le récit ne contient aucun enjeu d’importance, n’oppose vraiment aucun personnage. C’est bien Wellman qui mâche tout le travail : des échanges de regards, des contrechamps à foison, des dialogues pour ambiancer et identifier les personnages, des acteurs justes (autant qu’ils pouvaient l’être avant l’intégration de la method), des décors illustrant ce qu’il faut pour que l’on y croie. Les événements montrés n’arrivent pas à la hauteur de tous les moyens déployés et l’on se désintéresse très vite du classique jeu d’élimination. Les meilleurs films de guerre ont tous un message fort à faire passer. Et les bons sujets en temps de guerre ne manquent pas. Il y a fort à parier que ces forçats de la gloire trouvent un meilleur hommage à travers ces autres grands films du genre dans lesquels ils ne tiennent peut-être pas les premiers rôles, mais dans lesquels on peut les y voir participer à un sujet vaguement plus enthousiasmant qu’une pâle chronique de leurs conditions de vie.
Track of the Cat, William A. Wellman (1954)
Savoureux mélange entre La Chatte sur un toit brûlant et Alien. Qu’est-ce qui faisait la réussite du premier Alien ? Le fait que l’on y voyait très peu l’alien. Comme pour Les Dents de la mer. Toutes ces histoires fuient en réalité les monstres parce qu’elles sont à la recherche des « aliens » qui sont en nous. Mitchum peut donc partir si ça lui chante traquer une panthère noire hypothétique, pendant que le chat n’est pas là, les souris se déchirent. Dans Alien ou dans Les Dents de la mer, c’est un équipage qui s’écharpe alors que la mer gronde et que le monstre rôde. Ici, comme chez Tennessee Williams, ce sont les familles qui s’entre-dévorent.
Les productions Alien se perdent depuis des années à mettre au centre de leurs récits l’alien, reproduisant ainsi à l’infini l’erreur de James Cameron. Elles seraient bien avisées d’adapter dans son univers Track of the Cat. Les meilleurs westerns sont des huis clos ou presque (L’Étrange Incident, Johnny Guitare, L’Attaque de la malle-poste, Rio Bravo, etc.), la science-fiction devrait y revenir. Le spectateur n’a pas besoin de grands espaces en papier mâché numérique, mais d’imagination. Revenir à l’essentiel. (En revanche, une telle adaptation réclamerait d’y supprimer la morale viriliste de son dernier segment. Spoiler : l’homme timide devient un homme, un vrai, en tuant la bête…)
août 2025
Les Mendiants de la vie, William A. Wellman (1928)
commentaire :
Héros à vendre, William A. Wellman (1933)
C’est beau comme du Preston Sturges, sauf que je n’aime pas quand c’est beau comme du Preston Sturges. Les détours et les retournements de fortune (même possible en période de Grande Dépression) ont le parfum et la concision des mélodrames du muet. Le parti pris humaniste, ni « rouge », ni « conservateur » a encore la saveur du précode. Mais si le mélo a fini par être démodé, c’est bien que le cinéma parlant allait vite ne plus pouvoir avoir recours à de tels procédés sans y mettre les moyens. Et à moins d’avoir une forme de pureté comme Fury, je vois mal comment une telle approche aurait pu continuer à convaincre le spectateur (le code Hays réclamera de toute façon une forme de retenue dans l’évocation de la misère).
Le film prend quelques accents actuels quand des policiers font la chasse au leader de grève, aux communistes ou aux travailleurs immigrés (ils ne sont ici pas latinos, mais italiens). On a oublié que le pays aurait pu tout aussi bien se passer de New Deal et prendre le même virage que l’Allemagne. Ce n’est que partie remise…, le pays sombre chaque jour un peu plus dans le fascisme…
J’ai un petit faible pour Aline MacMahon. La véritable vedette du film, c’est bien elle.
Yella et Phoenix, Christian Petzold (2007/2014)
commentaire :
juillet 2025
Outrage, Ida Lupino (1950)
commentaire :
Femmes en prison, Lewis Seiler (1955)
Joli film de science-fiction imaginé par un scénariste d’à peine quatre ans. Des situations abracadabrantesques, des coïncidences heureuses de l’espace et des monstres sadiques sortant des profondeurs du cosmos. Des dizaines de femmes au générique, et un homme pour les sauver toutes de l’emprise maléfique et autoritaire de la terrible directrice. On n’échappera pas à la fin heureuse dans laquelle l’une de ces criminelles bénéficiera prématurément d’une remise de peine ! Gardons le suspense ou mettez-moi la camisole ! Grand pestacle !
Not Wanted, Elmer Clifton, Ida Lupino (1949)
Sujet nécessaire et courageux à une époque où il a été tourné, mais ce n’est pas vraiment le servir que de l’affronter aussi frontalement. Grâce à la direction d’acteurs, on évite le mélodrame, pas le misérabilisme. Grossesse non désirée hors mariage, plus confusion mentale, plus réhabilitation via un nouvel amoureux… La démonstration est bien trop appuyée pour convaincre.
Ce jour-là sur la plage, Edward Yang (1983)
Commentaire :
The Bigamist, Ida Lupino (1953)
Le rôle de l’art a souvent été d’éclairer les zones grises de nos sociétés. Bon exemple ici avec un film qui échappe aux clichés, pose des questions légitimes et force le spectateur à revoir ses préjugés. La fin moralisatrice au tribunal aurait pu être moins appuyée, mais était-ce sans doute une obligation pour avoir accès aux réseaux de distribution des majors qui adoptaient le code Hays. Musique parfois aussi un peu trop présente ; c’est l’époque qui veut ça. En revanche, la direction d’acteurs est un modèle du genre, surtout dans la finesse, la justesse, la délicatesse. Rien d’étonnant à ça. Les excellents acteurs sont rarement instinctifs, quand ils passent derrière la caméra, on peut alors leur faire confiance pour savoir diriger leurs collègues. Devant, Lupino est parfaite, comme à son habitude : de l’autorité, de l’intelligence. Joan Fontaine, tout juste au niveau. Mais la grande découverte, c’est la subtilité du jeu d’Edmond O’Brien, plutôt accoutumé aux seconds rôles ou aux premiers dans des films obscurs. Hitchcock disait que le gros du travail d’un directeur d’acteurs était de choisir les bons… Chapeau bas à Ida Lupino d’avoir mis aussi bien en valeur cet acteur.
Jardin d’été, Shinji Sômai (1994)
commentaire :
Un été chez grand-père, Hou Hsiao-hsien (1984)
Une filiation évidente avec Ozu première période (voire avec Shimizu). Et une filiation probablement naturelle, étant donné l’histoire qui relit Taïwan et le Japon.
C’est un peu bancal, on sent que Hou Hsiao-hsien tâtonne. Le fond semble assez mal correspondre à la forme. Comme pour Edward Yang (qui apparaît à la toute fin du film, si j’ai tout compris), c’est surtout dans la radicalité qu’il se fera remarquer. En l’occurrence, cela se fera à travers sa capacité à créer de la distance entre ses sujets et le regard qu’il porte sur eux. C’est d’ailleurs à travers la distanciation, si je ne m’abuse, que les cinéastes taïwanais créeront un sillon et une forme spécifique.
Grâce aux ellipses et à une certaine lenteur dans le découpage, on retrouve déjà ce style ici (style déjà présent chez les cinéastes japonais précités). L’humour disparaîtra (en tout cas dans les quelques films que j’ai vus), les enfants aussi. Ce cinéma se fera également plus urbain (j’ai vu les films il y a longtemps, cela demanderait confirmation), moins familial, alors que là encore, c’était une thématique des deux cinéastes japonais.
C’est cet aspect-là qui m’a plu (mettez-y des enfants, j’y trouve facilement mon bonheur), mais le hiatus que l’on devine déjà ici vient des facilités et des clichés du scénario. Soit il aurait fallu alors jouer pleinement sur la fibre nostalgique ou classique et ainsi assumer les détours mélodramatiques du scénario (cela aurait ressemblé à du Imamura ou à du Kinoshita), soit il aurait fallu prendre le parti de gommer ces aspects.
La distance aide assez à éviter les maladresses du mélo grossier, mais une fois certains éléments filmés, on ne peut plus les écarter du montage final… Tout ce qui concerne la folle et les deux voleurs est de trop.
Il faut supposer que le cinéaste a compris ce problème et a alors choisi par la suite d’assumer une plus grande radicalité dans son cinéma (pas vraiment à mon goût d’ailleurs, parce que quand la forme et la mise à distance priment sur le sujet, d’autres problèmes apparaissent, mais c’est un autre sujet). 6,5/10
Confusion chez Confucius, Edward Yang (1994)
Que ce soit en Corée du Sud, autrefois aux États-Unis, aujourd’hui en Chine continentale ou donc à Taïwan au milieu des années 90, les maux dont souffrent les sociétés qui ont connu une rapide explosion du niveau de vie sont les mêmes. Argent facile, exubérance, épandage de richesse, vacuité et prétention, perte de repères… La satire semble féroce, et on s’y amuse davantage que dans les autres films de Yang. Le problème, c’est que l’on n’y comprend pas grand-chose. Et cela pour deux raisons. D’une part, le côté choral du film propose une mosaïque de liens, de rapports professionnels ou amoureux, des rivalités extrêmement complexes à suivre. Au point que l’on se demande parfois si ce n’est pas volontaire comme pour plonger le spectateur dans une sorte de Grand Sommeil version comique. D’autre part, l’humour tient également aussi beaucoup à un ensemble de références incompréhensibles pour un spectateur étranger. À peine peut-on par exemple déceler la moquerie derrière les insultes qui fusent parfois en anglais chez l’un des personnages pour ponctuer ses phrases, mais si l’on n’y prête pas attention, on ne les entend même pas parce qu’elles ne sont pas traduites. Alors, pour le reste, on ne peut que deviner tout un continent inconnu comme dirait l’autre derrière toute cette agitation… On ne doit pas être loin d’une forme d’incommunicabilité à laquelle doit être exposé un étranger devant les aventures d’Astérix (encore plus dans les versions cinéma).
On y retrouve une forme de cinéma proche d’Almodovar ou de Woody Allen. Très volubile et chaotique. Comme un Rubik Cube dont chaque face colorée représenterait un personnage et dont on s’amuserait à modifier frénétiquement les combinaisons… Mais on reste encore là dans la simple évocation : le comique ne s’improvise pas et l’on voit vite que Yang est incapable de tirer le meilleur de ses acteurs (qui ne sont sans doute par ailleurs pas non plus des acteurs comiques pour la plupart). Le jeu est forcé, loin d’être naturel ; le style ni réellement grotesque ou loufoque (comme pouvait l’être sur le continent Lady Kung-fu) ni assez sophistiqué ou même distancié (on parle pourtant d’Edward Yang) pour être parfaitement convaincant. On est bien dans cet entre-deux typique des gens qui ne savent pas quoi décider. Le cinéma doit être radical, oui. Yang, avec son style habituel, et même s’il ne me correspond pas du tout, était radical. Ses personnages le sont aussi dans une certaine mesure.
La Vallée de la paix, France Stiglic (1956)
Étonnant mélange entre Black Sun (Kurahara, 1964) et Quelque part en Europe (Radványi, 1948). Faire intervenir des enfants (voire des orphelins) dans un contexte de guerre fera toujours son petit effet. L’intrus (qu’il soit étranger, libérateur, voyageur interstellaire), aussi. Les enfants, surtout la gamine, sont dirigés au centimètre près. Peut-être plus du dressage que du jeu, mais le résultat est remarquable. Au-delà de ces archétypes faciles, rien de bien original, sinon le fait peut-être de voir la plus jeune jouer les interprètes, mais ça se regarde avec plaisir.
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel