
Les meilleurs films de femmes indépendantes
——— Page 6 ———
Top 10 | Top 20 | Top 30 | Top 40 | Top 50 | Fin et mentions spéciales
51. Contact (Ellie Arroway)
Jodie Foster
(Carl Sagan, James V. Hart, Michael Goldenberg/Robert Zemeckis, 1997)

Depuis le film (inspiré d’un roman de Carl Sagan), les personnages de scientifiques féminins sont plus fréquents au cinéma (et encore, en dehors de Premier Contact, qui est peut-être un hommage au film, je n’en vois pas beaucoup). Mais avant cela ? Dans des films soviétiques, sans doute, mais ailleurs…
En plus de donner un visage féminin à un personnage de scientifique brillant (et premier être planétaire à avoir un « match » avec un alien), notons aussi la relative sobriété sentimentale du personnage. Et qui d’autre, pour interpréter cette scientifique dévouée, ambassadrice de l’espèce humaine, que Jodie Foster ?
L’actrice du Silence des agneaux a toujours échappé aux personnages féminins hétéronormés, peut-être par choix, peut-être parce que comme avec ses glorieuses prédécesseures à la sexualité mal définie (Greta Garbo, Marlene Dietrich, Delphine Seyrig, Patricia Neal – qui tenait un rôle dans l’ancêtre de Contact : Le Jour où la Terre s’arrêta), ce statut d’actrice presque asexuée (et pas encore homosexuelle assumée) servirait forcément des personnages libérés des contraintes romantiques et sentimentales (hétérosexuelles).→→
Rien n’obligeait Sagan à faire de ce personnage une femme. Et aujourd’hui, rien n’interdirait ce même personnage d’être vaguement homosexuel (« vaguement », parce qu’en dehors d’une ou deux allusions servant à discréditer la candidature de la scientifique, sa vie privée a moins d’importance que ce qu’elle pense sur… Dieu, par exemple, même si aujourd’hui, justement, dans l’Amérique actuelle, on reprocherait aussi bien à ce personnage d’être athée que lesbienne).
Et qu’importe au fond : c’est elle qui, non seulement, découvre le message adressé à l’humanité, mais qui va également à la rencontre de l’expéditeur. À son retour, si cela avait été un homme, aurait-on plus facilement cru au récit du voyage qui en aurait été fait ? That’s the question. (Ai-je besoin de spoiler ? Au retour de la scientifique, personne ne croit qu’elle ait réellement rencontré les extraterrestres, car la capsule n’a pas bougé. Personne ne la croit. Comme quoi, Bergman a manqué quelque chose : la vraie question de la foi dans ce monde, c’est celle du dilemme dont les femmes sont les principales victimes parce qu’en matière de justice la « foi » n’a pas lieu d’être : celui de croire en l’absence de preuves matérielles.)
52. Carmen Jones (Carmen Jones)
Dorothy Dandridge
(Bizet, Oscar Hammerstein II, Harry Kleiner/Otto Preminger, 1954)
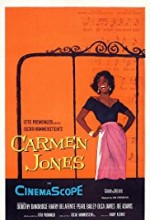
Carmen est un des symboles de l’émancipation des femmes. Bizet en a presque fait le personnage annonçant les révolutions futures. On pourra toujours arguer que le personnage constitue un fantasme d’homme, celui d’une femme sauvage à domestiquer par lui.
Pour appuyer cette interprétation, on peut reconnaître un rapprochement éventuel de l’image de la femme insaisissable avec l’univers de la tauromachie. Ce serait oublier que ce n’est pas l’homme qui dompte l’animal sauvage, c’est l’animal sauvage qui se joue de l’homme. Dans Carmen, les hommes échouent soit à résister à Carmen, soit à la laisser libre, soit à répondre à leurs propres pulsions sauvages (le meurtre).
Si Carmen annonce aussi bien l’émancipation des femmes que les femmes fatales, elle reste de loin un personnage bien plus épanoui et libre que la femme fatale. Vue à travers le code Hays, la femme fatale a déjà (trop) vécu et représente un modèle à ne pas suivre. Carmen, au contraire, si elle inspire pareillement le désir des hommes, elle n’a pas renoncé à emprunter sa propre voie et à vivre pleinement ses amours, même furtifs. Carmen vit au présent ; la femme fatale est enfermée dans son passé et sert d’épouvantail aux hommes égarés. L’une est active, l’autre attend qu’un homme dépravé tombe dans son →→→→→→→→→→→→→→→
piège. La femme fatale agit dans l’ombre du héros masculin ; Carmen est au centre du jeu. Elle était libre (ou essayait de l’être) avant qu’un homme la ramène, par la violence, à sa condition d’objet de désir et d’animal qui ne peut être qu’abattu s’il ne se soumet pas.
Le sentimentalisme organise les débats, mais Carmen est-elle réellement esclave de ses pulsions amoureuses ? Son amour (non exclusif, changeant, mais non pas versatile, résolument indépendant et libre) ne représente pas pour Carmen une forme d’assujettissement à un homme parce que si Carmen devait être loyale en un seul amour, ce serait celui de sa liberté. Bien souvent, le sentimentalisme des histoires sert une morale conservatrice basée sur le mariage vu comme une finalité. Carmen ne répond pas du tout à la même logique : « l’amour est enfant de bohème, il n’a jamais connu de loi ». Ce n’est pas du sentimentalisme. Mais de la passion.
Le finale de la fable échappe à la morale. Le meurtre de Carmen n’enclenche pas un retour à l’ordre (masculin) des choses, mais la tragédie de la violence des hommes contre laquelle le public n’aura qu’une envie : se révolter pour suivre les préceptes de Carmen. Vivre libre jusqu’à en mourir.
53. Boule de Suif (Boule de Suif)
Micheline Presle
(Guy de Maupassant, Henri Jeanson, Louis d’Hée/Christian-Jaque, 1945)

Encore une femme de mauvaise vie, me direz-vous. Effectivement, les cheffes d’entreprise sont rares dans l’histoire de nos sociétés et, par conséquent, tout aussi rares au cinéma (même si cela devrait être son rôle d’engager un mouvement). Il faut donc accepter la dualité du personnage : une prostituée est une femme à la fois libre (dans le meilleur des cas) de toute attache sentimentale et matrimoniale (ce qui n’empêche pas d’autres asservissements), mais sans les hommes et leurs basses tendances, pas d’émancipation.
Il n’est pourtant pas question de cela dans Boule de suif, car une partie de l’intrigue (et du suspense) consiste justement à exposer le refus de la jeune femme de se donner à un officier prussien, condition nécessaire à ce que son groupe de voyageurs puisse repartir. Pour égayer la « course », Christian-Jaque et Henri Janson épicent l’intrigue avec une autre nouvelle de Maupassant (Mademoiselle Fifi). En plus de se donner à l’ennemi, Boule de suif finira son affaire en assassinant le bonhomme.
Boule de suif, c’est ainsi l’honneur de la France recouvré. Le message humaniste et satirique en 1870 comme en 1945 est identique : le véritable honneur ne viendra pas des classes bourgeoises, →→→→→→→→→→→→→→
dont le caractère intrinsèque consiste à tirer profit des autres, mais des personnes démunies et largement méprisées. La première ligne, dirait-on aujourd’hui.
Dans certains films au féminisme frémissant, les femmes se sacrifient afin de sauver un être aimé, préserver l’honneur d’une famille : elles sont volontaires, actives, mais toujours asservies à une entité plus forte qu’elles. Le sacrifice dans Boule de suif est tout autre. La prostituée avait déjà partagé ses réserves dans la voiture avec des voyageurs partis en hâte sans rien prévoir à manger. Et le film s’achève avec le même mépris de classe des bourgeois exigeant que la prostituée s’exécute pour leur permettre de recouvrer leur liberté : ils ne lui jetteront pas un regard, sinon de mépris, une fois qu’elle les aura libérés.
La France, c’est encore les auteurs qui en parlent le mieux. Boule de suif (le personnage), c’est une allégorie de la France, la vraie, la France populaire méprisée par les classes dominantes. Vous pourriez refaire le film aujourd’hui en temps de pandémie ou de déficit. La bonne société (celle qui élève la voix) pointera toujours du doigt ceux qui n’ont rien et qui se démènent pour sauver la patrie. Devinez ensuite qui se proclamera patriote face aux assistés.
54. Lilya 4-ever et Ayka (Lilya et Ayka)
Oksana Akinchina/Samal Yeslyamova
(Lukas Moodysson/Gennadiy Ostrovskiy, Sergey Dvortsevoy, 2002/2018)

Avant de pouvoir rêver à l’indépendance ou de pouvoir en jouir, il faut parfois en passer par le constat de l’oppression des femmes. Le Japon, ce n’est pas l’Occident ; le vingt-et-unième siècle, ce n’est pas le dix-neuvième ; et la Russie de Poutine, ce n’est pas l’URSS.
L’Union soviétique n’était en rien un modèle, sauf, peut-être, dans le domaine de l’émancipation des femmes. Un paradoxe dans une société gangrenée par bien d’autres totalitarismes. Et quand le « communisme » s’est effondré, la Russie en est revenue à des principes conservateurs. Si l’on peut imaginer que dans certaines professions, les femmes éduquées ont pu maintenir une certaine forme d’indépendance grâce aux services qu’elles rendaient à la société et à travers leurs expertises, pour la société au bas de l’échelle (la jeunesse surtout et les populations de l’est), c’était un retour à la case départ.
Lilya et Ayka sortent à peine de l’adolescence et elles font déjà figures de proies pour les →→→→→→→→→→→→→→
hommes. Sans parents, sans mari, sans éducation, sans travail, sans attaches, déracinées, elles deviennent des esclaves modernes. L’une ère dans la grande ville, le ventre gros, au milieu du froid, en recherche d’un travail et d’un abri où dormir ; l’autre, livrée à elle-même, se laisse embarquer par les promesses d’un homme chargé de recruter de jeunes prostituées russes en partance pour la Scandinavie. Pour ces jeunes filles, l’amour est déjà fini ; il n’a probablement jamais existé. L’indépendance se profile au loin ; pour l’heure, leur vulnérabilité les empêche de se projeter.
(On pourrait ajouter à ce constat amer le personnage d’Insiang, du film éponyme de Lino Brocka, d’Ok-nyo, de La Mère porteuse, réalisé par Im Kwon-taek, et de Bai Xuemei de Blind Mountain. Toutes ne sont que des ventres ou des vagins jetables, les sœurs maltraitées de la Thymiane du Journal d’une fille perdue déjà évoqué ici.)
Mentions spéciales
1. Le Cheik (Lady Diana Mayo)
Agnes Ayres
(Edith Maude Hull, Monte M. Katterjohn/George Melford, 1921)

Reprise du commentaire de la critique :
Le film navigue suffisamment dans l’ambiguïté pour éveiller des malentendus et des réflexes pouvant refléter les idées d’une époque, et plus particulièrement, les principes moraux d’une société qui change. On est après guerre en 1921, le début des années folles, période où la femme s’émancipera comme jamais. Et il est bien possible que l’Occidental outré d’abord par la manière dont une femme est traitée par un cheik arabe finisse, sans s’en rendre compte, à s’indigner, non plus que cette femme soit traitée ainsi par un étranger, mais seulement par le seul fait qu’une femme devienne ainsi l’objet des désirs d’un homme, quel qu’il soit. Le fait qu’elle soit britannique joue sans doute d’ailleurs beaucoup parce qu’on la voit au début du film refuser les avances d’un homme (occidental) lui proposant le mariage et lui avouant qu’elle ne s’y soumettra jamais parce que le mariage est pour elle synonyme de prison. Quand on s’indigne du sort de cette femme, on s’indigne d’autant plus qu’il s’agit d’une femme indépendante. Alors que l’émancipation initiée par les suffragettes dans les sociétés occidentales n’était sans doute pas encore une idée bien répandue et acceptée, il suffit que l’une de ces femmes rencontre un danger extérieur pour que, très vite, on s’insurge en adoptant sans hésitation les nouveaux principes moraux censés s’opposer aux principes barbares venus de l’agresseur. Voilà comment on devient « féministe » à son insu. Soft power, mon général.
Que cette femme soit par la suite retenue captive, violée, et même qu’elle tombe finalement dans les bras de son agresseur, n’y change pas grand-chose. Car ce qui compte, c’est la nature initiale du personnage. On a parfaitement intégré et accepté l’idée qu’une femme puisse être indépendante, se revendiquer comme telle, et chercher à la défendre quand un →→→→→→→→→→→→→→→
goujat ose mettre la main sur elle. De l’émancipation à la captivité consentie…
C’est bien la romance mièvre, et le charme supposé de Valentino, qui pourrait servir de prétexte aux spectatrices pour faire de ce film un tel succès, mais en réalité ce qui aurait peut-être derrière cette fascination de la femme occidentale pour cette situation en apparence en totale contradiction avec les valeurs du féminisme, c’est bien le fait que cette femme se retrouve tout d’un coup captive et privée de ce qui lui était le plus cher : son indépendance, sa liberté. Le fantasme, il peut être autant de se voir dans les bras du cheik que de se rêver aussi émancipée que cette femme. À ce titre, il est intéressant de souligner l’importance du costume dans le film. On voit d’abord Agnes Ayres avec une robe de soirée typique des années folles, sans corset, la montrant pratiquement nue, et n’a pas encore la coupe en garçonne (mais les bouclettes typiques à la Mary Pickford) ; par la suite, elle porte dans le désert la tenue coloniale, invariablement asexuée. Quand le cheik la retient captive, il lui impose une tenue légère affreusement dégradante pour elle (rappelons-nous de la princesse Leïa dans le Retour du Jedi, c’est pareil). Elle n’est pas moins habillée qu’au début du film, mais l’humiliation qu’elle fait remarquer au cheik ne naît pas de sa quasi-nudité, bien du choix qui lui est imposé (et il est intéressant de noter que le problème persiste aujourd’hui autour de l’idée, et de la définition, du viol, ou quand on peut légitimer un crime en fonction de l’interprétation qu’on fait d’une tenue ou d’un comportement ; or, on est bien dans une société du paraître, et on peut jouer la docilité, tout en se refusant au dernier moment, parce que ce qui définit l’individu, et fait de lui un être libre, ce n’est pas ce qu’il donne à voir, mais ce qu’il dit : l’habit ne fait pas le consentement ; et au moins, ce film, en donne une preuve plutôt évidente).
2. Les Filles du docteur March (Jo)
Saoirse Ronan
(Louisa May Alcott/Greta Gerwig, 2019)

Je n’aime pas le film, cette manière de présenter les petits drames d’une famille bourgeoise sans histoire, mais il faut reconnaître qu’il y a au milieu d’une soupe immonde de piété filiale (on attend le père comme le Messie) l’embryon d’une forme de révolte ou de revendication qui deviendra un jour le féminisme.
Non seulement, le tempérament de Jo correspond en tous points aux caractéristiques définies par la liste (écrire est pour elle une passion, mais aussi un moyen de préserver son indépendance, de ressembler aux hommes, elle s’excuse même dans la version de Cukor de ne pas aimer en retour son meilleur ami, preuve que jusque-là elle n’était pas sensible aux choses de →→→→→→→→→→→→→→→
l’amour — avant d’y céder bêtement dans un revirement romantique laborieux), mais dans la version de Gerwig, elle assume jusqu’au bout cette indépendance. Pas de happy end dans lequel la fille un peu délurée se range du côté de la raison (donc des valeurs conservatrices).
L’émancipation est d’abord passée à travers les écrivaines du dix-neuvième siècle (les bourgeoises intellectuelles, voire les filles des grandes villes qui ont eu la chance de suivre une instruction — on pense à Ada Lovelace par exemple au milieu de centaines d’autres), puis les actrices (je l’ai assez rappelé dans cette liste), puis les suffragettes, puis les femmes qui tenaient la baraque quand les hommes tenaient le front, etc. La créativité, ça vous émancipe un monde.
3. It /Le Coup de foudre (Betty Lou)
Clara Bow
(Elinor Glyn, Hope Loring, Louis D. Lighton, George Marion Jr./Clarence G. Badger, 1927)

Le principe de la petite fille moderne, citadine, indépendante et maîtresse de sa vie amoureuse a été conceptualisé dès son apparition après la Première Guerre mondiale.
La It girl, avant que le cinéma parlant tombe dans le puritanisme, représente donc une facette de ce type de personnages revendiquant plus ou moins consciemment une forme d’égalité entre hommes et femmes.
Certes, les suffragettes et les mouvements féministes ont beaucoup fait pour cette cause, mais il n’y a probablement rien de mieux que le soft power du cinéma et de la littérature pour opérer une révolution.
Le film n’a rien d’un chef-d’œuvre, sinon je l’aurais ajouté à ma liste, mais il est représentatif d’une époque avant une inflexion des studios manifestée à travers l’application du code Hays.

Pour la forme, je ne pouvais pas ne pas inclure dans cette liste un film coréen. Petite compensation après y avoir placé autant de films japonais ? C’est surtout une manière aussi de pointer du doigt le retard dans ce domaine de la Corée du Sud. J’y aurais bien inclus La Chanteuse de pansori en forçant un peu, mais même si le personnage féminin est déterminé, elle n’en reste pas moins assujettie à sa condition de femme sans jamais interroger ce statut (on retrouve cette forme de soumission présentée comme naturelle, comme une évidence, dans les chefs-d’œuvre chinois, de la même époque, réalisés par Zhang Yimou). Même impossibilité d’y placer My Sassy Girl, qui profite certes peut-être d’un personnage féminin fort, mais si elle conserve son indépendance face à son homme, elle ne l’est plus du tout face aux choses de l’amour. Quant à Hong Sang-soo, il a les défauts et les qualités des films de Bergman : mettre en scène des femmes (parfois les siennes) ne garantit pas de s’extraire des clichés de genre en cherchant à appliquer aux femmes une vision de la femme ou de la féminité qui n’égalerait pas encore celle de leurs contemporains masculins.
Bref, si le pays veut poursuivre dans cette voie très volontariste de soutien à la production, il lui faudra user du cinéma pour servir de vecteur dans la population aux idées progressistes. Pour l’heure, le pays reste très conservateur. →→→→→→→→→→→→→→→
S’il continue à promouvoir des films toujours plus idiots au détriment des productions plus fines et plus inclusives, cela commencera à poser des problèmes dans les sociétés occidentales amatrices de leurs contenus.
Je ne suis pas tombé dessus par hasard : mon ex, Coréenne, qui avait un temps songé à devenir réalisatrice, me l’avait conseillé. On y trouve quelques-uns des défauts propres à ces films coréens manquant de finesse malgré une production relativement simple. En revanche, il possède une qualité rare, voire inédite, en mettant en scène un personnage féminin indépendant, solitaire peut-être, mais pour de bonnes raisons (on l’accuse d’homosexualité). Policière, elle se bat pour aider une jeune fille (oui, « esprit maternel, es-tu là ? » — il faut un début à tout) avant que ça se retourne contre elle.
Il y avait matière à faire bien mieux, en soignant quelques détails du scénario rendant le récit parfois trop peu crédible et stéréotypé. Mais voilà un film avec le type de personnages nécessaires dans une société qui s’est modernisée à toute vitesse en oubliant de faire évoluer sa mentalité avec (rien de plus normal pour un pays soumis si longtemps à diverses formes de dictature — on peut également considérer que le capitalisme reste un frein aux avancées sociales). Ceci expliquant cela, sans doute : le film est écrit et réalisé par une femme.

Comme dans beaucoup de films de rape and revenge, il y a une certaine ambivalence dans le personnage féminin principal. Son indépendance est présentée comme un accident ; il est sage de la considérer comme involontaire. Si elle se venge, c’est bien qu’on (les hommes) s’est emparés de son bonheur (conjugal et maternel : on parle de ce personnage comme de La Mariée).
Libre à chacun de trouver qu’il s’agit d’un nouvel exemple qui confirme la règle (la recherche du sentimentalisme et les valeurs du couple et du mariage placées au-dessus du reste) ou une forme de récit ayant au moins une vertu →→→→→→→→→→→→→→→
cathartique montrant que les femmes peuvent être à la fois indépendantes, décidées et même dangereuses. Une progressiste d’extrême droite en somme…
À noter aussi que Uma Thurman a souvent représenté un type de femme indépendante (dans Pulp Fiction, là encore, elle a beau être mariée, on pourrait la rapprocher de la Jill d’Il était une fois dans l’Ouest : c’est un objet sexuel, mais paradoxalement, cette situation lui garantit une certaine indépendance ; elle peut ainsi flirter avec l’homme de main qui la sort comme un toutou ou faire le choix… de se droguer.)

Jeanne d’Arc était-elle indépendante ? Doit-elle seulement être considérée comme une adulte saine d’esprit et par conséquent comme une femme ? N’était-elle pas plutôt une adolescente esclave de ses croyances ?
Il y a bien souvent la piété filiale qui oblige nombre de personnages féminins à se ranger du côté de leur père, à œuvrer pour la famille en pratiquant un sacrifice volontaire qui comme par hasard servira toujours l’ordre établi, mais il y a aussi la piété à l’égard d’un dieu qui traduit →→→→→→→→→→→→→→→
une autre forme de soumission. Si ces croyances doivent être prises au sérieux, alors autant considérer que Jeanne était unie au Christ…
Reste l’image d’une femme qui a été capable de soulever les troupes d’un pays derrière elle, si bien que son nom peut aujourd’hui servir d’antonomase pour qualifier un personnage féminin menant indépendamment et jusqu’au bout une cause qu’elle pense juste. Qu’importe la couleur de l’étendard, pourvu qu’il soit brandi par une femme ?

Certes, elle n’est pas tout au centre du récit et, certes, on pourrait voir en elle une forme d’Ariane moderne, autrement dit une nouvelle figure féminine venant en aide au héros véritable, forcément masculin.
L’intérêt me paraît bien ailleurs : à une époque où à Hollywood on sexualise volontiers les personnages féminins (même quand on fait Working Girl), l’agent Lewis jure par son absence d’attrait amoureux vis-à-vis du héros (ou j’ai oublié quelque chose ?). C’est aussi probablement le seul personnage positif du film (avec le héros) parmi les policiers (droite, pas vulgaire — on →→→→→→→→→→→→→→→
peut ajouter à l’agent Lewis, le personnage de Sarah Connor dans Terminator).
Ma mémoire me joue peut-être des tours, mais je suis un enfant de RoboCop, de Terminator et d’Alien, et tous trois ont forcément participé à me forger une idée de la féminité loin des canons sexistes de l’époque. Comme quoi, c’est aussi en sortant des sentiers battus et des stéréotypes que Hollywood a pu proposer à nouveau, un demi-siècle après, autre chose que des personnages féminins bien rangés et conformes à la représentation que voulaient s’en faire leur cher mari.
8. La Belle au bois dormant
(Charles Perrault, les frères Grimm, Erdman Penner/Clyde Geronimi, 1959)
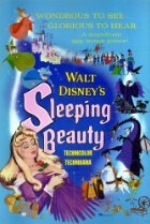
Je provoque un peu, mais puisque le conte (ou la version de Disney) a été taxé de sexisme, cela vaut bien un petit commentaire.
Est-ce que le conte est sexiste ? Eh bien, oui, comme 99 % des histoires racontées lors de ces cinq mille dernières années. C’est aussi sexiste d’ailleurs qu’anti-pauvre. Qu’attendre de plus d’un conte qui se veut moral, écrit par un grand bourgeois au service de l’aristocratie ?
Dans La Belle au bois dormant, le père et les bonnes fées s’inquiètent de voir le prince et la princesse, chacun de leur côté, avoir rencontré un amour qui n’est pas celui qu’on (les parents, la noblesse) leur a destiné. Les parents soufflent en voyant qu’en fait, l’amoureux rencontré était en fait celui qu’ils avaient décidé pour l’autre.
Je veux bien que ce soit sexiste, mais la morale qui consiste à respecter la conformité et le désir des parents pourrait être tout aussi problématique. Et si ce ne l’est pas, c’est que chacun, enfants compris, a suffisamment de distance pour comprendre qu’il est question d’un conte. Et s’ils ne comprenaient pas, les parents (ou n’importe qui) auraient toute légitimité à expliquer en quoi les personnages sont des stéréotypes, parce que les contes ne marchent pas sans archétypes et clichés, et en quoi ces histoires ont été écrites par des puissants pour raconter au bon peuple comment bien se tenir.
Si l’on est incapable de mettre de la distance avec ce qu’on regarde, on jette les mythologies pour leur violence et leurs absurdités, et l’on interdit un film sur deux dans l’histoire du cinéma (du temps de l’âge d’or du cinéma américain, on doit même tourner à 90 % des histoires, ce qui n’en fait pas de mauvais films ou des films à prohiber).
Chaque enfant est en mesure de comprendre que l’univers dans lequel baignent les personnages n’est pas réaliste, qu’il est sommaire, voire une caricature. C’est ainsi qu’une fable, un conte fonctionne.
L’enfant devrait être capable également de comprendre (c’est même à ça que servent les histoires ; comme les films d’horreur leur apprennent à apprivoiser leur peur) qu’il n’a pas à s’identifier à un personnage plus qu’un autre.
Dans La Belle au bois dormant, si bien sûr on n’en reste qu’à la dernière séquence du baiser (volé, certes, mais si vous avez le choix entre voler un baiser à une femme dont vous pouvez légitimement penser qu’elle n’en serait pas outrée, et qui, surtout, ben… la sauve, je ne sais pas, à choisir, vous la sauvez ou vous la laissez endormie ?), il s’agit d’une histoire d’un homme et d’une femme. Sauf que le prince et la princesse sont loin d’être les personnages principaux de ce conte. On pourrait même dire qu’ils sont tellement accessoires dans l’histoire qu’ils en seraient presque les victimes.
Comme tous les jeunes premiers en fait.
Au théâtre, les jeunes premiers, ce sont les personnages les moins enviables, car ils sont souvent fades, les instruments de puissances supérieures. Le baiser symbolise peut-être le passage à l’âge adulte, le mariage hétéronormé qui a eu cours ces derniers millénaires et qui obéit sagement aux normes parentales et sociétales, mais avant ça, ces deux jeunes premiers sont… des adolescents. Tout ce qui précède symbolise le chemin que l’adolescent doit accomplir pour devenir adulte.
Est-ce que devenir adulte, c’est devenir un homme et une femme ? Pas vraiment →→→→→→→→→→→→→→→
aujourd’hui, mais c’est comme ça que c’est conçu depuis toujours. C’est bien que l’on change les normes, mais on ne comprend pas une norme si l’on efface le monde et le passé contre lequel on a justement bâti cette nouvelle norme.
Mais alors, si le prince et la princesse ne sont pas des adultes, des adolescents idiots à qui pas grand-monde chercherait à s’identifier (franchement, je crois ne pas trop me tromper : oui, cette fin obéit à des codes sexistes, mais, non, les enfants ne vont pas s’identifier à des personnages qu’on ne voit qu’à la fin et qui surtout se font remarquer par leur inaction et par leur conformisme), qui sont donc les adultes et les personnages principaux de cette histoire ?
Les fées. Les fées, qui sont, nous dit-on, les symboles du destin. D’un côté les forces du destin positives (les trois fées et marraines de la princesse), et de l’autre, les forces du destin négatives (la méchante sorcière). S’identifie-t-on forcément aux personnages principaux d’une histoire ou se laisse-t-on porter par eux parce qu’ils nous divertissent ?
En réalité, les personnages que l’on prend pour modèles sont assez rares et, devinez quoi… Il est assez probable qu’on les choisisse, non qu’ils nous soient imposés. Si vous voulez prendre pour modèle la méchante sorcière parce que c’est une des méchantes les plus cool de l’histoire, pourquoi pas. Les trois fées ? Parce que ce sont elles qui ont le « pouvoir » de faire des choses ? Encore mieux. Cela ne signifie pas que vous chercherez à faire le mal ou que vous finiriez vieille fille (ce qui est une « fin » tout à fait honorable), mais que vous les trouveriez divertissantes. Et si elles le sont, encore une fois, c’est parce qu’elles sont actives et parce qu’elles ont du pouvoir (et ne sont sujettes à l’obéissance de personne).
Vous n’aimez pas le prince et la princesse ? Ce sont des gosses ! Vous avez peur que vous enfants s’identifie à des personnages stéréotypés et que ça perpétue une culture du viol ? Quel enfant s’identifierait à des personnages fades, secondaires et aussi prisonniers de leur destin ? Vous avez peur que cette représentation les enferme dans des codes qui ne sont pas les vôtres ? Très bien : montrez-leur le film et parlez-en avec eux, c’est à ça que servent les histoires. Pour qu’on les déconstruise et en parle après-coup. Une version où la mère se lie à la sorcière pour s’enfuir avec le prince charmant en laissant sa fille devenir la quatrième fée vous plairait plus ? Moi aussi ! Eh ben, écrivons nos propres contes, adaptons les précédents, ils sont faits pour ça. Personne ne dit qu’il faut souscrire aux codes sociaux et à la morale des contes écrits sous l’Ancien Régime.
Encore une fois, on a raison de rouspéter contre les images véhiculées dans le film ou le conte si l’on est assez idiot pour les prendre au pied de la lettre, mais dans ce cas, on devrait être assez idiot aussi pour souscrire aux autres idées rétrogrades qui y sont présentées. À moins que vous ayez peur que la monarchie présidentielle qui a cours en France soit le résultat de notre inclination pour les histoires de princes charmants ?
Et puis quoi après : La Belle au bois dormant reproduit la culture du viol, et Le Petit Poucet met en garde contre les dévoreurs d’enfants ? Le Petit Chaperon rouge vante le sacrifice des anciens ou l’extermination des loups ? Rassurez-moi, vous êtes capables de comprendre que ce sont des histoires ou vous avez trois ans et demi ? Bientôt, Roméo et Juliette n’est-il pas un hymne au suicide ?
Top 10 | Top 20 | Top 30 | Top 40 | Top 50 | Fin et mentions spéciales





