
Un petit chef-d’œuvre du cinéma vérité traitant de la question du viol et de sa perception avec une mise en abyme pouvant rappeler le dispositif d’Une sale histoire d’Eustache ou de quelques autres. Le film français reposait sur un exercice de style explicite de reproduction de la « vérité ». Aucun moyen ici de savoir ce qu’il se cache derrière la conception du film : s’agit-il d’une improvisation, d’une improvisation dirigée, de la reproduction d’un texte créée pour l’occasion, d’un témoignage réel ? La réponse à cette question reste ouverte. Et l’intérêt de ces quinze minutes repose sur le renoncement à y répondre.
Faut-il que les questions des spectateurs soient aussi obscènes que celles posées par un idiot de cameraman à une femme qui lui avoue avoir été violée ?
Un homme muni donc d’une caméra suit une femme chez elle alors qu’elle se maquille. Sorte d’interview impromptue comme on peut en faire quand on n’a rien préparé, ils plaisantent et cherchent un sujet de conversation digne d’être évoqué. L’extrait qui semblait alors sortir d’un catalogue des grandes banalités prend un tour inattendu quand la femme évoque tout à coup le viol qu’elle a subi la semaine précédente. Les questions du cameraman se font alors insistantes, obscènes, malvenues. Et l’on assiste, consternés, à l’épouvantable mise à l’épreuve de la parole livrée. Instant volé, séquence préparée ? Mystère.
Les victimes de viol souvent placées face au dilemme de parler, de témoigner, de porter plainte, d’être crues sans savoir comment, voient les conséquences cruelles de ce dilemme s’ajouter à leur traumatisme initial. Parler au risque de devoir se justifier, forcer les autres à se déterminer sur une vérité à laquelle ils n’ont pas accès ? Subir la suspicion, l’incrédulité, les maladresses ?
Cette courte séquence illustre bien ce dilemme de la victime craignant une forme de double peine si elle parle. Et à cela s’ajoute, pour nous, spectateurs, un double sens qui questionne : la place de la caméra peut tout aussi bien servir de facilitateur, aider à faire jaillir la vérité, que représenter un exercice de pure mise en scène. Au même titre qu’une femme qui témoigne de son viol et dont le récit est mis en doute, on ne sait ici si l’on peut croire ce que l’on nous raconte. La perception de la fiction et de la réalité devient trouble : le spectateur doit-il croire ce qu’il voit ?
Imaginons par exemple que le récit de ce viol soit exact et non une histoire racontée par nécessité du moment, non une improvisation (dirigée ou non) : en dehors de la situation un peu clichée et statistiquement moins vraisemblable qu’un viol commis par une personne connue de la victime (sauf si aux États-Unis à l’époque les viols pouvaient plus arriver dans un recoin sombre avec un inconnu brandissant un couteau pour vous menacer), le récit contient nombre d’éléments propres aux témoignages effectués par les victimes de viol. Incrédulité et mise en doute de la violence subie face à la manière dont la victime réagit ; difficulté à aller porter plainte et à fournir des preuves de son agression ; réactions déplacées de la personne à qui la victime se confie accentuant son traumatisme ; la peur ou la lassitude de ne pas être crue ; injonction à se comporter de telle ou telle manière, etc. En ce sens, on aurait tout lieu de croire que le film puisse aujourd’hui servir de support informatif dans le cadre de l’éducation à la sexualité, au consentement et au viol…

Reste le double sens du film : rien ne dérange plus que cette mise en abyme du doute. Notre incapacité, en tant que spectateur, à déterminer le vrai révèle immanquablement notre impuissance à réagir face à de tels aveux. Ce confusionnisme renforce, par analogie, le malaise et l’incertitude de la situation dans laquelle le vrai demeure insaisissable. Suspendre son jugement, mais à quel prix ? Si les doutes exprimés du cameraman frôlent l’indécence et s’ajoutent au traumatisme du viol, qu’en est-il des doutes du spectateur ?
En plus du film d’Eustache précédemment cité, il faut rapprocher No Lies du Symbiopsychotaxiplasm de William Greaves (1968) et du Bébé de Mâcon de Peter Greenaway (1993). Le court métrage de Block diffère des deux films expérimentaux (d’Eustache et de Greaves) dans le sens où l’on ne saura jamais le sens réel du film, de sa part de réalité et de préparation. Le film de Greenaway joue, lui, de la même manière, et grâce à la mise en abyme, avec la perception du réel ; le viol n’est plus seulement évoqué : il se produit devant les yeux du spectateur (mais lequel ?). Dans le film de Block, des questions demeurent. S’agit-il d’une séquence préparée entre l’actrice et le cinéaste ? Dans ce cas, le récit est-il authentique (l’un n’étant pas directement lié à l’autre : ils auraient pu se mettre d’accord pour raconter une expérience bien réelle) ? La séquence filmée n’est-elle que le résultat d’une improvisation dans laquelle tout serait inventé pour les besoins du film ou le fruit d’un aveu spontané et sincère (comme un appel à l’aide) ? Faut-il savoir pour comprendre ?
En matière de faux documentaires, de films d’improvisation, le spectateur (voire le critique) se sent souvent investi d’une étrange mission : picorer des informations dans le but de répondre à toutes ses questions. La suspension de jugement procure une forme d’inconfort qui doit être étouffé : certains savent forcément le « vrai ». Mais les questions de spectateurs sont-elles toutes légitimes ? L’inconfort doit-il sans cesse être combattu ? Et quand dans la vie, vous vous trouvez face à l’impossibilité de juger, sans « exégètes » pour aiguiller votre jugement, que faites-vous ? L’inconfort altère-t-il l’expérience et le sens que l’on donne à une œuvre ? Puisque l’art est essentiellement fait de malentendus, pourquoi aller courir aux nouvelles, après les vérités, et prendre le risque de dénaturer un film quand la réussite de celui-ci consiste justement dans le fait qu’il n’intègre aucune résolution capable d’étancher notre soif de vérité.
Il n’y a pas à croire : suspendre son jugement n’impose pas de méjuger les implications traumatisantes d’un crime. Si dans le réel, la formule performative « je te crois » peut s’adresser aux proches d’une victime qui se confie, face à un film, a fortiori face à un film vieux de plusieurs décennies, aucune intimité ne nous oblige à de telles précautions. L’ami, le parent, voire la simple personne à qui une victime ferait part du viol qu’elle a subi, n’est ni juge ni avocat. Il peut « croire ». Dans ce cas, le cameraman dans cette séquence est-il, lui, un paparazzi ?… Libéré de cette obligation de croire, le spectateur peut s’autoriser à questionner le vrai et mettre à l’épreuve sa capacité à suspendre son jugement (croire ou savoir si le dispositif proposé relève du mensonge de la création ou de la sincérité). Son ignorance ainsi mise en perspective avec celle du proche (ou du cameraman) qui exprime ses doutes doit lui faire prendre conscience du dilemme auquel sont confrontées les victimes quand elles font face à l’incrédulité de leur entourage ou quand elles préfèrent ne rien dire. Son privilège à lui, spectateur, il est de pouvoir éviter les maladresses et les indélicatesses. Ce confort relatif (confort du spectateur qui n’a pas à « croire », relativisé par l’inconfort de ne pas savoir si une séquence « dit le vrai ») doit le forcer à s’interroger non plus sur la réalité des faits, mais sur la manière dont lui réagirait face à un tel témoignage. Un film, littéralement, expérimental.
Pas mal pour une séquence d’un quart d’heure prise sur le vif (ou pas).
Revisionnage après des années à chercher parfois la référence de ce film indispensable (il figure d’ailleurs dans la liste de 1973). Le film a été placé à la banque des films du Congrès (The National Film Registry). Disponible ici.
No Lies, Mitchell Block 1973 | Direct Cinema Limited







 Année : 2017
Année : 2017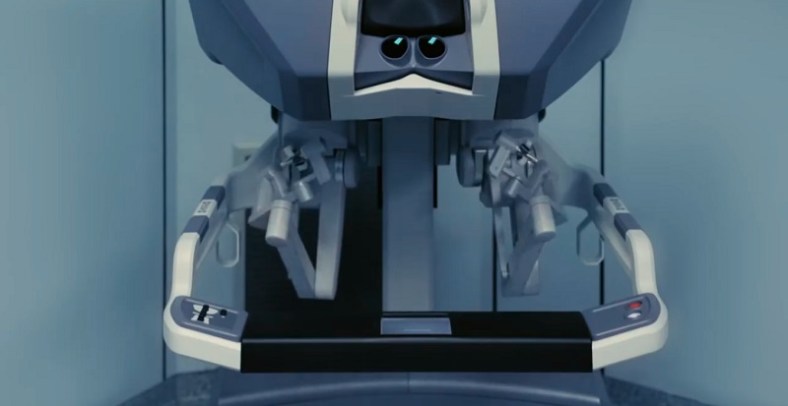
 Année : 2012
Année : 2012





 Année : 1896
Année : 1896


