Wagner en guerre (sans les Valkyries)

Le Temps de la colère

Titre original : Between Heaven and Hell
Année : 1956
Réalisation : Richard Fleischer
Avec : Robert Wagner, Terry Moore, Robert Keith, Broderick Crawford
Film intéressant sur la manière qu’a la guerre de changer les hommes… en bien.
Le personnage de Robert Wagner est un propriétaire terrien dans le Sud avant que les États-unis entrent en guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. C’est un beau salaud. Il est odieux avec ses fermiers qui cultivent son coton, les obligeant à travailler toujours plus, se plaignant qu’ils ne sont bons à rien quand lui n’a tout juste qu’à siroter son whisky ou à se prélasser sur le bord de sa piscine avec sa jeune épouse. Il vient de se marier et sa femme veut le voir à l’œuvre…, elle est servie. Elle lui fait la morale, mais rien n’y fait, les femmes sont bonnes à rien pour raisonner leur mari (ce n’est pas moi qui le dis, c’est dans le film). Comme tous les gens de son espèce, il espérait éviter la guerre ; c’est qu’il appartient à la garde nationale (ça rappelle quelque chose de plus récent…, ça doit être une coutume de fils à papa) ; mais son beau-père, général dans l’armée, lui apprend qu’il va être appelé, lui et son ami qui est dans le même cas que lui. Robert Wagner se retrouve donc au front, dans le Pacifique, et il gagne ses galons et une citation pour la silver star pour acte héroïque. Mais la guerre, sans qu’on explique pourquoi, l’a changé. Pour la première fois semble-t-il, il semble avoir trouvé des amis. Les bonnes valeurs de l’armée sont là (pourtant en 1956, on est plutôt au calme, entre la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, pas besoin de changer les vertus de l’armée…) : on est tous pareils, les gens de la haute sont potes avec les miséreux ; et Wagner n’oublie pas qu’il a été aidé par ses trois amis, « simples fermiers ». Enfin tous pareils, pas sûr. Parce que l’ami propriétaire terrien de Wagner, lui, n’apprécie pas trop cette amitié et le met en garde. Wagner n’en a que faire ; pour la première fois, il a trouvé de vrais potes. Il est devenu moins con. Le contraste est un peu rapide, peu importe, on ne va pas s’étaler en psychologie, c’est un film de guerre. Puis le beau-père de Wagner, général d’armée se fait tuer par un franc-tireur (on parle de sniper aujourd’hui, et c’est peut-être le terme original, mais j’ai vu le film en vf). À ce moment, l’ami de Wagner prend pendant un temps le commandement et décide d’aller vérifier une position qui ne nécessitait pas vraiment de patrouille. Il envoie Wagner et ses trois potes un peu en avant tandis que lui reste sur sa jeep, les mains sur la mitraillette « pour les couvrir ». En réalité, il est effrayé de se trouver si près du front, sans doute aussi par les responsabilités, et le bonhomme prend peur en entendant un bruit anodin et… canarde ses hommes… (un peu comme moi je canarde des spoils dans tous les sens). Seul Wagner y réchappe… « Tirs amis »… Wagner vient lui casser la gueule. Son « pote » n’aura rien, sans doute couvert par les généraux, alors que Wagner échappe à la cour martiale et à une probable peine de dix ans de prison, mais on lui enlève ses galons de sergent et redevient simple deuxième classe. Pour finir, il est envoyé à un avant-poste qui a plutôt mauvaise réputation. Celui-ci est dirigé par un capitaine qui se fait appeler « Waco ». Il ne se prend pas pour Kurtz, mais c’est pour éviter les snipers qui ont un goût assez prononcé pour les officiers. Cet officier fait tout pour rendre la vie difficile à ses hommes. La raison, on ne la saura jamais. Bref, Wagner se fait un nouvel ami fermier, c’est là qu’on revit tout son passé à travers de nombreux flashbacks, et il échappera seul de l’attaque du camp par les Japonais. Seul, avec son nouveau pote fermier, à qui il a promis une place dans son entreprise (Stéphanie Powers ira se rhabiller)… On ne verra pas le changement une fois retourné dans le Sud, on laisse ça à l’imagination du spectateur.


Pas un grand film, mais assez sympa à regarder et donc avec un sujet assez peu traité, même si on retrouve tout ce qui fait généralement les films de guerres. Pas de star, le personnage de Robert Wagner est plutôt antipathique (le film ne fait pas assez « rédemption » pour qu’il le soit, surtout manque la continuité temporelle : on quitte sans doute trop tard le petit con du Sud ; plutôt maladroit, parce que ça met l’accent sur l’être qu’il était et non pas sur celui qu’il allait devenir suivant un récit initiatique classique…). Je ne crois pas d’ailleurs que Robert Wagner ait jamais été sympathique dans un film… Il a un petit côté flippant, distant, qu’il avait même dans son personnage pourtant au second degré de Pour l’amour du risque… (Je ne vais pas rappeler l’anecdote de la mort de sa femme, Nathalie Wood, morte noyée alors qu’elle était sur un yacht avec lui et un autre acteur bien flippant, Christopher Walken…).
À noter la présence dans le rôle du beau-père général de Robert Keith, qui jouera l’année d’après un autre général, celui complètement maboul de Men in War, probablement inspiré par les légers signes post-traumatiques du personnage de Wagner (léger, parce que dans Men in War, le général est totalement lobotomisé, quand chez Wagner, ça se limite à des tremblements intempestifs).
Le titre français du film ne met pas vraiment en lumière, comme le fait le titre us, le côté volontairement manichéen de la fable : entre le ciel et l’enfer. Ce titre sera employé plus tard par Kurosawa, mais il était plutôt bon. Pourquoi changer ? (c’est vrai aussi que le titre us n’est pas non plus fidèle au titre du roman dont est tiré le film : Le Jour où le siècle s’acheva… — ça va, ce n’est pas prétentieux).
Et question que tous les fans de Robert Wagner se posent sans doute : est-ce qu’il a son fameux brushing tiré vers le côté avec deux mèches tombant faussement et négligemment sur le front ? La réponse est oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, même dans un film de guerre. Et des cheveux d’un brillant… Seul Alain Delon a pu rivaliser.

Joli split screen d’intro pour la bande-annonce. Le Temps de la colère, Richard Fleischer 1956 | Twentieth Century Fox






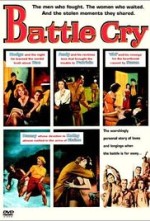


 Année :
Année : 
















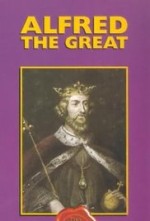 Année : 1969
Année : 1969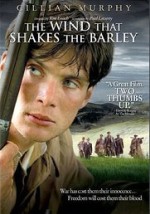
 Année : 2006
Année : 2006
 Année : 2006
Année : 2006