C’est un peu mon film fétiche. Je l’ai vu tout petit à la même époque que E.T, avant même Star Wars (normal, il y a un âge où on regarde ce que les parents regardent). Le film a eu beaucoup de succès à l’époque, mais pas autant que le film précédent de Spielberg (Jaws) et que les suivants (Indiana Jones et E.T). Si bien qu’aujourd’hui on ne le connaît peut-être pas autant que les autres films de Spielberg…, d’autant plus que son titre n’est pas terrible et qu’on pourrait le voir aujourd’hui comme une vulgaire introduction à E.T et que pour couronner le tout, le film est sorti six mois après Star Wars, de quoi profiter d’un premier effet de mode de la SF, mais de très vite retomber dans l’ombre du film de Lucas.
Reste que pour moi, c’est un chef-d’œuvre. Chez aucun autre cinéaste, on voit la vie de banlieue traitée comme Spielberg le fait ici. Il l’avait déjà fait dans Jaws, il continuera dans ET… Les scènes dans les familles sont absolument géniales, pas loin des meilleures scènes de Cassavetes (oui, monsieur). La différence, c’est que tel Shakespeare, Spielberg mélange les genres (oui, monsieur). Son film n’est pas une analyse sociale ou psychologique : il vise à montrer. Et il ne montre pas la vie ordinaire des gens, mais la vie ordinaire des gens embarqués dans des événements exceptionnels. Certains disent que c’est commercial…, que faisait d’autre Shakespeare ? Il informait son public tout en le divertissant. Tous ses personnages sont exceptionnels, tous les événements ou presque de son théâtre sont des moments importants de l’histoire, ou des histoires exceptionnelles. Spielberg et Shakespeare : même combat. S’il leur arrive de proposer une analyse, ou plutôt une vision d’un monde, d’une société, ils ne s’y attardent pas ; ça reste anecdotique dans leur sujet, parce que ce qu’il cherche avant tout c’est plaire, divertir. Aristote, il y a plus de 2000 ans, ne disait pas le contraire… Il n’y a que des snobs irrités aujourd’hui par le succès, coincés du cul (un peu constipé, je vais y revenir) qui méprisent ce cinéaste (tout en vénérant sans doute Shakespeare parce que c’est ancien, sans y reconnaître la volonté de l’auteur de plaire…).

Rencontres du troisième type, Steven Spielberg (1977) | Julia Phillips and Michael Phillips Productions, EMI Films
Qu’y a-t-il de mal à raconter des histoires qui plaisent ? Est-ce que Jésus est un prophète commercial ? Est-ce que Gutenberg méritait le bûcher parce qu’il a rendu possible l’accès à tous de la culture… à des plaisirs nouveaux. Il n’y a pas que la connaissance et le savoir dans les livres. Si on les lit, c’est aussi parce qu’on y trouve du plaisir. Si on aime les récits du vieux conteur à la lumière douce de l’âtre, c’est aussi pour en apprécier les effets magiques. Les conteurs d’antan cherchaient à émouvoir, bien sûr, ce n’était pas l’objet premier de ces histoires, car elles visaient avant tout à évoquer des événements passés. Mais si les conteurs avaient utilisé des méthodes prosaïques pour raconter leurs histoires, c’est que pour les diffuser, il faut bien un peu de magie, de rêve, d’exceptionnel. Il ne faut pas oublier l’origine de chaque histoire : c’est le conte oral et non la thèse. Les « pseudo-intellos » sont les fossoyeurs de la poésie, ils ne veulent pas voir le sens du beau et du mystérieux dans ces formes brutes de récit. Eux qui ne s’attachent qu’au fond, ne voient que la forme des films de Spielberg, que les effets de mise en scène, le désir de plaire…, et n’y voient pas tout le génie que cela comprend. C’est bien plus simple de faire un film froid, sans saveur, neutre, analytique. On paraît toujours plus intelligent quand on ne se mouille pas (et c’est bien ce dont il est question pour certains : paraître intelligent), alors que jouer avec le feu de la pyrotechnie, c’est prendre le risque de se brûler et d’en faire trop. Tout l’art réside dans la mesure. L’une des vieilles règles aristotéliciennes, c’est la vraisemblance… Si le récit qu’on expose est déjà un réel sans saveur, sans artifices, où est la difficulté de traiter de la vraisemblance puisqu’on s’efforce de montrer la vie telle qu’elle est vraiment ?
Bref, je parlais de ces scènes entre le personnage de Richard Dreyfuss et sa femme au milieu de leurs enfants. Des scènes que certains applaudiraient dans Une femme sous influence…, seulement, c’est du Spielberg, beurk, c’est mal vu, on ne doit pas aimer ce genre de dessert trop gras et trop sucré…

Pour être franc, je ne revois pas ce film tous les ans non plus. Mais j’avais lu quelque part que dans la version originale Truffaut jouait en français. Ce qui m’avait plutôt étonné parce qu’il a tout de même un rôle conséquent. J’étais donc curieux de voir la vraie version, celle où Truffaut parlait français et était traduit, en direct, si on peut dire. Et ce qui marque dans le film en fait, c’est que, en effet, le cinéaste français ne parle pour ainsi dire jamais en anglais, mais qu’il n’est pas non plus toujours traduit ! Ce qui doit donner aux spectateurs non francophones une impression bizarre, parce qu’ils entendent du français, ne le comprennent pas, et cependant, grâce au contexte et au jeu d’acteur très doinelien de Truffaut, doivent sans doute comprendre les trois quarts de ce qu’il dit. Et il n’est pas pour autant sous-titré. En fait, tout se joue dans la suggestion. Truffaut, c’est un peu comme le requin dans Les Dents de la mer : on ne le voit jamais et pourtant on est persuadé de l’avoir vu pendant tout le film. Truffaut, les Ricains ne le comprennent pas, mais au final, ils ont tout compris de ce qu’il raconte. Spielberg, s’il arrive à capter l’attention du spectateur, c’est bien qu’il arrive à faire travailler son imagination, contrairement à ce que pourraient penser certains, devant un film de Spielberg, on n’est pas inactif, stupide. Brecht visait à « faire penser », Spielberg vise, lui, à « faire rêver ». Il faut les deux…
On devrait d’ailleurs être fiers de l’image de la France dans ce film. S’il est parfois fait allusion dans des scènes du début aux Nations Unies ou à une organisation internationale de déchiffrement des codes envoyés par les extraterrestres, il n’y a que deux nations mises en avant dans le film. Bien sûr la France est souvent montrée en second plan, mais tout de même… Dans la longue séquence finale de la rencontre, les deux drapeaux qui flottent dans la base, sont les drapeaux ricain et français. Quand Richard Dreyfuss, demande avec véhémence qui est en charge dans la base, qui est le responsable, on lui dit que « Monsieur Lacombe est celui qui commande tout ici » À quoi il répondra : « Mais il n’est même pas Américain ! » En effet, ça peut paraître curieux. On est souvent agacé de voir que dans les mégas productions hollywoodiennes, les extraterrestres rentrent toujours en contact avec les Américains, s’il y a des colonies dans l’espace, il n’y a que des Américains… C’est un peu comme si sur Terre, il n’y avait que des Américains. Eh bien, là pourtant, dans peut-être le premier film du genre (il y a un peu du Jour où la terre s’arrêta, c’est vrai, mais ça fait loin), c’est un savant français qui mène la barque. Bien sûr, il y a les méchants militaires us avec leurs lunettes noires qui veulent prendre le contrôle, mais le véritable pouvoir, c’est Truffaut. — Pas très crédible, mais sympathique à voir. Spielberg fait d’une pierre deux coups : il rend hommage à la fois à Truffaut lui-même, mais aussi à Jacques Vallée, un des ufologues les plus connus à l’époque.

Le film est surtout connu pour cette longue séquence finale de la rencontre. Tout est transporté par la musique de Williams, les effets spéciaux de Douglas Trumball et par la mise en scène, attentive, précise, discrète de Spielberg. Mais ce qui m’a marqué encore plus, tout petit, ce sont ces séquences curieuses où certains personnages tentent de reproduire leur vision de cette montagne perdue au milieu de nulle part. Dans mon esprit d’enfant, c’était toujours resté quelque chose de mystérieux, je ne faisais pas le lien avec la suite. Pour moi, ce n’était pas une vision. Leur attitude mystérieuse demeurait inexpliquée. C’était des séquences où, tout à coup, sans aucune raison, des personnages se mettaient à jouer avec la nourriture, avec la terre, la mousse… Ce comportement devait éveiller des sentiments étranges en moi, parce qu’un personnage qui n’a comme intérêt que de dessiner, construire un énorme phallus de purée, il doit y avoir quelque chose d’une obscénité enfouie là-dedans… Mais surtout, c’est la scène où Dreyfuss fait une immense montagne de boue (pour ne pas dire de merde) dans son salon. Pour un enfant, il est autant interdit de jouer avec la nourriture que de jouer avec son caca (ou peut-être que c’est devenu un lien logique pour moi après ce film). Quoi qu’il en soit, pour moi, c’était bien ça, à cette époque, Richard Dreyfuss ne faisait rien d’autre que de jouer avec son caca… Sa quête, son obsession à lui c’était d’élever un immense phallus de merde dans son salon ! De quoi traumatiser un enfant…

« ET…télétron… maison. »
Et là, j’ose une analyse encore plus poussée (hi… hi… hi… — pas le son du vieillard qui rit, mais bien celui du petit Lim constipé sur son pot qui ne veut pas voir l’étron magique sortir de son popotin) que j’appellerai en toute simplicité : « psycacanalyse de mon troisième type à moi ». J’ai donc dit que j’avais vu ET à la même période… Et certains exégètes très sensés ont relevé que si les enfants aimaient particulièrement ET, c’est que celui-ci ressemblait à un véritable étron… Je passe sur les détails et le pourquoi pour un gamin un étron sur patte (de surcroît venant de l’espace) peut paraître si passionnant… Parce que pour moi, ce qui m’a le plus marqué dans ce film, ce n’est pas le départ larmoyant de la petite créature couverte de “boue” ou la connexion qui pouvait exister entre un étron de l’espace et un gamin de dix ans (et une fleur qui reprend vie grâce à l’engrais ET), non pour moi, c’est le mythique « ET téléphone maison, ET rentre à la maison »… Tellement mythique que j’amusais toute la classe en imitant la voix de la créature disant cette phrase. Je vous laisse le soin de faire le lien très spirituel entre mes constipations de jeunesse et le « ET go home ».
En fait, l’objectif de la dramaturgie, c’est de divertir et d’instruire. Depuis les Grecs, et sans doute bien avant, c’est ainsi. C’est seulement à mon avis, avec la naissance du théâtre épique de Brecht (qui n’a d’épique que le nom), et la théorisation d’un art de la distanciation pour faire réfléchir, que la dramaturgie s’est un peu détournée du public de masse (un paradoxe puisque c’était le but premier). Au Moyen Âge, on jouait des pièces, des farces, des bouffonneries, des pièces religieuses, sur le parvis de l’église. On mélangeait un peu tous les genres et c’était la télévision de l’époque. Le peuple, pour l’instruire (essentiellement de la chose religieuse), il n’y avait qu’un moyen : le théâtre. La chanson de geste, c’est le même principe : on chante les louanges des exploits des héros passés, ça avait une valeur informative, et personne n’aurait à l’époque l’idée de faire un truc austère, puisque l’idée est de toucher le plus de monde, d’instruire le plus de monde. Chez les Grecs, c’était la même chose, Aristote en parle même dans sa poétique : le but de l’art, c’est de plaire et d’instruire. Même chose en Afrique avec les contes oraux, en Asie avec les différents théâtres “chantés”…

Là, où c’est devenu un peu pervers, c’est que de fil en aiguille, puisqu’un genre en crée souvent un autre, une théorie en amène une autre, l’idée de départ de Brecht qui est de rendre moins bête le peuple qui devait sans doute à cette époque regarder la Star Ac’ de l’époque, est devenue ailleurs du pseudo-intellectualisme. De l’idée de départ d’instruire le peuple, on en est venu à faire une dramaturgie d’élite pour des élites. C’est quelque chose qui a plané dans l’air un certain temps sans s’imposer, parce qu’au milieu du XXᵉ siècle, on avait encore dans l’idée de plaire au plus grand nombre (cf. Jean Vilar, les films de l’époque qui sont à la fois exigeants et tout public). Mais tout s’est précipité, en France, autour des années 60. Ça a commencé par le Nouveau Roman. Robbe-Grillet, c’est intéressant, mais c’est de la littérature expérimentale. Le problème, c’est qu’on ne fait pas d’une expérimentation quelque chose de populaire, et avec l’augmentation d’une tranche de la population qui a accès au savoir, aux choses “intellectuelles”, bah ce genre de truc qui aurait dû rester underground a trouvé un public suffisant pour plaire et pour survivre. Mais surtout l’apparente simplicité du style, cet intérêt de s’attacher aux petites choses simples de la vie, aux non-dits communs de tout le monde, a donné la fausse impression que l’art, que la dramaturgie, c’était simple à faire, et que surtout, ça pouvait se suffire à lui-même dans une sorte de regard sur lui-même totalement effrayant. Cette époque, avec le Nouveau Roman, la starification de la philosophie ou plutôt du couple Sartre-Beauvoir, c’est le chant du cygne de la culture française, et la naissance du grand n’importe quoi. Le grand paradoxe, à cette époque, c’est que tout le monde s’émerveille de cette culture, elle est donc encore “populaire”, mais un art tourné vers l’intellect, vers la réflexion, la masturbation, vers les choses communes de la vie au quotidien, ça ne peut pas avoir comme vocation de plaire à long terme.

Un autre exemple très significatif de ce tournant, c’est la nouvelle vague française au cinéma (d’ailleurs cette multiplication de l’épithète “nouveau” devait être un signe qu’il y avait un truc qui se cassait la gueule). Les premiers films, en dehors de leur qualité (Le Beau Serge par exemple, c’est très moyen) sont véritablement novateurs. Mais c’est en rien une révolution… Les Italiens avaient remis les caméras dans la rue quinze ans plus tôt. Mais les films suivants sont sans cesse (en dehors des exceptions confirmant la règle) toujours plus élitistes. Et toute cette mentalité se propage, à cause de la puissance et du rayonnement d’alors de la culture française, partout dans le monde (en dehors peut-être de l’Asie). Alors malgré tout, il y a des génies qui naissent de ce grand n’importe quoi. Bresson, Bergman, Tarkovski… (quoiqu’il y avait aussi une culture de l’austérité chez les Scandinaves et chez les Russes bien avant que ça explose chez nous… Brecht avait d’un côté influencé les austères protestants et de l’autre les Slaves au sang chaud mais bridés par un pouvoir austère). Mais dans l’ensemble, puisque l’idée de cet art coupé de son public, n’a aucun sens, ça roule un peu comme des villages de consanguins. Les individus au fil des générations deviennent de plus en plus débiles, de moins en moins exigeants avec leur art tout en prétendant atteindre le summum de la création car faisant partie d’un cercle restreint « d’initiés ». C’est un non-sens total. Et ce qui a couronné le tout, c’est la révolution en 68. La liberté de faire n’importe quoi s’est propagée, on a vomi l’ancienne « qualité française », cette liberté devient la possibilité de mettre sur un piédestal le n’importe quoi, tout le monde se prétend artiste avant-gardiste, veut inventer quelque chose de nouveau (alors que les véritables savants eux savent qu’on n’a rien inventé depuis les Grecs, mais à ces savants, on a fini par leur couper la barbe et par leur faire manger pour les faire taire). Tout le monde produit, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil… Bref, on ne se rend pas compte qu’on est déjà dans le trou. Et le fossé entre un art d’élite et un art du peuple se creuse. Les uns méprisant les facilités et le goût de plaire, l’absence d’intérêt intellectuel, d’instruction, de l’art populaire et les autres méprisant l’austérité des nouveaux pseudo-intellectuels-masturbateurs… Les deux règles premières d’Aristote se scindaient en deux. C’est le schisme culturel. D’un côté, les partisans de l’art du “plaire”, de l’autre, les partisans de l’art du “instruire”. Tout ce petit monde ne se rejoignant jamais sans comprendre qu’ils ont tous les deux torts.
Fort heureusement, le monde a fini par se détourner de notre vision absurde de l’art, et on a cessé d’influencer le monde de nos idées idiotes. On retrouve ailleurs ce même schisme entre deux cultures distinctes, d’une part la culture Pop, qui ose à peine se définir comme une culture (en France, ce terme est tout de même devenu un gros mot = si on va dans la rue et qu’on demande à un type avec une casquette et un maillot de basket ce qu’il pense de la culture, il répondra : ah non c’est chiant la culture…) et de l’autre celle qui se prétend comme la seule culture légitime, celle qui fait de l’HArrrt.

Donc, nous, on continue, certaines cultures étrangères sont tombées dans le piège, mais la culture dominante du monde a fini par s’en moquer totalement. La culture américaine si on peut par exemple aujourd’hui bien voir une démarcation entre différents types d’œuvres…, on parle de cinéma indépendant par exemple en opposition au cinéma d’Hollywood, on a tout le mouvement underground new-yorkais (qui est apparu sans doute même avant tout le n’importe quoi français, mais eux, c’était surtout dû pour une trop grande concentration de talents du monde entier) qui touche à tous les arts… Mais globalement, il y a une même idée de plaire et d’instruire en même temps, en tout cas de plaire par l’exigence du contenu. Bien sûr, la culture us nous abreuve de bêtises chaque jour, mais il n’y a pas de secret : si tout naît là-bas, c’est aussi qu’il y a des putains de talents qui ne se demandent pas de quel bord ils sont, qui font les choses comme on les a toujours faites avant ce putain de XXᵉ siècle.
Alors oui comparer Spielberg à Shakespeare, ça peut faire vomir certains parce que ce n’est pas dans l’ordre des choses. Et au fond, ils sont très différents, si on oublie le point commun sur lequel je pointais le doigt en faisant cette comparaison : ce sont deux putains de conteurs qui atteignent l’universalité, qui sont au-dessus de toute querelle de clocher.
Alors, si l’un est méprisé parce qu’il est compris dans ce grand préjugé, que le théâtre, c’est vieux et poussiéreux, chiant (un bon tiers des pièces de Shakespeare sont des comédies et toutes ses pièces contiennent des scènes de comédie…, on oublie aussi que Molière n’écrivait rien d’autre que des comédies, que Cervantes n’en était pas loin… — alors, c’est passé de mode, mais découvrir un vieux truc, c’est un peu comme aller à l’autre bout de la planète pour découvrir une autre culture), et si l’autre l’est tout autant, parce qu’il a du succès, parce que ses histoires sont simples et compréhensibles de tous, que dans tous ces films ou presque il y a un rapport à la vision de l’enfant, à sa naïveté ; si l’exotisme et l’aventure sont perçus comme des puérilités de seulement dignes des fêtes foraines ; si on ferme les yeux sur son génie de conteur…, alors oui, c’est bien, bien dommage. Tous ces gens-là se privent bêtement de cette saveur universelle connue depuis des millénaires par les conteurs et les spectateurs : le mélange parfait du plaisir et de l’instruction.
Que font les jeunes animaux pour apprendre à survivre dans la nature ? Ils jouent. Nos propres enfants font la même chose, les spectateurs font la même chose. Si je m’ennuie, je n’apprends rien ; si je m’amuse, si mon plaisir est mis en éveil, j’apprends, je m’enrichis. C’est à la base de notre nature.
Ouh là, désolé pour la montagne de merde… !






 Année : 2008
Année : 2008
 Année : 1972
Année : 1972
 Année : 2007
Année : 2007



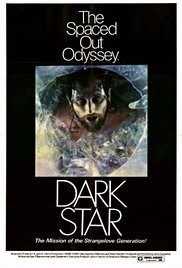
 Année : 1974
Année : 1974
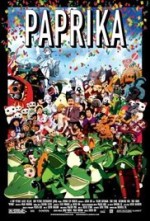


 Année : 1983
Année : 1983












