Don Siegel avait tout de même l’art dans les années 70 de proposer des films, et un ton surtout, comme on n’en aura jamais vu par ailleurs ni avant ni après. À part Dirty Harry qui ne m’a pas laissé un souvenir impérissable, je suis un inconditionnel des Proies et de Sierra Torride. Et si on parle d’auteur, il y a là bien une marque siegelienne à laquelle cet opus peut se rattacher, faite d’humour, de nonchalance, de nihilisme, de faux masochisme, et synonyme aussi de grand spectacle avec mouvements de fuite, musique tout aussi nonchalante (signée du génial Lalo Schifrin) et images flamboyantes.
Le début du film, le casse d’une banque de l’Amérique d’en bas, est un modèle de thriller et de suspense, mais aussi de montage alterné. Belle gageure, la séquence étant un véritable archétype du genre… Possible par exemple que, si le film est un hommage à La Mort aux trousses surtout sur la fin, que cette séquence soit, elle, un hommage détourné à Gun Crazy où on retrouve la même configuration qu’ici : un même coin paumé, une femme au volant (cette fois, c’est elle qui est déguisée, ou qui porte son habit de scène, comme plus tard Varrick portera le sien), qui attend son homme (ici Walter Matthau et deux autres acolytes). Différence notable, c’est que ce film de Joseph H. Lewis sorti en 1950 est surtout connu pour cette scène tournée… en plan-séquence (on trouve la scène sur Youtube) et qu’ici Don Siegel opte pour un choix totalement opposé en multipliant les sujets, les points de vue, pour former une géniale séquence en montage alterné.
L’histoire est tirée d’un roman écrit par un inconnu (et dont le titre original me semblait bien meilleur que Charley Varrrick : The Looters, Les Pilleurs), mais ce n’en est pas moins un modèle. Le film noir est mort, le polar siegelien débarque. La brutalité n’est plus celle des méchants de l’ombre, mais bien celle du héros principal. De vrais mauvais garçons, et pire que tout, des malfrats sympathiques. Après quelques décennies de code Hays, il faut réinventer le genre qui s’était à peine dessiné en « crime films » au début des années 30. Fini les grandes villes, bonjour l’Amérique profonde, voire parfois la banlieue de Los Angeles, autrefois trop claire pour servir le film noir (c’est une généralité, voire un archétype imaginé a posteriori sur une poignée de films, Fallen Angel de Otto Preminger est un exemple de film noir tourné en Californie). Adieu les femmes fatales, bonjour les femmes-objets dans une société où c’est l’objet qui nous domine (sorte de mix étrange entre pseudo-féminisme et critique du matérialisme de la société de consommation).

Charley Varrick, c’est l’alliance improbable du western qui se meurt dans son crépuscule et le film noir qui s’est déjà mouru dans l’ombre plus d’une décennie plus tôt. Le polar à la sauce 70 vient trotter sur les pas de Hud (Martin Ritt, 1963) ou de Seuls sont les indomptés (David Miller, 1962) : la mort du western où les grands espaces ne sont plus que des terrains vagues ; chapeaux et santiags sont là pour faire jolis, les chevaux ronflent maintenant sous les capots d’étranges chars métalliques, et la place des duels du village est remplacée par une piste d’atterrissage improvisée au milieu des épaves automobiles… Les ombres du film noir ont disparu, la tonalité est la même ; l’ombre au tableau, identique, on l’éclaire désormais d’une lumière criarde et de paillettes. Le folklore pour mieux cacher les désillusions d’un monde à l’agonie ; l’humour et le cynisme comme seuls moyens de subsistance ; le Nouvel Hollywood, qui recueille les lumières expirantes des phares inaccessibles des boulevards aux étoiles entre deux sorties d’autoroute, entre deux mégapoles, à la frontière du désert qui maintenant n’est plus rien sinon un dépotoir et une zone morte depuis que le Pacifique n’est plus un rêve, un but, mais un mirage ne reflétant plus que les lumières fardées et autocentrées de l’usine rêve : Hollywood.
Charley Varrick dévalise une banque, cela pourrait tout aussi bien être un hangar, un studio de cinéma. Il y aurait trouvé le même argent sali par l’orgueil, les fausses illusions, les mêmes connivences troubles, les mêmes mensonges. Varrick y perd sa femme, c’est un homme maintenant libéré de toute contrainte qui va pouvoir savamment, patiemment, froidement, tout faire valser. Dirty Varrick. Seul contre tous, d’abord contre son embarrassant complice, puis la police, et enfin la mafia. Les armes du cygne ? Un peu de dynamite pour tout faire exploser et de jugeote pour s’extirper d’un piège dans lequel il est tombé, s’en extirper comme on prépare le grand casse du siècle. Un magicien de la piste notre Varrick : il cite Hitchcock, mais c’est bien avec surprise qu’il nous appâte aussi et finit par nous tromper. Un tour est un tour, quoi qu’en dise Alfred : on devrait s’attendre à être trompés, mais le stratagème est trop bien ficelé pour ne pas nous éblouir quand il nous pète à la figure.
Pour garder une longueur d’avance (Varrick l’avait déjà en comprenant qu’il était tombé dans un piège qui n’était pas tendu pour lui, ni pour personne), ce franc-tireur, solitaire intégriste, impose le terrain à son adversaire, impose ses propres apparences et son expertise (le choix de l’arme). Les gros poissons se laissent toujours tenter par les plus gros appâts, même si ça les fait sortir une seconde de leur élément. Et l’ancien Hollywood, avec ses complices de la société de surconsommation, ces mafieux qui ont troqué depuis longtemps les flingues pour les sourires hypocrites, tout ça peut alors se faire voir dans un dernier bûcher. Varrick y cédera la part misérable qu’on lui prêtait pour le casse, et se joue ainsi des apparences d’un monde qui l’avait dépossédé de tout.
Voler les escrocs par l’escroquerie.
La misère matérialiste, quand elle sait travailler avec sa tête, peut se révolter et tout faire péter dans ce monde d’escrocs. Avec la seule idéologie qui vaille alors : le nihilisme. Un coup de pied dans la fourmilière et au revoir. Aucun message, aucune morale. No future. Quand ça vient d’un flic, c’est réactionnaire ; quand c’est un ange vengeur, tout lui est permis. Choisis ton côté de la barrière.
À croiser avec Le Point de non-retour.

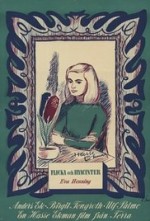 Année :
Année : 










 Année : 1985
Année : 1985



 Année : 2016
Année : 2016


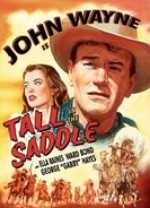 Année :
Année : 















 Année : 1960
Année : 1960
















