Mélo sans grande envergure avec un scénario tenant sur une page et un temps diégétique approchant les 24 heures (ce qui n’est jamais bon signe pour un long métrage, à moins d’arriver à y multiplier les péripéties ou à y jouer sur la tension – ou les dialogues –, ce qui est loin d’être le cas ici).
Faute de matière dramatique, Delluc ne peut donc se reposer que sur deux choses : le montage et les acteurs. La règle à l’époque, c’est l’usage souvent outrancier des flashbacks et le recours quasi systématique au montage alterné. Compte tenu de l’argument du film (les souvenirs de bonheur amoureux d’une femme revenant dans son ancienne maison où l’actuelle occupante se retrouve de la même manière poussée à répondre à l’appel de son amant…), les flashbacks s’imposent, c’est même le cœur (un peu trop) du récit. Mais le recours permanent au montage alterné est plutôt le signe ici d’un vide dramatique évident. Quand on multiplie les va-et-vient et que rien ne se passe, c’est là non plus jamais bon signe. Et si rien ne se passe, c’est d’une part parce que les situations définies sont légères et sans nécessité de les montrer dans la longueur, mais c’est aussi parce que Delluc, tout écrivain qu’il est, se trouve bien embarrassé à remplir le cadre quand vient à dicter à ses acteurs quoi faire.
On peut bricoler avec le montage, avec les acteurs, difficilement. Ce manque de savoir-faire en matière de direction d’acteurs est criant dès la première séquence quand son histoire lui impose de devoir mettre en scène un petit garçon (si certains cinéastes pensent que des acteurs se dirigent tout seuls, c’est pousser le bouchon un peu loin quand on se dit qu’un môme sachant à peine parler peut automatiquement « entrer dans le cadre d’une situation définie par un scénario » sans y être préparé…) : on voit bien qu’il lui donne quelques indications, mais ces indications sont non seulement trop visibles de là où on est (on voit bien que le môme va là où on lui demande sans savoir pourquoi, attend les indications, et est totalement perdu dès qu’il a fait le peu qu’on lui demande), mais surtout elles n’ont aucun sens, aucun rapport avec la situation.
C’est valable pour le petit garçon, mais on retrouve ce même défaut de mise en place et de mise en situation pour tous les autres acteurs. C’est ce qui arrive quand on demande à des acteurs de meubler quand la situation est molle et s’éternise. Pire, les acteurs peuvent être tentés d’en faire des tonnes, et c’est ce qui arrive fatalement avec Eve Francis, qui n’a en réalité que très peu d’interactions avec les autres acteurs et dont le principal travail consiste à répondre à des évocations en flashbacks de son passé ou à voir son hôte de loin retrouver son amant… Pas étonnant d’ailleurs de voir que l’actrice travaillera par la suite avec Paul Claudel, on n’est pas du tout dans le registre réaliste ici (contrairement à ce que j’ai pu lire : les décors naturels ne font pas le réalisme), parce qu’en passant il n’y a rien de plus lyrique (et même de plus idiot et d’impossible à jouer) qu’un texte (souvent avec des situations mal définies d’ailleurs) de Paul Claudel. Ainsi, quand on doit meubler dix secondes une réaction en réponse à une autre action hors-champ qui compose avec elle la séquence en montage alterné, eh bien on surjoue. Et encore, si on surjoue, ça veut dire qu’on a compris la situation ; or, il arrive même que les acteurs ne comprennent même pas quelle situation jouer ou se perdent en route.

La sobriété d’Eve Francis dans La Femme de nulle part, Louis Delluc 1922
Et je ris quand même en lisant que Delluc serait l’initiateur de la sobriété du jeu au cinéma. En termes de directives données à ces acteurs, oui, je veux bien le croire, au point même de les perdre. Sobriété dans le jeu, eh bien non, la preuve. Et on ne pourrait même pas émettre l’idée que les excès de Eve Francis soit le fait d’un choix de Delluc, non, si tous les acteurs jouent sans style cohérent, c’est bien qu’il soit question ici d’un laisser-aller et d’une méconnaissance des règles de la direction d’acteurs ; ce qui se conçoit d’ailleurs pour un écrivain. La différence ici avec ses lointains successeurs « critiques devenus cinéastes », c’est que mise à part Rohmer par exemple qui connaîtra exactement les mêmes déboires en termes de direction d’acteurs faute de pouvoir leur offrir de réelles situations de jeu, des cinéastes comme Truffaut ou Chabrol ont toujours fait appel à des stars… derrière l’écran pour écrire des scénarios cohérents et compréhensibles pour qui les lisaient, ainsi que devant, capables, eux, de restituer grâce à leur talent des situations, comprendre les évolutions de leur personnage, etc., sans avoir à se référer à un metteur en scène. Et par la plus belle des ironies, si Delluc est crédité au scénario, il est rapporté qu’il serait inspiré de « chroniques » écrite par l’actrice — ça n’expliquerait alors pas combien l’actrice est perdue, mais que Delluc au contraire lui ait tant laissé de libertés.
Certains seraient alors peut-être tentés de penser que les outrances pantomimiques, c’était la règle à l’époque. Eh bien pas vraiment en fait. Si on retrouve ces excès souvent parodiés (déjà à l’époque) dans les films dits d’art avec des acteurs de la scène, et tout autant dans nombre de mélos mal joués, ça fait quelques années déjà que même sur la scène, le naturel a fait son arrivée et que le cinéma a compris que ces nouvelles méthodes de jeu étaient particulièrement faites pour le cinéma. L’un des apôtres du naturel au théâtre, André Antoine, vient de tourner L’Hirondelle et la Mésange, mais il est loin d’être le seul à adopter ces nouvelles techniques au cinéma. Et en Russie, si les méthodes de Stanislavski sont déjà bien développées, au cinéma, on commence aussi à comprendre qu’une superposition de plans sans émotions apparentes suffit à dire plus que les outrances « romantiques » héritées du théâtre du siècle précédent. C’est ce qu’on appellera longtemps après effet Koulechov, mais on voit les effets déjà de ce principe dans un film comme Homunculus d’Otto Rippert tourné en 1916 dans un montage là aussi (ou déjà) entre plans du passé et réactions de celui censé se rappeler ces événements. Je l’évoquais sur cette page dédiée au montage-séquence. Jouer la situation pour un acteur, dirigé par un réel metteur en scène, ça peut se limiter parfois à faire confiance à la superposition des plans placés l’un après l’autre. Ici, Eve Francis joue comme une actrice de théâtre (pire, comme une actrice de Claudel) qui se supplante à la fois au metteur en scène et au monteur (et pour cause) et qui doit par ses seules expressions suggérer l’existence d’un « hors-champ ». À partir du moment où le cinéma montre et fait dialoguer champ et hors-champ grâce au montage alterné (ou à un champ-contrechamp quand les acteurs sont dans un même lieu), ces excès expressifs deviennent inutiles. Et Delluc n’a aucune prise sur ses acteurs : qu’il soit face à une actrice de la scène bourgeoise comme Eve Francis ou face à un môme de quatre ans, le résultat est le même, il pense que le montage fera tout alors que ce qui se passe dans le cadre est tout aussi déterminant.


Un exemple saisissant de l’incompétence flagrante de Delluc en matière de mise en scène (ici la direction d’acteur et la mise en place — je reprends mes vieilles définitions, séparant travail de « mise en scène » et de « réalisation », réalisation qui concerne alors le travail lié au découpage technique, au placement et au mouvement de caméra, etc.) : quand la mère quitte la maison et court dans l’allée poursuivie par son gosse, au-delà du fait que la continuité de la scène est passablement heurtée par le montage, non seulement elle ne le sent pas venir derrière lui, mais elle joue la peur en regardant de part et d’autre derrière les buissons comme s’il y avait un loup capable de venir la croquer pour la punir de fuir son foyer… Ça n’a aucun sens. J’ai été acteur, des acteurs qui font n’importe quoi parce qu’ils ne savent pas quoi ou comment le faire, c’est fréquent… en répétition, c’est alors au metteur en scène de recadrer tout ça et lui montrer la voie pour retrouver la cohérence de la situation. Mais il y a fort à parier que si Delluc est crédité pour avoir été l’inventeur du terme « cinéaste », il ne l’est pas vraiment pour celui de « metteur en scène » (terme qui, au moins au théâtre, est censé avoir été inventé justement par André Antoine). C’est même un des maux du cinéma français « d’auteur » jusqu’à aujourd’hui : un cinéma fait par des écrivains, des littéraires ou des critiques, qui n’ont aucune notion de la scène, de la direction d’acteur, donc de la situation. Or, le cinéma, c’est avant tout un art de la situation, et ça qu’on le veuille ou non, c’est bien un héritage du théâtre. On pourra toujours multiplier les cartons poétiques (il y en a une jolie pelletée dans le film), jouer du montage (ce qui inspirera d’une certaine manière, je veux bien le croire, toute une génération d’« avant-garde »), faire le choix des décors naturels (avec tous les problèmes des raccords que ça implique), la base du cinéma, c’est un acteur dans une situation. Si on n’est pas capable de reproduire cette illusion, c’est mort, on n’y croit pas.
Et j’en reviens au montage. On est peut-être (encore) en 1922, mais c’est un festival de faux raccords. L’usage démesuré du montage alterné notamment pousse parfois Delluc à forcer des raccords en champ-contrechamp aberrants : un personnage regarde hors du cadre vers où d’autres personnages sont censés se tenir, mais évidemment bien trop loin pour être à porter de son regard ; le montage alterné rend parfois aussi compliqué le montage et le respect d’une continuité temporelle : quand l’amant part en voiture dans un premier plan, on y revient plusieurs minutes après avec un raccord par le regard du mari censé le voir partir au loin… alors que la logique voudrait que ça fasse bien longtemps qu’il soit parti…
Bref, on sent poindre l’impressionnisme, c’est vrai, grâce au travail sur le montage (même si à l’époque, tout le monde s’enthousiasme pour le montage alterné et les flashbacks), mais c’est tout de même le travail d’un joli amateur. Les apports de Delluc au cinéma (s’il y en a) sont sans doute ailleurs. Dans le domaine de la théorie et de la critique.




















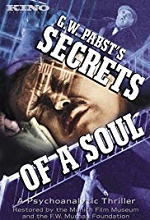








 Année : 1919
Année : 1919







