21 décembre 1996
Commentaires croisés concernant deux films de télévision (enfin croisés…, je survole à peine, ça me sert surtout de tremplin vers mes habituels tunnels de tripotage solitaire) : Le Jardin des plantes et La Dernière Fête. Le premier est de De Broca avec Claude Rich, le second avec Charlotte Ramping.
Les deux films sont représentatifs d’une certaine qualité française (pour plagier les Caillés). On peut remarquer, c’est certain, une certaine qualité technique, un savoir-faire, une interprétation correcte… Tout cela est plutôt compréhensible compte tenu de la forte tradition en matière artistique dans notre pays, dans ces deux domaines. À ces deux seuls domaines, je devrais dire, car il apparaît que pour la critique et les cinéastes (qui depuis qui l’on sait est grosso-modo la même chose) seule la beauté (vide, photographique) de l’image et l’excellence du jeu (à quoi pourtant ceux qui commentent ne connaissent rien) comptent. On se demande même comment on peut encore arriver à pondre de tels techniciens et de tels acteurs tant ce qu’on leur invite à faire est rarement ce à quoi ils aspirent (en tout cas au début, le métier a vite fait de corrompre nos fragiles intermittents du bulbe). Ma réponse est toute simple : prenez cent mille acteurs au hasard dans la rue (oui, oui, tout le monde peut être acteur), parmi ces ignorants en matière “comédiesque”, technique, on trouvera toujours un Alain Delon. C’est même devenu une constante dans ce métier, seule la personnalité compte. Soyez donc des blaireaux chers amis acteurs, les gens honnêtes n’auront pas d’histoire. Je me prononcerai moins sur la question technique rattachée aux différentes techniques propres au cinéma, j’y connais rien, mais quelque chose me dit qu’il ne faut pas du génie pour éclairer un cul ou coller une image à une autre (il y aura toujours des exceptions, mais ici je me contente de parler de la règle).
Tout va donc pour le mieux dans ces deux domaines. Reste l’essentiel pour faire du bon cinéma, du moins, pour sortir d’une forme de cinéma exercé par des fonctionnaires, radotant les mêmes habitudes, ne prenant aucun risque donc s’interdisant tout potentiel subversif ou expérimentation, et restant toujours à la surface molle des choses : une histoire qui en vaille la peine (si on ne peut juger d’un scénario parce qu’un scénario en lui-même n’est ni produit, ni jugé, ni finalisé, ni une pièce d’art quoi, on peut juger, au moins, du résultat à l’écran) et la mise en scène (j’entends par là, la capacité du décideur de porter un regard particulier sur cette histoire, offrir un angle, accentuer telle ou telle détail qui paraîtrait insignifiant pour quelqu’un d’autre, etc.). C’est là, il me semble, que le génie, doit s’exprimer. Les techniciens pourront être les meilleurs artisans du monde, ils ne poseront pas un regard sur ce qu’ils produisent et c’est ce regard, seul, qui sera offert à celui du spectateur ; et les acteurs, ma foi, qu’on me présente un acteur de génie, je l’embaucherais immédiatement pour frotter mes lampes (entendez par là, qu’on ne demande pas à un acteur d’être “génial”, on lui demande d’être « aux ordres », de se mettre au service de ; l’acteur, c’est un soldat ; après, qu’on cherche à faire de ces soldats des vedettes et qu’ils soient chargés de la promotion, c’est parfaitement naturel, on préfère inviter à sa table un mec sympa, ou un blaireau sachant toutefois rester sympathique le temps d’une soirée entre amis où il saura parfaitement animer nos convives, plutôt qu’un intello prétentieux qui aurait en plus la vulgarité d’avoir du génie, et qui seul serait finalement capable d’expliquer ce que personne n’aura envie de se voir expliquer).
Alors bien sûr, il est tellement facile de penser que l’un et l’autre (bonne histoire et mise en scène) vont de soi. C’est vrai, après tout, prenez ces mêmes dix mille passants pris au hasard au début, il suffirait d’un seul pour trouver que tel ou tel film sort du lot, pour que finalement, il soit tout à fait légitime de porter du crédit au moindre navet. On ne m’en voudra pas donc de parler pour moi-même et de considérer les qualités qu’une histoire doit posséder, ou de son serviteur, la mise en scène, en fonction de critères hautement personnels. Certains cinéastes donc, donnent l’impression que la seule difficulté de leur travail, la seule utilité, serait de reproduire le réel. Je ne suis pas le seul à le penser, c’est même une idée assez répandue quand il est question de critiquer le cinéma de nos tièdes latitudes, on parle parfois d’ennui d’un certain cinéma attaché au quotidien, à l’insignifiance de son intimité… J’irai même plus loin en parlant d’horreur de l’artificialité. Voilà donc une culture où chacun se doit d’être original, abhorrer le « non-vrai », et où finalement tout le monde tourne en rond à force de répéter les mêmes âneries « sur l’art ». L’authenticité, la sincérité, l’originalité, tout ça, désolé, c’est du vent. L’artifice, c’est du concret. L’artifice se structure, se conceptualise, se fragmenter, se regarde, se fait montrer du doigt, se totemise, sert d’urinoir ou de combustible. Le problème, c’est que si l’artifice est concret, il s’apprend. Les années 60 et 70 sont passées par là. Apprendre, c’est juste bon pour un technicien qui va coller ses deux images ou quelle focale utiliser après la digestion du midi. Le cinéaste (ou le scénariste, mais lui est pratiquement porté disparu) doit donc laisser s’exprimer son moi intime ou je ne sais quelle autre connerie certes fort originale mais qui ne se traduira d’aucune façon à l’écran. Au mieux, on en arrive comme ici à une mise en scène plate, sans relief, sans point de vue, inexistante quoi ; au pire, le cinéaste ira lui-même assurer le service après-vente pour rappeler au spectateur à quel pointe il mérite leur attention, et que seules seraient à juger dans son film, ses intentions, alors même que là encore rien de tout cela ne serait traduit à l’écran. L’époque est même au film d’époque tourné avec les manières d’aujourd’hui. Et on a le culot d’appeler ça “réaliste”, “crédible”, “authentique”. Non, on ne se tient pas aujourd’hui comme hier, on ne parle pas de la même façon, on ne se comporte pas avec autrui de la même manière, une femme de ferme n’agit pas comme une grande bourgeoise, etc., etc. Mais il suffit de dire qu’on joue ou présente les personnages avec toute son authenticité et on aura toujours raison. Certains ont le monopole du cœur, d’autres celui de l’authenticité. Et je rappelle Alain Delain au centre de la scène : lui était dirigé, c’est toute la différence (Visconti en était même arrivé à en faire un acteur de théâtre, c’est dire). Bref, on se retrouve avec des films mous, qui ressemblent à rien (sinon à la vie, et c’est pas un compliment), dans lesquels la forme manque de fond et le fond manque de forme (génération seins nus, c’est plus naturel – ah, sûr ! mais moi je la laisse au sauvage la nature, je suis civilisé et j’aime l’artifice, parce qu’il offre différents sens, différents regards ou forme, à ce sein qui bien que poilu, plat ou tout vergeturé, ne saura se laisser mieux voir que quand il reste invisible).
Prenons un exemple grossier d’artificialité (compréhensible par tous) : le rythme. Un metteur en scène a deux solutions opposées, extrêmes. Soit il choisit de ralentir le rythme, soit de l’accélérer (je passe sur les manières d’y arriver, pour rester simple). Malheureusement, il existe une autre alternative. La pire, celle de ne pas choisir. Les acteurs ont une fascination coupable pour le “vrai” (ils perçoivent qu’il y a là quelque chose de juste et de nécessaire dans leur art mais sans maîtrise de leur art, ils se contenteront de croire que leur art se contente d’être une recherche permanente du “vrai”), et de nombreux metteurs en scène ont également cette obstination, seulement le “vrai”, c’est le vide, c’est l’insipide. Une fois qu’on parvient à un résultat, dans la recherche de l’authenticité, c’est bien, mais après ? L’authenticité n’offre aucun sens. Le travail du metteur en scène, c’est de proposer un regard. Donc de faire des choix. Et tout est prétexte à choisir, parce que le moindre détail peut forcer les apparences pour guider le spectateur vers l’endroit où on veut le mener. Ralentir, accélérer, à tel endroit ? pourquoi, comment ? Après tout, peu importe la direction prise, le choix, on pourra toujours juger de ces partis pris, après. Mais on ne peut pas se soustraire à ces questions de choix. Alors bien sûr, sur cette seule question du rythme, on trouvera toujours des contre-exemples. Mais si par ailleurs, d’autres choix sont faits, toujours pour insister sur des détails, montrer telle ou telle chose selon tel ou tel angle… on peut tout à fait choisir d’adopter un rythme neutre, ronronnant, mais on percevra d’autant mieux ce choix (puisque là c’en serait un) si d’autres choix, clairs, sont pris par ailleurs. Celui qui s’applique à ne jamais rien froisser, à n’avoir d’avis sur rien, à contenter tout le monde, il doit cesser de faire ce métier et se lancer dans la diplomatie (ce à quoi certains milieux tendent à devenir effectivement…). On remarquera exactement les mêmes obsessions creuses et la même peur du choix dans l’écriture du scénario. La règle d’or, c’est l’insignifiance. Et une insignifiance qu’on s’appliquera ensuite à remplir de sens en interview parce qu’on a lu dans le laid caillé et qu’on sait que ce qui compte ce n’est pas le produit mais la publicité qu’on en fait (« qu’importe le contenu pourvu qu’on ait l’ivrogne »). Parce que oui, madame, l’une des vertus de l’artificialité, c’est qu’elle fait la chasse à l’insignifiance. Elle coupe, elle structure, elle ment, elle tord (la réalité), pour s’attacher (là encore c’est une question de choix) à mettre en lumière, un action, en paroles, du sens, du… signifiant.
Alors, voilà, dans ces deux films de télévision, on s’emmerde. Une fois qu’on a perçu « l’authenticité » molle et trompeuse de la chose, il n’y a plus rien à regarder puisqu’on ne daigne pas nous offrir autre chose à manger. C’est comme inviter des convives à sa table et leur offrir de l’eau, de l’eau, de l’eau. Eau du robinet authentique ! Ah oui, certains se nourrissent d’illusions.







 Année : 1995
Année : 1995




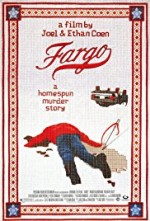


 Année : 1994
Année : 1994






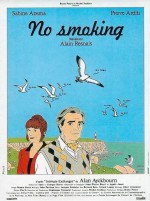
 Année : 1993
Année : 1993