Mads Movie

Après la noce
Titre original : Efter brylluppet
Titre international : After the Wedding
Année : 2006
Réalisation : Suzanne Bier
Avec : Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf Lassgård
Le retour du bon vieux mélodrame à l’ancienne (façon cinéma muet) :
– un milliardaire-entrepreneur sans entreprise, ni employés, ni travail (c’est beau les facilités scénaristiques).
– la révélation d’une paternité cachée depuis vingt ans.
– une maladie foudroyante diagnostiquée six mois à l’avance.
– un beau-fils intéressé que par l’argent du beau-père et qui feint d’aimer sa femme tout en la trompant (un tel machiavélisme ne se rencontre que dans les mélos, dans la réalité, les gens sont probablement cyniques, mais pas au point d’en arriver à ces extrêmes, et la naïveté de la fiancée facilite le tout).
– un bienfaiteur danois sans profession et au passé trouble exilé en Inde pour s’occuper des petits orphelins on ne sait comment (le Danemark n’est pas un ancien pays colonial, mais le film en aurait presque la couleur).
– un don bienvenu qui tombe du ciel pour régler par magie tous les conflits…
Je ne pensais pas de tels excès scénaristiques possibles au vingt et unième siècle sinon dans l’esprit d’une gamine de quinze ans qui écrit ses premières histoires.
Dans la réalisation, ce n’est pas beaucoup mieux, les inserts ou cuts de remembrances presque subliminaux sont insupportables.
Le film évite le ridicule en fait un peu grâce à son montage (à l’exclusion des cuts donc), à ses deux ou trois acteurs principaux, et à cette manière très Arte de réaliser les films pour ce qui est donc un mélodrame de bas étage (à la Lars von Trier, pourrait-on dire, lequel produit le film à travers sa boîte habituelle, et le bonhomme s’y connaît également en mélo, mais lui, il lui est arrivé à le faire avec génie, c’est-à-dire en osant toutes les audaces et n’ayant pas peur des outrances, tout le contraire ici puisque ça reste somme toute très sage et conventionnel).
À croire que Mads Mikkelsen participe à tous les films danois depuis quinze ans maintenant et que rien ne peut se faire sans sa gueule impassible et sa carrure d’athlète incongrue et faussement débraillée… J’ai dû voir trois ou quatre de ses films ces trois dernières semaines… Rarement des réussites. Druk étant sans doute le pire entre tous : moins mélo, mais à la morale franchement suspecte. (La Chasse par exemple, qui par son sujet, à la fois audacieux et resserré, unique, avait, lui, su bien plus me convaincre.)
After the Wedding, Après la noce, Suzanne Bier 2006 | Zentropa Entertainments, Sigma Films
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel










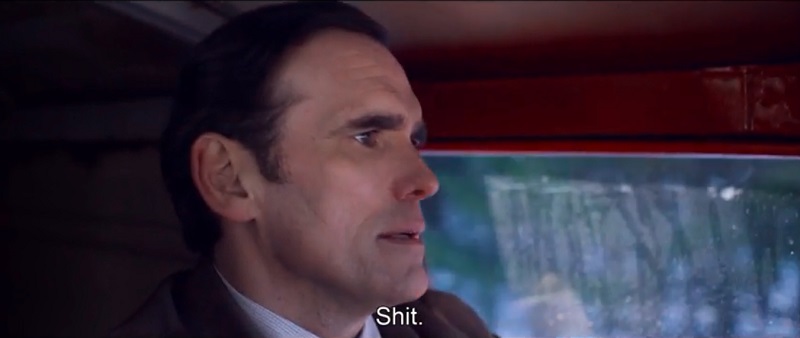









 Année : 2003
Année : 2003