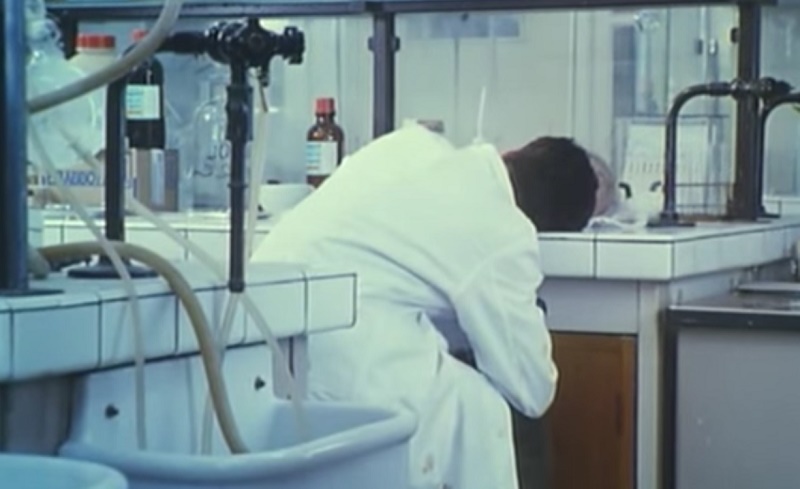Journal d’un cinéphile prépubère (amendé)
Les structures dramatiques chez Robert Bresson
Le film nous rappelle quelques principes admirablement exécutés par Bresson au niveau de la mise en place d’un drame. Les questions de la proportion et de l’harmonie à l’échelle du plan et de la séquence sont capitales.
À l’échelle de la séquence, le rythme est rapide. Grossièrement, les différentes situations qui se succèdent dans un film composent des scènes ou des séquences, le plus souvent chacune d’entre elles sont délimitées en fonction d’unité de lieu et/ou de temps et fractionnent le temps diégétique (la réalité propre de la fable) un peu comme du morse en une suite ou un collage de séquences omises, suggérées, parallèles qu’on imagine, ignore ou découvre par la suite, évoquées à travers une ligne de dialogue ou non et des séquences incluses dans le récit et offertes au spectateur. Ici donc, on passe rapidement d’une situation à une autre, car ce qui compte dans le récit, ses enjeux, ses objectifs se situe dans un temps plus vaste que celui apparaissant dans une scène : il y a des objectifs qui sont faits pour être atteints dans une période courte (chercher ses clés de voiture) et d’autres (ceux d’un drame classique) dans une période plus longue.
Quand on dispose d’une suite de séquences dont chacune fait avancer l’action vers cet objectif final, on a ce qu’on pourrait appeler le cœur de l’histoire, de la trame, et un film pourrait être ainsi résumé entre une trentaine et peut-être cent ou deux cents phrases.
Dans un film comme celui-ci, thématique (la vengeance), avec un objectif clairement défini, l’échelle dominante se situe donc plutôt au niveau de la séquence. Le souci, c’est qu’on ne peut faire un film pendant deux heures sur des scènes centrées uniquement sur une information en appelant une autre, puis une autre, et cela, jusqu’au dénouement. Il faut y ajouter de la chair pour y voir autre chose que le rapport clinique, le compte rendu froid et chronologique d’une fable. Il faut pouvoir s’attarder sur les personnages, se questionner sur eux, leurs intentions, etc.
L’art du récit est donc de parvenir à trouver la proportion idéale entre ces deux éléments. On s’attarde trop, aux mauvais moments, et on s’ennuie, on perd de vue l’objectif, le récit semble faire du surplace ; on ne s’attarde pas assez, et alors, on perd le fil, on ne s’intéresse plus à ce qu’on voit, et le tout semble sorti d’un annuaire ou du Code civil.

À chaque cinéaste, son rythme. On sait que Bresson ira par la suite vers toujours plus de lenteur en asséchant considérablement sa trame en évitant toute digression.
Le rythme ici est déjà assez lent. Et il n’est plus question du rythme des séquences, qui s’enchaînent rapidement, mais du rythme des plans et de ce qui s’y trouve (on peut coller une suite de plans rapidement avec des actions lentes, voire immobiles, ou le contraire, une suite de plans lents avec beaucoup de mouvements). C’est cette lenteur qui permet au spectateur de « faire connaissance » avec les personnages, et apprendre, ou comprendre, peu à peu leurs intentions.
À l’échelle du plan, le cinéaste met au point une véritable mise en scène, c’est-à-dire un récit des corps en mouvement. Les informations distribuées au spectateur s’adressent plus à son imagination, lui suggèrent fausses pistes, malentendus, espoirs, bref tout ce qui fait finalement le plaisir du spectateur et qui permet de rentrer complètement dans une histoire en découvrant des personnages, et en s’identifiant à eux. C’est de ce point de vue qu’une esthétique personnelle peut se mettre en place pour toucher le spectateur d’une manière plutôt qu’une autre. La lenteur par exemple, présente ici, permet de s’attarder sur les intentions des personnages, d’ouvrir les portes des possibles, et parfois elle permet aussi d’offrir poésie, harmonie, détente…
Une fois que le cinéaste, le raconteur maîtrise le rythme qu’il veut adopter (séquences rapides, plans lents, ici par exemple), il ne faut pas tomber dans un systématisme et rester dans un jeu de proportion (et de choix) : ralentir, accélérer, ici ou là, va permettre de mettre du relief au récit et de porter l’attention du spectateur sur des séquences, des informations, plus importantes que d’autres (ou qu’on juge plus importantes, c’est-à-dire signifiantes, symboliques, peu importe).
Bresson semble le faire ici deux fois. Entre l’acte II (le développement) et l’acte III (le dénouement), une scène prépare ainsi l’arrivée du dénouement en exposant les origines ou les raisons de la vengeance, et donc l’aveu du « tour joué » dans le dénouement. Et comme tout est question de mesure, le cinéaste doit s’appliquer à faire preuve d’habileté dans ses choix de mise en relief, en gardant à l’esprit, par exemple, que le début et la fin d’une histoire disposent naturellement d’une puissance intrinsèque dans l’esprit du spectateur et qu’il est donc inutile de trop en faire au risque de rendre superflu le développement.

Déjà, l’habileté de Bresson à maîtriser son récit, à trouver le bon rythme et faire les bons choix, est criante dans ce film.
On peut par exemple s’attarder sur l’efficacité des plans de coupe, « d’attitude », que Bresson préfère à une ligne de dialogue. L’information passée à travers une réplique peut parfois se révéler trop claire, trop évidente, déflorer un peu trop et au mauvais moment les enjeux du récit et les attentes d’un personnage. Un regard, un geste peuvent en dire beaucoup, et on laisse le spectateur interpréter ce qu’il en est avant de lui montrer les conséquences actées de ce qu’il a pu s’imaginer dans une scène future.
La difficulté pour le cinéaste est de mettre en scène des attitudes significatives, autrement dit des attitudes qui rentrent dans le cadre de la trame, du sujet. On peut se permettre les digressions d’attitude, pour donner de la consistance à un personnage, mais Bresson semble vouloir rester dans une ligne directrice claire, unique, avec une préférence déjà pour ces plans d’attitudes ouvrant en grand les portes de l’imagination du spectateur.
La musique relie les plans entre eux et donne une impression de continuité, de logique, tout en augmentant un peu plus l’univers subjectif qui s’empare du spectateur à son insu. Et les mouvements de caméra permettent également à Bresson de faire entrer le spectateur à une place de voyeur qui est naturellement la sienne : pendant combien de temps un spectateur normalement constitué peut-il prendre plaisir à regarder un personnage qui n’existe qu’à travers la présence d’un acteur (et qui n’est elle-même qu’une illusion) et s’appliquer à se mouvoir dans des postures et des actions qui n’ont aucun autre intérêt que de le montrer dans son intimité représentée ? On regarde. On voit. Mais il ne faudrait pas s’endormir à ne regarder un personnage que dans ses errances « naturelles ».
Si « ces actions » qui sont offertes à nos yeux voyeurs ne peuvent pas suggérer quelques vices, quelques troubles ou secrets, ça ne vaudra sans doute pas le tour de reins qu’on risque d’y gagner.

Il y a donc ainsi ce qu’on peut grossièrement identifier comme des « actions dramatiques » (liées directement à la trame, aux objectifs, etc.) et des « actions d’ambiance » (qui entretiennent une relation plus ambiguë avec la trame, voire qui se révèlent n’en avoir aucune).
Il est important de noter par exemple qu’on peut offrir au regard du spectateur un peu de « chair », de vie, en prolongeant une scène dans laquelle apparaissent des informations importantes, des révélations (l’information peut aussi prendre sens dans la longueur d’une scène, quand la même action se poursuit tout en proposant un point de départ et un autre d’arrivée). Cette « action d’ambiance » se fait donc à travers les attitudes, les regards, les silences, et puisqu’elle ponctue ou assiste « l’action dramatique », on peut dire qu’elle lui donne son rythme, sa couleur, son ambiance, son style.
Le risque alors, n’est pas forcément d’en abuser, mais de s’écarter trop de la trame : c’est moins une question de nombre que de nature. Attention au hors-sujet : un spectateur jeté par-dessus bord par le roulis du cargo dramatique, alors que la mer est calme, est un spectateur de moins…
Les actions d’ambiance permettent de donner du souffle aux actions dramatiques parce qu’un récit ne peut se construire que sur des temps forts, que sur des informations essentielles, et qu’il faut pouvoir laisser l’attention du spectateur se relâcher pour lui permettre de rebondir lors des révélations et du dénouement, là où les intensités doivent être les plus fortes.
Les séquences précises, courtes, mettant en scène une seule idée donnent immédiatement penser à une intention, un objectif. Le collage des scènes, même s’il n’est pas apparent, doit exister, et on est attentif parce qu’on sait qu’il prendra sens rapidement.
Et même principe : si la révélation, ou l’explication de ce collage n’arrive pas, ou trop tard, le spectateur s’asphyxie et cherche déjà une bouée (ou un parachute, certaines histoires ayant des prétentions plus hautes que d’autres).


Les Dames du bois de Boulogne, Robert Bresson (1945) | Les Films Raoul Ploquin






 Année : 1994
Année : 1994


 Année : 1959
Année : 1959







 Année : 1953
Année : 1953