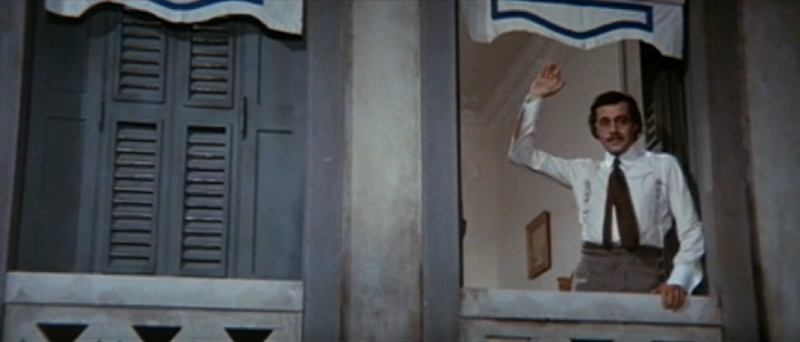(Après La Nuit du chasseur, je ne peux m’empêcher de penser que le chemin le plus sûr pour parvenir à cette maudite impression d’universalisme est celui de l’unité. La quête d’un universalisme de foisonnement et de complexité ne serait-elle pas seulement un leurre, l’image trompeuse et chaotique du spectateur ému par cette plénitude qu’est l’universalisme ?)

Le génie de mise en scène de Visconti produit sur le spectateur une sorte de choc émerveillé. Le film une fois lancé ne tient plus que par ces images en mouvement, fascinantes comme une fumée qui se dissipe sans fin, comme une boîte à musique en images — les preuves d’une vie recomposée, perpétuelle. Il faut une scène à Luchino Visconti pour donner le ton, celle de l’arrivée à Venise. Le rythme n’est pas lent, il est obstinément lent. La lenteur comme credo et comme cadre. Un choix radical qui veut tout dire. Cette lenteur qui nous berce mollement, négligemment, comme une oraison funèbre ondulant sur les eaux du Styx, c’est la tendresse de la mort. Elle est déjà là. Le port de Venise en marque l’entrée. Le temps (et donc sa cousine, le mouvement) n’existe plus. Il agonise dans un dernier souffle. Tout est épilogue, passé, achevé, momifié — mort. Le moindre élément apparaissant à l’écran se trouble et se pare d’une signification mystérieuse : la caméra cherche un peu de vie à quoi s’accrocher, et quand tout à coup des personnages s’animent, ils paraissent trop vulgaires pour être vivants. Des pantins difformes et effrayants qui s’affolent au premier virage du train fantôme. Plus de doute, ce silence, cette pesanteur moite prête à nous happer, c’est elle. La mort, la plus terrifiante entre toutes : pas celle qui vient à nous avec l’idée de nous faucher bonbon, mais celle dans laquelle on vient se jeter pour de bon. Résolument. Avec l’espoir d’y trouver une dernière lueur de vie, parce que la vie elle-même, celle d’où on vient, n’est plus rien. Sinon la certitude d’une fuite, d’une chute, d’un abîme…
La musique et l’apparition du personnage principal suggèrent un malaise qui annonce déjà le siège morbigène de la ville. Comme dans une tragédie, tout s’est déjà joué en partie hors scène et hors temps. Toutes les tentatives du héros pour rétablir les conditions de la normalité seront des échecs. Plus il se débattra, plus il s’enfoncera dans la mort. Ce dénouement lui est connu, et nous est connu, parce que les dieux lui ont déjà révélé les conditions de sa mort ; malgré tout, parce qu’il est un homme, il se débattra, sans savoir ici que c’est précisément en cherchant à rétablir la normalité qu’il précipitera sa chute. C’est un système comparable au suspense : on sait où on va (c’est ce qu’on craint), on ne sait comment on y arrive, et c’est un peu en cherchant qu’on se fait piéger… Le mythe du fruit défendu, et de son pendant dramaturgique, l’hamartia. Quand Barbe-Bleue interdit l’accès d’une salle à sa dernière femme, on comprend déjà ce qui va suivre. Les meilleures histoires sont celles dont la fin est contenue en son début. Ce qui compose ainsi la matière même du récit, entre l’erreur originelle et son dénouement connu et tragique, n’est qu’une errance, un road movie dont on connaît déjà l’issue fatale…

Mort à Venise, Luchino Visconti (1971) | Alfa Cinematografica, Warner Bros., PECF
On sera donc plus tard informés à travers divers flashbacks de certains de ces épisodes constitutifs d’une vie passée, innocente et glorieuse… Le présent, quant à lui, est déjà un dénouement tragique. Une enquête, l’introspection, est avant tout l’affirmation d’un échec. La question est alors à la fois simple et complexe (une de ces questions assez vagues pour concerner tout le monde) : en quoi ai-je péché ? Le présent interroge le passé, l’invoque, et sacrifie sa régularité à travers cette seule obsession de la quête du sens. Le voilà l’universalisme. En ne cherchant à résoudre qu’une seule question (toujours la même, la seule essentielle, sans doute), on répond à toutes les autres.
La mise en scène de Visconti est par ailleurs composée comme une chorégraphie de l’incantation du vivant, comme une tentative de ramener à la vie ce qui se meurt : mouvement de caméra, zooms, et décomposition structurante d’une « action » à travers la respiration du montage (l’arrivée « à quai »). Peu importe alors le rythme, il parvient à tendre « l’action » vers une seule direction qui devient évidente, essentielle, unique, parce qu’elle est intérieure et passée. La fin est un point, un mur qui nous ramène d’où l’on vient à travers un jeu de questions et de réflexions. Ce n’est plus le train fantôme, mais le palais des glaces… From the road to the roam movie… Quand on est à quai, on n’avance plus qu’en soi-même. Le héros ne suit plus la logique des événements qui lui sont soumis et qu’il contribue à faire évoluer ; il suit la logique intérieure de ses erreurs passées. Le drame cesse d’être « dramatique », il n’est plus que « psycho-logique » (avec doigté « analytique »).

En allant à l’essentiel, Luchino Visconti réduit la forme temporelle et dramatique à un diptyque intemporel et inactif. Dans un récit classique, les séquences avancent en se répondant les unes aux autres : un personnage arrive dans un lieu pour trouver les réponses aux enjeux présentés dans les séquences qui précèdent, il avance, trouve un élément capable de le faire avancer, cut, et on recommence ainsi d’une séquence à l’autre… De la structure « passé/présent/futur » ne reste que les deux premiers éléments puisque le troisième est connu : le présent interroge le passé, le passé réduit le présent à néant. Et de la logique dramatique classique « introduction/développement/conclusion », Visconti ne garde que les introductions qui ne seront ponctuées que par de brefs points de conclusion : une introduction qui ne cesse de poser les bases du problème, interdisant tout développement à travers l’ellipse (toutes les tentatives d’échanges avec d’autres personnages seront vite interrompues), et la conclusion n’étant alors qu’un retour à la ligne, une ellipse signifiant l’annonce d’un nouveau départ, d’une nouvelle situation sans but, sans action et sans vie. Rien n’a plus d’importance que la quête intérieure qui agite Gustav. Une quête d’autant plus troublante et universelle qu’on n’y a pas accès, sinon à travers les seules évocations du passé. Son personnage peut regarder autour de lui, il ne voit rien. Le monde, encore, de cette âme grise qui se débat à peine, c’est bien celui de la mort : figé, « décomposé », blême et sourd. « Monsieur, la Mort va bientôt arriver. Elle sera là dimanche, ou lundi. » « Très bien. Donnez-moi mon journal, je vous prie. »
L’art de Luchino Visconti est donc de réduire ses séquences à des introductions d’actions avortées qui transpirent la vie recomposée. Quand le phare de la vie s’éteint, dis bonjour aux fards et recompte les fardeaux de ta vie, dit le poète… (hum, non OK). Gustav déambule, arrive, se pose, croise des ombres qui se débattent avec leurs propres souvenirs, mais il ne se passe « dramatiquement » rien. Un fantôme parmi les fantômes. Tout est mise en scène, rien n’est purement « dramatique », c’est-à-dire constitutif d’un dispositif actif à la résolution d’un problème. Ces ombres, avec leur vie factice, pourraient être représentées de mille manières différentes, peu importe, parce qu’elles ne traduisent que leur incapacité à faire avancer « l’action ». Comme le vent qui souffle sur le pont d’un bateau sans voiles. On regarde, mais on ne voit rien. Au lieu de s’attarder, au lieu de tourner sa caméra vers ces ombres, Visconti ne les montre que comme des éléments de décor. Là où un metteur en scène peu sûr de ses objectifs prendrait peur de tout ce vide et s’appuierait sur le moindre élément pouvant apparaître comme signifiant, Visconti ne bronche pas et garde la rigueur de son indifférence au monde : les points de détail ne supportent pas l’action, l’action est en dehors du champ, et tous ces points, comme des taches, ne s’accordent que pour constituer un tableau général, une atmosphère.

Renoncer à montrer, prendre ses distances, c’est pousser le spectateur à regarder au-delà des images. La distance pose, n’impose pas. La quête intérieure de Gustav devient ainsi la nôtre. C’est notre imagination qui donne corps à son monde intérieur. Comme cela se fait dans toutes les histoires, car les personnages n’existent qu’à travers la cohérence propre que leur conférera le spectateur ; mais Luchino Visconti pousse le principe à son maximum en réduisant l’épaisseur du fil dramatique et en ne laissant qu’une peinture en mouvement éveiller l’imagination.
Paradoxalement, de cet univers morbide et statique naît une puissante impression de réalisme. Un peu comme le principe de la persistance rétinienne sur laquelle viendrait se calquer une cohérence narrative. On ne sait où on va, on ne sait pourquoi, mais l’ensemble se révèle être d’une logique implacable. La mort à Venise… Qu’a-t-on à savoir de plus ? Tout est là. Les fantaisies et les appréhensions de chacun font le reste. Le temps aussi, qui se dilate dans l’insignifiance des choses, concourt à produire l’illusion d’une réalité. On se perd dans un présent sans but, on sait qu’il cache des réminiscences du passé susceptibles d’éclairer le sens de cette fin ; alors on scrute, voyeurs, enquêteurs, à l’affût d’indices ou de prémices qui éveilleront les notes de la vie passée ; comme le regard capable d’interroger une matière en décomposition, de mettre en suspens ce temps qui fuit, comme je l’avais noté déjà pour La Belle et la Bête. Et Visconti va encore plus loin sur le regard en dévoilant ostensiblement des effets de caméra propres à accentuer le caractère subjectif des images : panoramiques et zooms. Dans cette scène notamment, au restaurant, où le personnage de Bogarde se trouble une première fois en croisant Tadzio.

Il ne se passe rien en dehors de cette seule rencontre. Un regard, une interrogation, un déni peut-être, et la conclusion de la séquence bascule le récit au passé. La transition sonore fait le lien entre les deux scènes. Non pas une transition marquant bêtement le passage d’une scène à une autre, mais donnant du sens à ce basculement en forçant le rapport de cause à effet. La scène alors entre Gustav et son ami devient là irréelle, prenant le contre-pied des séquences au présent. L’image et le son ont leur vie propre. L’argument de l’évocation, de la scène du passé, permet une mise à distance et donc un traitement séparé du son et de l’image — chacun apportera alors des informations différentes et complémentaires. Si la cohérence des deux est généralement nécessaire pour reproduire l’illusion du réel, reproduire la continuité d’une persistance temporelle, l’espace reproduit ici n’a plus cette vocation, au contraire. La présence de ce nouveau personnage, le premier avec qui Gustav échange des idées, reste fantomatique, comme un double. Ce qu’on imaginait alors en scrutant l’œil et l’allure de Gustav, se révèle un peu plus en se verbalisant. Jusque-là, le film était comme prisonnier d’une forme de mutisme, et voilà qu’il ouvre une porte sur cette dimension attendue. Le passé est parfois signalé à travers un traitement différent des couleurs, ici, c’est le son qui imperceptiblement grâce à sa nature marque le flashback. D’habitude, le son illustre l’image, la supporte ; ici c’est le contraire. Luchino Visconti aurait pu proposer d’autres solutions de montage, poser sa caméra ici plutôt que là, produire tel effet (ou mouvement) plutôt qu’un autre, la piste sonore, elle, reste identique. Ce qu’on entend, ces dialogues, c’est précisément ce qu’on cherche dans ce passé. Des réponses. Et bien sûr, c’est un abîme, un écho : Gustav ne se parle qu’à lui-même et les réponses ne viennent pas sinon sous la forme d’interrogations qui ne s’ajoutent qu’aux précédentes… Quand la séquence s’achève, on sait qu’on va devoir y revenir. À tâtons — en talonnant les tatillons, en tatillonnant — comme un joueur qui perd et qui veut retenter sa chance, comme Proust renonçant à percer le mystère de sa première gorgée de thé pour se concentrer sur la seconde, comme la chauve-souris ouvrant la voie devant elle en criblant les parois de ses cris stridents et sourds…
Tic-tic-tic-tic-tic-tic…
Revenu au présent, on se demande qui pouvait bien être cet inconnu, ce double traité avec une telle désinvolture. Est-on censés comprendre qui il est ? Le retrouver plus tard comme un personnage récurrent ? Un prétexte, sans doute seulement, à cette sonorisation soudaine des interrogations de Gustav.
Tic-tic-tic-tic-tic-tic…
Comme dans La Belle et la Bête, toujours, on baigne dans un léger surréalisme. Celui qui titille la folie, interroge la normalité et cisèle la temporalité pour ne faire de ses figures que des cartes à jouer. Celui qui plane et qui lévite, celui qui titube et qui virevolte, tel l’ambigu. Celui qui éveille l’imagination de celui qui se laisse hanter par les incertitudes et les démons d’un autre. Le réel assis sur une branche et qui rêve de se voir tomber… Tic-tac.

Les flashbacks suivants auront la même saveur de l’onirisme (Donald Trumbo utilise la même année ce procédé dans Johnny s’en va-t-en guerre, mais lui y ajoute la couleur). Ce qui fascine dans les deux films, c’est précisément cette impression d’universalisme, d’accomplissement, rendu possible à travers un procédé ouvrant à toutes les interprétations. L’universalisme n’est pas dans l’image ou dans la dramaturgie, il est dans la perception du spectateur.
Il faut une certaine humilité à l’artiste pour être ainsi capable de mettre son sujet en avant, ne pas forcer à l’interprétation, la sienne, et une rigueur bien sûr pour arriver à s’y tenir jusqu’au bout. Car il est tentant de s’emparer d’un sujet et d’y apposer sa marque. « Voilà ce que j’ai à dire. » Et on attend les approbations… Non, l’artiste, le cinéaste, le raconteur d’histoires ne dit rien. Il le fait dire aux autres. Le tour de force alors est de provoquer chez chaque spectateur l’illusion de ses convictions. Certes souvent, on cherche les évidences et on s’émeut de la diversité des interprétations possibles, mais même là, rien ne dit que les spectateurs s’accorderont sur la nature même de cette diversité… Ce n’est pas parce qu’on se sait assister à un tour de magie qu’on est capables d’en décrypter les rouages. Pour l’artiste, en tout cas, il se doit d’accepter que ses ambitions se fondent dans une soupe narrative mettant en lumière les interrogations de ses personnages et d’éveiller celles des spectateurs. Dans ce cinéma dit « d’auteur », il est paradoxalement le seul qui doit s’interdire cette récupération, cette volonté de dire ou d’interpréter. L’auteur dit moins qu’il dirige. Et montrer la voie, ce n’est pas forcer. L’auteur, pas plus qu’un spectateur par rapport à un autre, ne saurait imposer sa vision : aussitôt qu’il nous couperait de toute alternative, il perdrait toute crédibilité ou tout crédit. C’est l’écueil auquel se heurtent nombre de raconteurs d’histoires quand vient le dénouement. Les meilleures histoires, celles qui ouvrent droit à une multitude d’interprétations, sont celles qui se refusent à des résolutions fermes et arrêtées, ou qui font semblant d’en offrir.

Gare toutefois aux faux prophètes de l’universalisme. Car il peut être tentant de singer des modèles en refusant systématiquement le recours aux franches affirmations et aux vérités. Tout est sans doute affaire, là encore, de perception, mais il est probable qu’un raconteur d’histoires honnête se tienne à un sujet et parvienne à offrir une apparente simplicité à son récit, quand celui qui n’est que tenté par les formes ouvertes, par l’indécision et par les tournicotages de l’esprit, proposera, lui, un récit faussement sophistiqué en forçant toujours plus ses propres indécisions auxquelles le spectateur finira par ne plus prêter attention. Le grand huit n’est pas plus efficace à neuf, à dix ou à mille… (Ah, tout le monde se gondole, mais c’est une « ineption », une nolanerie !).
L’unité est un savant compromis entre le sujet et sa mise en scène. La seconde ne saurait trop appuyer le premier ; là encore, pour atténuer certaines évidences, éviter le ton sur ton, les présomptions, et l’enfonçage de portes ouvertes. Le talent, souvent le génie, le savoir-faire, c’est donc de parvenir à ce compromis des extrêmes. Comment dire (ou faire dire, plus précisément) un maximum avec un minimum ? Comment suggérer la grandeur et la complexité à travers ce qui est simple et petit ?

Luchino Visconti en tout cas montre avec ce film le pouvoir fortement évocateur des images et du son en y délaissant presque complètement ce qui fait le cinéma depuis l’avènement du parlant : les dialogues. Que dit-on quand on est seul et qu’on regarde ? Rien… Arrête de causer et compose une histoire à travers des situations, regarde celui qui regarde, montre ce qu’il y a à voir et à écouter, mais ne dis rien. Ne force pas. Thomas Mann a beau avoir écrit l’histoire originale, Visconti en avoir repris les idées, c’est bien ce dernier qui est le seul « auteur » du film. Un auteur qui ne dit rien, mais se contente (et c’est l’essentiel) de montrer. Un cinéaste peut rarement travailler sans scénario justement parce qu’il retranscrit principalement des lignes de dialogues, censées découvrir le sujet. Mais le cinéma n’est pas le théâtre. Ou la littérature : il serait tout aussi difficile à un cinéaste n’ayant pas travaillé sur son scénario de lire des indications scéniques ; qu’elles soient visuelles n’y changera rien, c’est au cinéaste seul d’inventer, comme un peintre, la palette d’images et de sons qui lui serviront à barbouiller son histoire. Les dialogues ne sont plus qu’accessoires, bruit, fondus dans le décor. Ou alors, comme dans Un homme qui dort, on reproduit le phrasé de l’auteur, et on se tourne derrière un narrateur qui se fera coryphée ou aède pour l’occasion.
C’est là qu’on revient à l’utilité de ce « léger » surréalisme, parfaitement perceptible par exemple dans cette scène étonnante de parade amoureuse sur la plage entre Tadzio et Gustav (le premier se balançant autour des poteaux de cabines de plage et narguant le second). Toute la difficulté est de trouver la bonne distance, le ton, et l’atmosphère idéale sans quoi on tomberait facilement dans la vulgarité, voire l’obscénité. À lire dans un scénario, on imagine bien le ridicule de l’affaire : « Il faut que ce môme se tortille aux poteaux comme s’il était au Crazy Horse et que l’autre précieuse fasse semblant de ne pas l’y voir en pissant son rimmel ? » Trouver la bonne distance est indispensable, pour qu’au lieu de s’offusquer ou de rire, on s’interroge, et on reste suspendus aux branches. Bien sûr, la musique a son importance, elle joue son rôle de guide de notre attention, le montage aussi, le découpage, la vie propre, encore, de l’image et du son, mais surtout, cette disposition des corps, cette chorégraphie étrange, doit attirer notre regard et tenir notre attention en éveil. C’est une mise en danse. Le cinéaste étant homosexuel, on aurait pu craindre un traitement plus ouvertement gay friendly, et le fait qu’il s’agisse d’un adolescent joue sans doute paradoxalement sur la capacité de Visconti à retranscrire cette distance idéale. L’étrangeté d’un surréalisme tiède met ainsi les deux personnages comme en suspension pour offrir au spectateur une sorte d’arabesque qui ne vaut que pour elle-même et non pour ce qu’elle représente (qu’on fasse jouer la même scène avec un cornet de frites huileuse et une endive, et je m’émeus autant). Là encore, les diverses interprétations sont possibles et aucune n’est privilégiée par le cinéaste. Du vieux pervers en train de cramer ses derniers litres de fioul et se faisant arroser de trémolos juvéniles d’un pervers en devenir, à la simple fascination de l’esthète moisi pour une beauté ou un idéal qu’il n’espérait plus…

Stanley Kubrick quatre ans après pour son Barry Lyndon (qui emprunte un chouïa de profusions à Mort à Venise) se souviendra de la leçon de Luchino Visconti sur la parade nuptiale : tout sera affaire de distance et de mise en scène quand Barry rejoindra sa Lady Lyndon sur la terrasse. Stanley tortillant moins du cul, il préférera la méthode du mat à celle des crazy piquets : pano sur dame qui se déplace en a4 (halètements fébriles), puis sur pion en b5 (subterfuge dit de « la tour »), la dame sent le souffle du pion sur sa nuque et se tourne (elle barrit, elle consent, elle miaule), et enfin, pion b5 en a4, prise de la main, bisou…, échec à la dame.
Pour la scène finale, Luchino Visconti ne fera pas autre chose. Ce sera au tour du fou, dans une diagonale enflammée, à faire échec au roi. Zoom. Mort à Venise en coulis de framboise. Et Mahler déguste.
Journal d’un cinéphile prépubère amendé en 2017.