On est au croisement des genres : comédie, tragédie, chronique sociale, road movie, buddy movie. L’idée du film est simple : la rencontre improbable entre deux hommes que tout oppose. Le premier est expansif, sans gêne, souriant, charmeur, dragueur, mais aussi envahissant, raciste, homophobe, escroc, lourd on dirait aujourd’hui, et finalement on apprendra que derrière toutes ces futilités, ces manières outrancières, se cachent un homme seul, raté, et attendrissant. Le second est bien plus jeune (le premier le considère plus comme un frère ou un pote qu’un fils, tout comme il est incapable de jouer le rôle de père avec sa grande fille de 17 ans), il étudie le droit, timide, respectueux des autres, casanier… Les deux se retrouvent sur un point : ce sont des hommes seuls.
La première scène est saisissante. C’est le 15 août à Rome, le premier, interprété par Vittorio Gassman, déambule dans les rues désertes de la ville en quête d’un téléphone, et le seul être vivant qu’il trouve dans les parages, c’est donc l’autre, joué par Jean-Louis Trintignant. On se croirait dans le Monde, la Chair et le Diable : les deux survivants du monde qui se retrouvent. Être seuls un 15 août, ça crée des liens. Gassman s’invite chez Trintignant, qui le trouve d’abord bien envahissant, mais il reste poli (la voix off sert de contrepoint), et bientôt Gassmann embarque Trintignant dans sa décapotable pour filer à fière allure sur les routes qui mènent à la plage. La plage, la chair et le diable…
Parcours initiatique, road movie, opposition entre deux personnages complètement différents. C’est du déjà-vu, mais ça atteint ici un degré de perfection inédit. L’insolence et la désinvolture du personnage de Gassman sont vraiment propices à des situations cocasses et à des répliques d’une rare bêtise. Il est né pour se créer des emmerdes, parce que contrairement au personnage de Trintignant, il va de l’avant, il s’incruste, il ose, sans peur de déranger. C’est plus qu’un fanfaron, c’est un ouragan d’insolence et de goujaterie, et alors que Trintignant tente, au début, de l’apprivoiser, il finit par le suivre dans son élan, maladroitement, le prendre comme modèle, et la morale là-dessus est impitoyable : à trop vouloir vivre quand on n’a pas assez vécu, on finit par se tuer…, quand d’autres sont passés maîtres dans les embrouilles tout en s’évitant toujours le pire.

L’intérêt du film est bien dans l’évolution et le rapprochement des deux personnages que tout oppose, un peu comme dans Rain Man. On apprend à découvrir les faiblesses, les blessures de Gassman, et Trintignant prend goût à la vie, du moins, il se décide à la vivre plus pleinement. On est d’abord séduit par ce Gassman enfantin qui drague les mama dans les cuisines d’un restaurant où il n’était pourtant pas invité, par sa langue bien (et mal) pendue ; le personnage de Trintignant joue notre rôle, il est là pour apaiser les élans impétueux et niais de la tornade Gassman. Et puis, on découvre qu’il n’est pas si en réussite que ça, que c’est un petit escroc qui doit de l’argent à droite et à gauche, qu’il est toujours marié à l’unique femme qui peut lui faire baisser les yeux, femme auprès de laquelle il ne peut trouver les mots, et la seule qui ne rit plus de ses bêtises, comme on ne rit plus d’un gamin qui refuse chaque soir de se mettre au lit… Il tente vainement de jouer les papas, mais ce n’est pas un rôle pour lui. On est comme sa femme et sa fille, on lui laisse tout passer à l’abri derrière l’écran (ses caprices, ses mots blessants, ses embrassades un peu trop osées, sa spontanéité déroutante et souvent embarrassante), parce que c’est un ouragan qui de l’extérieur provoque le sourire, c’est un soleil qu’il fait bon voir rayonner mais qu’on ne saurait regarder en face parce que comme pour le personnage de Trintignant cela nous serait fatal. Il est inconscient, mais c’est un enfant ; il s’amuse, il amuse. Que peut-on reprocher à un enfant… tant qu’il n’est pas un homme ? Sa femme ne s’est pas remariée, elle n’a même pas insisté pour le divorce, on sent qu’elle l’aime encore, malgré ces visites en pleine nuit… tous les trois ans. Elle le dit elle-même : « Je l’aime comme un fils qui a mal tourné ». Sa fille aussi continue de l’aimer, et elle, contrairement à sa mère, l’aime tel qu’il est, joue avec lui, plaisante avec lui, s’amuse même à le séduire à son insu. Elle tient de son père : pétillante, insouciante, souriante. Mais elle tire la leçon d’un père absent et toujours sur le fil : elle veut une bonne situation, et pour cela, est prête à se marier avec un homme qu’elle n’aime pas et qui a l’âge de son père… On se prend à rêver que Trintignant et elle fassent un bout de chemin ensemble ; elle le séduit un peu, mais Trintignant n’a d’yeux que pour sa voisine, à qui il a à peine adressé la parole… Les routes servent à s’ouvrir de nouvelles portes, mais le trajet le plus dur, c’est celui qu’on s’interdit de faire d’une fenêtre à l’autre. La promiscuité des interdits. À quoi un petit tour en auto servira bien à s’en divertir… Et si ce n’est pas le mur voisin, ce sera le ravin.
À voir, une fois n’est pas coutume, en VF, Trintignant oblige, la version originale n’existant pas, comme une bonne partie des coproductions franco-italiennes de l’époque. Et comme le doublage sur Gassman est excellent pourquoi se priver de ça et s’envoyer de la mozzarella incompréhensible.
La relation de Gassman avec sa femme et sa fille n’est pas sans rappeler le personnage de Duchovny dans Californication. Tous les deux sont de grands enfants, ingérables ; ils parlent bien et vite (même si l’un rajoute une pincée de culture et d’intelligence que l’autre n’a pas) ; ils ne pensent qu’à la chose (Duchovny est irrésistible, il se fait draguer sans doute plus qu’il ne drague alors que Gassman en devient comique à force d’insister) ; et tous les deux sont des ratés, rejetés par la société, et par leur famille qui pourtant les aime de la même façon. Même désinvolture (cool pour l’un, tonitruante et colorée pour l’autre), même décapotable pourrie…

Le Fanfaron, Dino Risi (1962) | Incei Film, Sancro Film, Fair Film





 Année : 1962
Année : 1962





























 Année :
Année : 



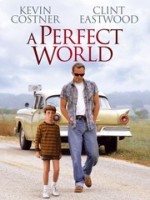



 Année : 1953
Année : 1953
