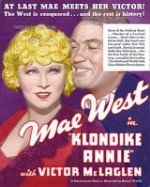La logique de la politique des auteurs jusqu’à l’absurde. Rétrospective Douglas Sirk à la Cinémathèque : film allemand de 1936, mélo qui sent bon la propagande, tendance soft power, mais propagande quand même, avec la mise en avant des valeurs nazies. Fin de projection : des spectateurs applaudissent. J’entends même à la sortie quelqu’un dire que c’est rafraîchissant de voir un film en allemand (j’espère que quelqu’un lui a soufflé que Sirk était Allemand…).
Les gens comprennent ce qu’ils regardent, sérieux ? On peut louer les qualités intrinsèques d’un film tourné sous la censure nazie, imaginer (pourquoi pas) que des artistes sont parvenus à la déjouer (tout est lisse dans le film, il n’y a donc rien à déjouer), mais d’une part, quand ça fait la promotion justement de ces valeurs, et même si l’on y trouve ces audaces qu’on supposera toujours à des « auteurs », de la décence, merde.
Ça reste un film de propagande répondant à tous les principes que le pouvoir voulait voir développé dans la production domestique. En 1936, les juifs sont déjà interdits dans l’industrie du cinéma. Et les distributeurs sont priés de proposer (comme plus tard les films de la Continental en France occupée) des films intemporels et divertissants. Ce n’est peut-être pas Le Juif Süss, mais ce n’est pas non plus M le maudit. Pas besoin qu’un film soit antisémite pour servir de propagande nazie, et le film de Lang peut difficilement être fait contre les nazis à l’époque où il a été réalisé…
Oui, mais La Neuvième Symphonie est un chef-d’œuvre « intemporel et divertissant » comme peut l’être par exemple Sous les ponts de Helmut Käutner, tourné en toute fin du régime. Admettons… Mais qui irait prétendre que ce film de Sirk en soit un ?… Vous aviez des fourmis dans les mains ?
Parce qu’au-delà de la propagande d’apparat, le scénario n’a aucun intérêt. Avant d’avoir fait la promotion de la société américaine et de sa (haute) société de privilégiées ou de la consommation, Sirk a fait celle de la société aryenne allemande. J’attends que l’on m’explique la logique auteuriste là-dedans.
En détail, on remarquera les ficelles grossières d’un mélo comme on n’en osait plus depuis le muet. Une mère indigne abandonne son gosse en Allemagne pour se tirer en Amérique. De retour dans la mère patrie, elle débarque chez le gentil Allemand de l’orphelinat où elle avait laissé son fils. Celui-ci se trouve être le meilleur ami d’un chef d’orchestre fameux qui, précisément, a adopté son gamin. Le même homme, par ailleurs responsable de la captation de la symphonie du titre, aurait sauvé la vie de la mère en entendant sa musique en Amérique… Le gentil Allemand propose à cette mère qui veut se racheter une conscience (trompée sans doute par les vaines promesses de l’Amérique) de rentrer au service du chef d’orchestre pour s’occuper de son propre film. Et cela, sans révéler bien sûr à son ami que la nounou qu’il lui conseille est la mère de l’enfant (tu parles d’un ami). Parce que, « tiens, justement, ça tombe bien, je reçois un appel de lui qui cherche une nounou pour le petit ».
Bref, concours de coïncidences malheureuses et heureuses, on force sur les extrêmes (les très riches sont des génies ou des escrocs, les très pauvres, des mères indignes en quête de rédemption poussée par l’instinct maternel allemand sans doute) : un vrai mélo du muet. Comment dit-on « abracadabrantesque » en allemand ?


Non, l’intérêt (si l’on tient à analyser ce machin) est ailleurs. Sirk se débrouille pas mal du tout pour mettre tout ça en place : ce n’est jamais statique, il y a du rythme, c’est élégant, bien dirigé. Mais le gros plus, conséquence évidente d’une production confortable, c’est les moyens et la qualité du design (décors et costumes). Ce n’est pas qu’une question d’opulence et de volonté de divertir avec du beau. Vouloir, c’est une chose, mais on est en train d’assister à la mort de tout un savoir-faire allemand qui finira par disparaître durant les années du pouvoir nazi. Jamais plus le cinéma allemand ne connaîtra ce génie esthétique, cette élégance (ce qui est allemand, sera bientôt froid, rigoureux et efficace). Les tyrannies ont décidément un art certain pour saper des décennies de génie et de bon goût.
Certains « art directors » sont passés en Amérique (je dois avoir des entrées dans mon Hollywood Rush), ce n’est pas le cas ici : mais le travail de Erich Kettelhut est assez exceptionnel. Erich Kettelhut a travaillé sur les films muets de Fritz Lang que le régime appréciait beaucoup, et en 1944, il fera les décors d’un des derniers films nazis qu’on voit subrepticement dans Dix-Sept Moments du Printemps quand l’espion soviétique passe son temps libre à voir le même film nazi qu’il déteste : La Femme de mes rêves (je l’avais ajouté dans ma liste à voir parce qu’on semble bien y danser et le tacle d’une dictature à une autre était suffisamment savoureux pour que le film mérite un peu d’attention). Il n’y a guère que la MGM à l’époque sans doute pour afficher un tel luxe sans frôler le mauvais goût.
Les risques, quand on a les moyens (d’un film de dictature), c’est de faire nouveau riche, d’en mettre partout, de voir plus grand que nécessaire. Ici, c’est dans tous les détails que le design impressionne. Chaque élément de décor semble être minutieusement pensé, et si l’on omet peut-être les reconstitutions de New York au début du film, tout est parfait. Les robes de la nounou sont peut-être un peu trop travaillées pour ses moyens, mais il faut voir la qualité des tailles et des matériaux, l’inventivité des coupes (l’art des robes, un peu comme celui des chapeaux, ce n’est pas dans l’audace ou l’originalité qu’il s’exprime le mieux, mais plutôt dans cette manière d’arriver à proposer toujours quelque chose de légèrement différent, voire d’évident, pour finalement la même chose : elle a une robe noire avec un assortiment de fleurs factices blanches quand elle va à l’opéra par exemple, je serais une dame, je voudrais la même…).
Encore heureux que l’on n’évalue pas un film en fonction de son design… Et puis, je ne serai pas aussi élogieux avec le directeur de la photo, Robert Baberske, qui laisse apercevoir trois ou quatre fois les ombres des micros ou de je ne sais quel élément électrique censé rester hors champ.
Au rayon des acteurs, on peut remarquer la partition relevée, digne d’une marche funèbre, de Maria Koppenhöfer en gouvernante qu’on aime détester.




















 Année : 1936
Année : 1936

 Année : 1936
Année : 1936





 Année : 1936
Année : 1936