
Aerograd
Titre original : Аероград
Année : 1935
Réalisation : Alexandre Dovjenko
Avec : Stepan Shagaida, Sergey Stolyarov, Stepan Shkurat
Aucun intérêt narratif ou esthétique. Le film propose une suite de tableaux taïgano-picaresques (sortes d’images d’Épinal des grandes plaines d’Asie à conquérir) à la gloire de la construction annoncée d’une ville au bout du chemin. Le mythe du « Far East » mis au service d’une propagande impérialiste, de l’expansion territoriale et de l’idéal soviétique. Quelques relents forcément racistes aussi : le Blanc européen apporte la bonne parole et la civilisation rouge dans ces contrées « arriérées » (et ce conquérant aux accents slaves se heurte à un autre impérialisme : l’impérialisme japonais).
La propagande russe actuelle peut bien rappeler que la France dispose toujours de territoires en dehors de l’hexagone, ce goût pour l’appropriation des terres du voisin est l’apanage depuis quelques siècles du petit Blanc européen, Russe compris, tout heureux de bénéficier d’une technologie ignorée des barbares.
Dans les mythes historiques des persécutions barbares en Europe, se sont succédés les Huns, les Mongols, les Perses ou les Arabes. Puis, le tour des Européens est venu. Les hordes de sauvages, c’était eux.
Mais tout est question de perception : le vainqueur conquiert un territoire, apporte ses « lumières » ; le vaincu voit déferler chez lui des barbares.
Et alors, chacun son territoire. Après les hordes de Germains qui faisaient trembler les Romains, les Vikings, les Normands, les conquistadors, les Hollandais, les Français (partout autour du globe ou même en Europe), les Britanniques…, les Russes (bientôt supplantés par les Soviétiques) ont donc eu droit à leurs conquêtes (leurs moments de « gloire ») et à leur pré carré (un gros gâteau steppique). (C’était avant qu’ils soient trois ou quatre à revendiquer leur propre hémisphère. Les calculs sont pas bons.)

Le film témoigne de cet impérialisme. C’est déjà ça. Sa valeur historique prend un tournant même ironique et tragique aujourd’hui. Cet impérialisme glorifié à coup de grosses voix viriles, de poings tendus et de regards exaltés, ce n’est ni plus ni moins que celui, sous une forme nouvelle, qui pousse les Russes à relancer les conquêtes d’expansion dans une zone qui leur serait dévolue.
Il fallait que Dovjenko soit aveugle (ou complice) : Ukrainien né dans un territoire de l’Empire russe dans l’actuelle Ukraine régulièrement bombardée par l’aviation de la Russie de Poutine, il se met au service de cet impérialisme dans ce film. Pas besoin d’aller si loin vers l’est pour voir exprimée toute la démesure absurde et toute la folie destructrice de l’impérialisme. Honte à lui d’avoir participé à une telle opération d’assujettissement et de spoliation des peuples de la taïga.
Notons qu’après l’éclatement de l’Union soviétique, la Russie a gardé, elle, une partie des territoires d’Asie occupée par la force et dont les populations servent actuellement de chair à canon dans une guerre en Europe parfois à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. L’axe de la violence impérialiste se renverse, les dominations changent, mais l’objectif, que l’on soit l’agresseur ou l’agressé, demeure identique. Les terres glorieusement conquises montrées par Dovjenko (sans opposition ou presque, sans brutalité et sans peuples), aujourd’hui, ce sont les propres terres du cinéaste. L’histoire peut obéir à des logiques de cycle, elle peut aussi s’inverser, selon le point de vue où l’on se place. Le génie humain, c’est celui de se mettre à la place de l’autre. Il serait temps que ce que l’on fait individuellement, on arrive enfin à le faire collectivement et que derrière toute conquête, on ne voie plus un acte glorieux, mais une entreprise d’annihilation de l’autre qui finira toujours par se retourner contre soi.
(L’imagerie finale qui rappelle d’une certaine manière la propagande nazie tout à fait contemporaine sera, ironiquement, là encore, réemployée pour évoquer l’invasion allemande dans le génial Jardin des désirs. Les mêmes images peuvent strictement raconter deux choses différentes selon le point de vue où l’on se place : l’invasion ou l’expansion glorieuse.)
Direction d’acteurs pitoyable : des pitres qui s’agitent comme aux pires moments du muet. Les exhalations à la Antonin Artaud, très peu pour moi. Et je l’ai déjà dit : un récit atrocement pauvre (aucune relation véritable entre ces protagonistes figés dans leur fonction, caricatures, évolutions sommaires, hachage presque brechtien des séquences). L’intérêt est ailleurs.
Aerograd, Alexandre Dovjenko (1935) Аероград | Mosfilm, Ukrainfilm
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci. (Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel





























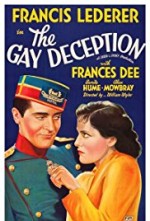 Année : 1935
Année : 1935

 Année : 1935
Année : 1935




