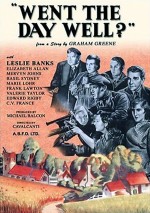Grimace de l’assassin


P’tit Quinquin
Année : 2014
Réalisation : Bruno Dumont
Avec : Alane Delhaye, Lucy Caron, Bernard Pruvost
Absurde et grotesque. Derrière le rire, la nature de l’humanité dévoilée…
L’humour, c’est parfois aussi le grain de sable qui nous ramène à la réalité du postérieur. Celui qui fait tomber les masques, avec la bienveillance ou l’immunité du fou. La caricature dévoile le réel, inverse les rôles, se moque des usages et des positions pour pointer du doigt, avec douceur et subtilité, les petits maux qui nous accablent, nous agacent, nous chagrinent ou nous révoltent.
L’humour a encore un sens. Celui, littéralement, de dédramatiser, de démystifier, le mal, la peur, la haine, peut-être pour nous aider à mieux appréhender ce qui nous tend. Comme c’est étonnant, le rire détend de tout.
P’tit Quinquin, en somme, c’est Tati déconstruit, remâché, vomi par David Lynch. C’est une savonnette qui se fait la malle (le désordre) et qui ne cesse de rebondir, en jonglant de paume en paume, sans jamais tomber à terre (l’ordre).
Parce qu’il y a de la grâce dans ces gueules cassées. Une grâce touchante, évidente, simple. Celle des gens simples, celle qui ne s’encombre pas de semblants, celle des enfants qui s’étreignent par amour et un peu par une sagesse que leurs parents ignorent, ou celle encore d’un commandant de gendarmerie tout heureux de réaliser un rêve d’enfant en montant sur le canasson d’un suspect.
La grâce des petits riens, oui. Et un bel hymne à la bêtise — pour ne pas dire à la contemplation de la bêtise. La fin des exigences d’un monde sans humanité. L’humanité, c’est l’empathie à l’égard du prochain, en particulier des plus faibles, des plus stupides, des plus incompétents et des plus cons. Oui, on peut être un brin con, incompétent, bizarre, et peut-être même totalement dingue… et alors ? On n’en reste pas moins un homme. Le ou les criminels courront toujours, parce que le mal, c’est un peu celui qui rôde en chacun de nous, celui qui juge, qui exige, qui fraude, qui trompe, qui profite… La menace est là, alors peu importe qu’il y ait un coupable et que l’on trouve une résolution finale à ces histoires. Parce que tuer le mystère ferait en quelque sorte que l’on soit soulagés d’y trouver un coupable. Et forcément, à travers sa salle gueule de bon coupable, on l’aurait juré « ça ne pouvait être que lui, le salaud », et l’on se serait alors détournés de l’empathie que forcent le film et son humour. Pour faire preuve d’intelligence, il faut parfois se forcer, mais parfois aussi, pour rester simple et un peu con, voire béat, naïf face au monde, c’est tout aussi dur. Le droit à la connerie.
L’adjoint y trouverait la plus simple et la plus évidente des philosophies. Une sorte de contemplation béate, et vide, de l’instant qui passe… ou du criminel qui fuit. Comme une forme de renonciation molle à comprendre l’inexplicable, l’inexcusable. L’esprit français en somme, l’autre côté résigné du Français qui s’égosille de tout. La traduction absurde du mono no aware japonais, comme le cérémonial qui tout à coup se détraque, comme un chat serein qui pète, comme une bouilloire qui siffle… et qui tout à coup bégaie et se tait. Dumont parle de tragique-comique, je préfère y voir la beauté, la fausse cruauté, la dérision poétique du théâtre de l’absurde.


Alors, tout n’est pas parfait. La maîtrise d’un genre que Dumont découvre déraille elle aussi. Si une grande part de la réussite du film, du ton et de son humour, tient de son casting, certains personnages, féminins notamment, peinent à convaincre. Les moins grotesques sont les moins bien lotis. Si les personnages grimaçants opèrent une transformation bénéfique, comme ceux de la commedia dell’arte avec leurs masques, les plus normaux se retrouvent ironiquement mis à nu dans un délire grotesque qui n’est pas le leur et, tout à coup, ce sont eux les intrus, les monstres avec leur masque de quasi-normalité. Avec des acteurs professionnels, ou avec une plus grande maîtrise dans l’art de la comédie, on n’y aurait peut-être pas vu tant de décalage, mais on y voit surtout ici des acteurs mal à l’aise dans une sorte d’entre-deux (entre grotesque et réalité) qui sonne faux. Le tragique-comique dont se réclame Dumont, c’est sans doute une alternance entre l’un et l’autre, et ça marche essentiellement parce qu’il ose. Or la chef majorette ou la journaliste par exemple, voire le maire et le procureur, s’ils ne sont que des faire-valoir, leur normalité sonne tout à coup bizarrement dans ce monde. Dumont a peut-être jugé bon d’offrir un contraste normatif à ses gueules cassées. Peut-être n’a-t-il pas trouvé le ton ou les acteurs pour cela, quoi qu’il en soit, leurs apparitions font chaque fois un peu flancher la tonalité générale du film. (Dans la comédie italienne, on retrouve parfois ces personnages « normaux », pour contraster, avec Cabiria par exemple, ou le Fanfaron de Gassman, mais le plus souvent ce sont des bourgeois, et c’est presque alors toujours l’occasion de tirer vers la satire ; sans compter que la postsynchronisation offrira la possibilité de glisser à nouveau vers un étrange qu’on ne trouvera jamais avec des acteurs amateurs jouant comme dans un film fait maison.)
Il a été beaucoup question de caricature pour définir le film, comme si c’était un défaut. Oui, on n’est pas dans le réalisme, c’est de la bouffonnerie, du burlesque, et tout ça, c’est de la caricature. En quoi est-ce que ça devrait être un problème ? Parce que le film caricature les gens du Nord, les pauvres, les cons, les fous, les handicapés, les racistes ? Ça pourrait être détestable, c’est vrai, si des acteurs professionnels et des dialoguistes parisiens étaient venus y fourrer leur nez. Mais ici, on a affaire à des acteurs qui se moquent d’eux-mêmes. Ils n’ont pas l’intention de se moquer l’autre, ils se moquent de leur propre bêtise, de leurs excès, ou en tout cas, de ce qu’ils peuvent avoir en eux de caricatural. Ce qui est détestable (et encore), c’est de moquer l’autre, surtout quand il est « petit » ou « faible ». Or, tout ce qu’on retient ici de cette capacité de certains à se moquer d’eux-mêmes quitte à chercher en eux des excès qui pourraient être les leurs, pas ceux des autres, c’est qu’ils sont beaux et sympathiques, aimables et attachants dans leurs bassesses. La caricature sert à faire tomber les masques, mais d’abord ceux qu’on porte soi-même. Se caricaturer soi-même, c’est se mettre à nu, dire à celui qui nous regarde : « Je sais que c’est ainsi que vous me percevez, je ne suis pas dupe, mais vous, êtes-vous bien certains de pouvoir voir au-delà de ce masque ? » Les plus grotesques dans le film, ce sont aussi les plus attachants. Et dans un monde où une bonne part du mépris porté à l’autre tient à la peur ou à la méconnaissance que l’on a de lui, eh bien, cet humour ne peut avoir qu’un effet bénéfique.
Maintenant qu’il semble acquis que Dumont nous propose une autre saison, et vu que l’aspect raciste a plutôt été évoqué de manière tragique (et juste), osera-t-il caricaturer les migrants, voire les passeurs, les activistes ou de vrais (pas un mirage) criminels… ? P’tit Quinquin et ses amis, par exemple, sont clairement racistes, et ça n’empêche en rien, pourtant, de les trouver sympathiques. L’humour démystifie. Certains pourraient y voir un danger. Alors, est-ce qu’on trouverait de bon goût de caricaturer migrants, passeurs, activistes et criminels ?… Est-ce qu’on aurait ri si P’tit Quinquin était grand et bastonnait un Noir ? On peut se poser la question, au moins : on juge peut-être à tort qu’un « p’tit nègre » se faisant lyncher comme n’importe quel gosse de son âge, ce n’est pas si grave… On minore facilement les conséquences de ces « chamailleries ». Or fort justement, le film nous rappelle que cette cruauté, ce mépris de l’autre, n’est pas moins indolore pour un gosse. Il serait intéressant de voir si la caricature est acceptable dans l’autre sens. On admet l’incompétence des gendarmes parce que l’assassin reste un mirage (la non-élucidation de l’intrigue était très juste) et que les morts s’enchaînent comme dans un jeu absurde sans conséquences, comme Michel Serrault se regardant se vider, impassible, dans les couloirs du métro de Buffet froid, un couteau dans le ventre.
Jongler entre rire et drame, chercher à donner un sens au rire, c’est un exercice plutôt périlleux, et je serais en tout cas curieux de voir si Dumont parvient à renouveler ce petit miracle.


P’tit Quinquin, Bruno Dumont 2014 | 3B Productions, ARTE, Pictanovo Nord-Pas-de-Calais
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel