Fraggle Rock

Superstar: The Karen Carpenter Story

Rarement vu un film aussi perturbant. En 40 minutes, Todd Haynes (futur réalisateur de Loin du paradis) choisit de montrer la rapide ascension et la tragique fin de la chanteuse des Carpenters. Haynes va droit au but et commence par la scène où la mère du duo la retrouve inconsciente dans la salle de bains. Vu subjective, papotage guilleret de la mère avec cet affreux accent des bonnes familles californiennes pour qui tout est merveilleux… Jusqu’à la découverte du corps de sa fille.
La première impression est étrange. On se demande si on va pouvoir suivre 40 minutes de films en vue subjective. Et en fait, ce n’est pas du tout ça. Ce n’était qu’un procédé, le meilleur qui soit (assez flippant de choisir l’angle le plus choquant pour entamer une histoire), pour introduire la thématique du film et expliquer les raisons de la mort de cette star éphémère qu’était Karen Carpenter.
Haynes continue son récit avec un interlude explicatif sur ce qu’est l’anorexie. Plusieurs fois tout au long du récit le film s’attardera ainsi comme pourrait le faire un film documentaire ou un film éducatif digne de Badmovie.
C’est que Haynes est prêt à utiliser tous les effets pour faire rentrer le spectateur « au mieux » dans la tête de Karen, du moins comprendre la névrose dont elle était atteinte et dont son entourage n’était pas conscient.
On va suivre très rapidement l’ascension de Karen et de son frère Richard, tout en connaissant la fin. Il n’y a pas une seconde du film qui n’est pas tourné vers cette seule obsession : comment Karen Carpenter a-t-elle pu s’enfermer dans une telle névrose alors que tout lui réussissait ?
Le contraste de cette fin connue, dont on attend avec crainte les premières prémices, avec le ton toujours très enjoué de la famille Carpenter a la saveur de ces thrillers clairs à la Kubrick où la peur en est d’autant plus présente qu’on sait que quelque chose rôde, mais qu’on ne peut la voir. Elle n’est pas dans l’ombre, elle est juste là, sous la lumière, et on ne pourra pas l’identifier.

Superstar: The Karen Carpenter Story, Todd Haynes 1988 | Iced Tea Productions
Autre idée de génie de Haynes, c’est l’utilisation de poupées Barbie pour mettre en scène cette tragédie. Quand on décide de mettre en scène une telle histoire, on doit faire face à plusieurs écueils. Aucun acteur ne sera assez convaincant pour représenter un personnage connu de tous, aux multiplex talents, et surtout sans donner l’impression de faire une hagiographie. L’utilisation des poupées résout d’un seul coup tous ces problèmes. Haynes parvient ainsi à avoir la distanciation nécessaire pour trouver son sujet. Mieux, les poupées apportent ce même contraste qu’on retrouve partout dans le film pour saisir la dangerosité et l’imposture des apparences. Ces personnages qu’on entend, tout mielleux, tout plein de bonnes intentions, sont en effet flippants de bêtise. Et leur donner cet aspect figé des marionnettes ne fait que renforcer cette idée de dichotomie entre ce qu’on voit, et ce dont on peut craindre.
Même chose pour la musique. La musique des Carpenters est mièvre, pleine de bons sentiments, toujours joyeuse. Ça contraste avec la tragédie qu’on connaît. C’est comme sucer un bonbon au cyanure.
D’ailleurs, à cause de cette musique, un effet auquel n’avait pas prévu Haynes va encore s’ajouter pour augmenter encore plus les contrastes et l’impression d’étrangeté du film. Le réalisateur n’ayant pas demandé les droits pour l’utilisation de ces musiques, Richard Carpenter a porté plainte et a eu gain de cause : le film a été interdit. Le film a dû circuler en douce depuis le temps, devenant au passage un film culte, et est désormais disponible sur Youtube.
De fait, la qualité de l’image est assez médiocre, certains lettrages sont difficiles à lire, et l’effet « film étrange sorti de nulle part » n’en est que renforcé. On a l’impression de voir un film perdu et miraculé.
Imaginez que la civilisation humaine disparaisse, qu’il ne reste pratiquement rien de notre passage, et puis, des petits hommes verts viennent sur Terre et trouvent une K7 de n’importe quel film. Pour eux, les hommes peuvent bien être des poupées Barbie, ça ne changera pas grand-chose. Eh bien, c’est un peu l’impression que laisse ce film en jouant avec ces extrêmes.
Aucune idée si Haynes voulait traiter le sujet de l’anorexie en faisant ce film, s’il trouvait cette histoire touchante et tragique, s’il voulait dénoncer les excès de la dictature de l’image. Malgré tout, il reste suffisamment distant pour laisser toutes les interprétations possibles. J’ai même vu des commentaires le trouvant drôle. Pour moi, c’est une tragédie moderne, parfaitement mise en scène.
La mise en scène, justement. J’ai été particulièrement impressionné par la maîtrise d’Hayes dans le montage des plans, des séquences (il arrive même à intégrer un certain nombre d’idées et de plans très “expérimentaux” qui passent malgré tout très bien la rampe parce qu’il n’en abuse pas et qu’on comprend que ça participe à la création d’une atmosphère), des mouvements de caméra, de l’utilisation de la lumière.
Et c’est merveilleusement bien écrit, si toutefois on comprend qu’il y a une sorte de second degré, légitimé par l’entrée en matière du film qui révèle tout net le sujet du film (l’anorexie) vers quoi tout le récit tend. C’est un ton qui n’est pas forcément facile à trouver. Il aurait pu être tenté de forcer le trait en demandant aux acteurs de jouer également avec à l’esprit une forme de second degré. On serait tombé dans la force, le mauvais goût. Or, ici ce qui frappe, c’est le côté thriller, bien flippant. Haynes n’a pas envie de rire. Oui, ces gens sont cons, inconscients, à la recherche de la gloire, mais il ne les juge pas, il ne fait que décrire certains maux de l’Amérique des années 70, et même encore d’aujourd’hui (même si on sent bien l’atmosphère très insouciante de ces années, mais d’une certaine manière, là aussi, on sent la fin des trente glorieuses…). Et s’il le fallait encore, le film enfonce le clou pour expliquer les ravages de cette maladie mentale qui, semble-t-il, avant la mort de Karen Carpenter était peu connue.
40 minutes, ce n’est pas long, et c’est absolument à voir.












 Année : 1996
Année : 1996



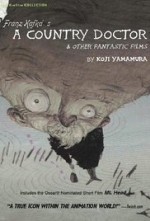
 Année : 2007
Année : 2007
 Année :
Année : 