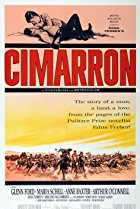La Cible humaine 2, ou l’art du renoncement

Victime du destin

Titre original : The Lawless Breed
Année : 1953
Réalisation : Raoul Walsh
Avec : Rock Hudson, Julie Adams, Mary Castle
gâchoterie
Film sympathique à la morale inattendue. Une sorte de western basé sur la vie (et l’autobiographie) d’une des plus fines gâchettes du Texas qui passa seize ans de sa vie dans un pénitencier.
Le film se révélera être un film militant contre le port d’armes. Voilà qui est assez inattendu pour un western, genre dans lequel on cause rarement de cet aspect des choses, surtout quand il s’agit d’un homme qui a souvent usé de son « droit » de se défendre.
Wes est le fils d’un homme pieux et dur, mais il ne partage pas ses idées religieuses. Il ne partage finalement qu’une seule chose avec lui : l’amour de sa sœur, recueillie dès son enfance par son père alors qu’elle était orpheline. Wes compte bien se marier avec elle, un jour, fonder une bonne petite famille avec un ranch, tout ce dont rêve un Texan. Mais pas avant d’avoir gagné suffisamment d’argent. Battu par son père qui n’apprécie pas son penchant pour les jeux d’argent et le goût des armes, Wes s’enfuit. Il gagne souvent à la table de jeu mais cela lui vaut pas mal d’inimitié. Et dans l’Ouest, quand on n’apprécie pas, ça se termine souvent par un duel. Là, la règle est simple, c’est celui qui dégaine le premier qui a tort ; si on dégaine en second, on est en légitime défense. D’où l’utilité d’être rapide et précis. Ce sera le tort de Wes pendant tout le film. Il finit par se faire une réputation de fin tireur et se met à dos une fratrie après avoir liquidé l’un d’eux. Ils y passeront tous. Chaque fois, Wes dégaine en second. Seulement, cela commence à lui attirer de plus en plus de soucis, notamment la flicaille corrompue pour qui les circonstances semblent un peu trop souvent favorables au garçon. Wes, s’estimant dans son bon droit, refuse de se rendre à la police. Il se laisse enfin convaincre quand il est question de son mariage avec sa belle. Il se sert de l’argent qu’il a gagné aux jeux pour payer les « frais » de justice, et il demande que son procès soit remis à un peu plus tard, le temps qu’il choisisse une robe de mariée pour sa sœur et qu’il l’épouse. Un shérif d’une autre ville ne l’entend pas de cette oreille, et lui ordonne de se rendre sur-le-champ. Wes refuse et le shérif lui tire dans le dos. Wes n’est que blessé, il se retourne et alors qu’on le croyait désarmé, sort une arme de son veston et tire sur le shérif. Il se réfugie chez son père, mais là aussi, on commence à trouver douteuse cette manière qu’il a toujours de s’en tirer. Même sa rouquine de sœur se demande s’il n’est pas juste un assassin. Pas le temps de s’expliquer : une milice vient le chercher jusque chez son père, il n’a pas levé son arme que la milice tire déjà sur la maison… Wes parvient à s’enfuir, mais sa rouquine de sœur est tuée. Dans le dos.


Dès lors, commence une course-poursuite, puis un jeu de cache-cache qui durera plusieurs années, durant lesquelles il se pacse avec la fille de saloon qui l’avait, elle, toujours soutenu et aimé (magnifique Julie Adams). Finalement, il accepte son amour, lui demande sa main et lui fait un gosse (on est rapide ou l’on ne l’est pas). Mais toute la région est sur sa trace et attend un signe de sa part qui trahira sa présence. C’est chose faite quand il enverra une lettre à son père pour lui signifier la naissance de son fils (« On ne me l’a pas fait dans le dos, p’pa. »). Plusieurs rangers lui tendent un piège, et il est finalement arrêté, puis jugé. Faute de témoin pour l’accabler le jour du procès pour le meurtre du shérif qu’il a tué, il n’écope finalement que de vingt ans de pénitencier.
Il en ressort une quinzaine d’années plus tard, part directement déposer un manuscrit au premier éditeur venu : l’histoire de sa vie. C’était ainsi que commençait le film. On retrouve l’éditeur à la fin de sa lecture. Les yeux encore mouillés d’émotion, on entend sa femme lui prier de venir prendre son goûter, lui demande ce qu’il a lu, comment l’histoire se finit. Et l’éditeur de dire : « Je ne sais pas, parce que l’histoire n’est pas encore achevée. »
Et en effet, le véritable intérêt du film tient dans cet épilogue.
Wes rejoint sa femme dans le ranch où il l’avait laissée quinze ans plus tôt. Il découvre son fils de seize ans pour la première fois. C’est presque un homme désormais. Et Wes pète les plombs, comme son père autrefois, quand il voit que son fils a repris le relais en portant fièrement son arme à la ceinture (ah, les familles monoparentales…). Wes, lui, a changé, il semble avoir compris que même s’il était toujours dans son bon droit durant ses duels, il était coupable par le simple fait de porter une arme, même si la loi lui autorisait… Quels que soient les hommes, les conflits et les querelles sont légion. Mais toutes ne se régleraient pas en duel si les armes n’étaient pas aussi répandues, si on ne possédait pas une arme aussi radicale à la ceinture…
Wes retrouve son fils dans un saloon où un inconnu reconnaissant le fils du fameux Wes lui cherche des noises (un peu comme on en cherche à Gregory Peck dans la Cible humaine), le gamin est tout près de dégainer son arme, mais son père arrive à temps pour l’y en empêcher. Toutefois, en partant, Wes est blessé alors que l’homme qui lui a tiré dessus (toujours de dos) le menaçait. Pour se justifier, l’homme regarde autour de lui pour trouver des alliances, en disant qu’il l’avait vu tirer son arme… Il est maîtrisé par les hommes présents. Wes n’est que blessé. Il fait promettre à son fils de ne plus porter d’arme.
Naïf, mais c’est pour la bonne cause.

Victime du destin, Raoul Walsh 1953 The Lawless Breed | Universal International Pictures

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel


































 Année : 1951
Année : 1951