Comment un film de propagande à la gloire du fisc américain arrive-t-il à être produit par une société de production anglaise ?… Et surtout, comment arrive-t-on à tirer le meilleur sur un tel sujet ? Non, mais pourquoi ne pas faire de bons polars avec des huissiers de justice aussi…
L’idée est donc plutôt originale, au départ. Les agents du fisc, vu comme ça, ça ne donne pas vraiment envie. Sauf qu’on les voit en pleine action, mener une large infiltration dans tout le milieu des faux-monnayeurs. Film noir, oui. Des flics, bien particuliers, qui ne sont pas pour une fois à la poursuite d’un meurtrier ; des gangsters, mais un milieu très peu montré au cinéma, et c’est sans doute dommage, parce que les usages ne changent pas de ceux qu’on peut voir dans les autres films « policiers », leurs méthodes restent les mêmes.
Le plus réussi ici, c’est l’atmosphère de film noir. Le sujet se prête particulièrement bien au genre. Des flics qui s’infiltrent chez l’ennemi. Un ennemi qu’il faut d’abord identifier. C’est un peu comme un jeu de piste : il faut débusquer l’ennemi, se faire passer soi-même pour un faux-monnayeur et remonter petit à petit les échelons qui vous mèneront au boss des boss. On n’est pas loin d’un scénario de jeu vidéo. Rarement le même décor, une rencontre avec des tas de personnages secondaires (je vais y revenir). Ce n’est pas statique. Rarement une scène dépasse les deux minutes. Au point de vue du rythme, c’est typique du film noir : des scènes lentes mais courtes, auxquelles quelques scènes des violences servent de contrepoint, tout ça monté très rapidement ; seule l’action de la trame générale qui doit mener le héros à s’approcher de plus en plus près du grand boss, compte. Aucune scène ou dialogue superflus. À la limite d’une démonstration, d’un documentaire — un play-by-play d’une opération du fisc pour approcher et faire arrêter ces faux-monnayeurs.
Le ton est volontairement sérieux, austère, avec une voix off assez didactique, qui pour une fois dans un film noir ne reflète pas la pensée du héros, mais présente en quelque sorte le point de vue du Trésor américain (le film commence d’ailleurs par un représentant du Trésor…, est-ce un comédien, un mec qui « joue » son propre rôle ? difficile à dire, mais ça donne au film son caractère, ancré fermement dans la réalité). Mêler style documentaire et film noir, avec ses ambiances étouffantes, c’est quelque chose qui se marie bien.

J’en ai déjà dit pas mal sur l’histoire, donc inutile de dévoiler le reste. Je voudrais revenir sur les personnages et les acteurs. Rarement, j’aurais vu dans un film autant de personnages secondaires si bien écrits, parfaitement définis. Souvent des archétypes du film noir : le truand couard et apeuré, la fille de bar qui sert de la messagère, l’homme de main, le flic dévoué mais malchanceux (en opposition avec le personnage principal souvent plus roublard, qui, lui, a un bol toujours énorme dans son malheur : d’un côté, le récit a besoin de le plonger dans des intrigues impossibles, et d’un autre, il arrive toujours à s’en sortir par la ruse ou la chance…), la femme fatale, le technicien à lunettes indispensable dans un organigramme, etc. Ils sont pratiquement tous là, et le film arrive pourtant à leur laisser suffisamment de champ pour qu’on les identifie bien, même si on ne les voit que pendant une, deux scènes. C’est même ça la force du récit : dans un tout autre film, on a des personnages secondaires, on les voit une fois et on les oublie. Là ce sont bien souvent de vraies scènes avec le personnage principal, et ils sont un peu comme des repaires sur une pelote de laine que le héros tire pour arriver au boss : dans un premier temps la pelote en tirant dessus dévoile un à un ses personnages, puis on tire dessus pour faire apparaître d’autres personnages qui sortent de la pelote. Ils naviguent autour du personnage principal comme des satellites ou des mouches commandés par le boss qui, lui, reste dans l’ombre, alors que ses hommes font les go-between entre lui et le héros.
Les acteurs, pour cela, aident bien. Il faut pour ces personnages secondaires fabuleux, des comédiens pleins d’autorité et d’intensité. Comme dans L’Île au trésor : le récit nous dévoile un à un au début du livre les hommes de Long John Silver, tous de braves gaillards qui inspirent à la fois crainte et fascination dans l’esprit de Jim, jusqu’à la rencontre avec le boss… crescendo… On n’est donc pas du tout dans l’optique des moins-que-rien travaillant pour un boss. C’est beaucoup plus intéressant et spectaculaire ainsi. Il fallait trouver des acteurs de qualité pour cela. Ils donnent au récit une tenue bien plus crédible que s’il y avait une star et à côté des zouaves : là, le personnage principal est excellent acteur mais pas une star, et les autres sont à son niveau (chacun ayant droit à ses gros plans si c’est nécessaire).


Nous avons donc Dennis O’Keefe en infiltré du Trésor américain (un petit côté Dana Andrews).
Charles McGraw, en homme de main (chargé des interrogatoires : la scène est visible sur Youtube). Grosse carrière pour lui : il est notamment l’entraîneur des gladiateurs dans Spartacus ou le policier dans l’excellent Énigme du Chicago Express.
Les femmes y ont un rôle très anecdotique, mais on les remarque dans des scènes marquantes. June Lockhart, qui joue la femme du coéquipier infiltré. On ne la voit que dans une scène aux conséquences terribles pour son mari.
Mary Mead, qui joue la fille de bar (boîte de nuit plutôt, qu’il faut avoir dans tout bon film noir).
Le meilleur pour la fin, un rôle un peu moins anecdotique, celui du personnage le plus haut placé après le boss, donc une surprise de voir cette vamp à cette place (et dire que ça fait seulement trois ans que les femmes ont le droit de vote en France… et là, on voit que le Premier ministre de la pègre est une femme). Jane Randolph ; avec son petit nez assassin à la Janet Jackson.
Il faut remarquer aussi la belle ironie du titre français (Brigade du suicide), qui rappelle bien à quel point cette opération d’infiltration est dangereuse. Le « T » de T-men renvoie, lui, à Treasery dans Secretary of Treasery. C’est le surnom des super gentils que les super méchants ont inventé pour les identifier (la mission est d’autant plus difficile qu’ils se savent infiltrés et la suspicion est donc permanente dans le film : il suffit de voir le regard Mrs Simpson…).

La Brigade du suicide, T-Men, Anthony Mann 1947 | Edward Small Productions, Bryan Foy Productions

 Année : 1940
Année : 1940












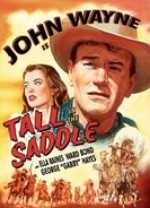 Année :
Année : 




 Année : 1945
Année : 1945












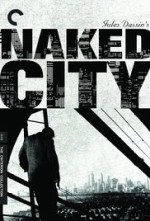

























 Année :
Année : 

