Improbable film-somme. À la fois Les Dents de la mer avec sa déferlante non-stop de vagues de félins se ruant les uns sur les autres, mais le plus souvent aussi sur tous les membres du casting qui passent leur temps à fuir devant cet essaim de piranhas sur pattes ; mais aussi film baba cool familial prônant l’amour des bêtes avec la plus hilarante bêtise ; de ces deux genres contradictoires accouche un dernier genre, celui du thriller animalier.
Ça pourrait être Massacre à la tronçonneuse réalisé par Werner Herzog, sauf que les psychopathes, ce serait plutôt les fous chassés tentant tant bien que mal de rester en vie et de balancer leurs répliques idiotes (et parfois drôles tant elles reflètent leur inconscience). Mais il y a bien dans cette entreprise extrême un petit quelque chose qui n’est pas sans rappeler la folie herzogienne (celui peut-être de Grizzly Man).
On pourrait y voir encore une sorte de Maman j’ai raté l’avion sans trucages, tant le scénario, d’une simplicité navrante mais efficace, tient en une idée simple : papa va chercher sa famille à l’aéroport, mais est retardé par ses deux tigres de compagnie, qui ont malencontreusement fait chavirer la fluette arche-embarcation sur laquelle tout ce petit monde était censé cohabiter dans la joie. Du coup, femme et enfants décident de prendre un taxi pour découvrir seuls leur nouveau chez eux, façon Claudia Cardinale dans Il était une fois dans l’Ouest. Certains en sont à une idée un plan ; d’autres répètent, entêtés, ou pas loin d’être étêtés, un peu gribouille, la même idée tout au long d’un même film. Il doit y avoir un point à partir duquel la folie de répétition, toute en rugissements et en rimes pauvres, devient poétique.
Scénario découpé ou écrit à la griffe donc, mais le film tient d’un bout à l’autre, et en toute efficacité, dans ce chassé-croisé permanent rappelant la naissance du cinéma et des premières heures du montage alterné. Primitif, dans tous les sens du terme.
C’est affligeant, on ne sait trop au juste sur le papier ce que Marshall pouvait bien avoir derrière la tête (sinon une bonne paluche de félin taquin) quand il a imaginé pour la première fois jeter sa famille au milieu des fauves, dans une baraque en carton qui a tout du piège à souris. Le plus drôle, et le plus fascinant, lors du visionnage, c’est d’assister incrédule au décalage entre la fuite permanente des acteurs face à des nuées de prédateurs qui ne sont pour eux au mieux que des poupées de chiffons, et les quelques lignes de dialogues censées être rassurantes sans qu’on sache si elles sont destinées aux autres personnages ou aux spectateurs dans une vaine tentative de nous convaincre que tout est parfaitement prévu jusqu’à leurs plaintes et leurs appels au secours. C’est un peu comme proposer à un fakir de venir marcher sur des braises et de les changer au dernier moment par des lames de rasoirs : placé devant le fait accompli, le fakir accepte malgré tout le défi, comme esclave du propre tour qu’il est habitué à fournir à son public, chaque pas devient alors pour lui une souffrance et lui entaille la plante des pieds, mais tout du long comme au bout de son supplice, il persiste à s’illusionner plus que son public et à dire que ce n’est rien. De la folie pure.

Un carton annonce au début du film, même pas ironiquement, que les animaux n’ont pas été blessés durant le tournage (ce qui est faux d’ailleurs, on voit des bêtes blessées, et plusieurs auraient été tuées, abattues, ou victimes d’incidents dont un incendie qui aurait ravagé une partie de la propriété familiale). Parmi les animaux que nous sommes, beaucoup ont par ailleurs fini à l’hôpital. On assiste ainsi par exemple à une attaque démente d’un éléphant contre Tipi Hedren (qui se serait cassé la jambe à l’issue de cette séquence) s’acharnant ensuite sans raison apparente sur une simple barque… (Il n’y a pas que les membres de l’équipe qui étaient fous, ces animaux à force de vivre dans un si petit espace, mêlés à de nombreux autres prédateurs, ne réagissent pas comme ils le feraient dans la nature).
Autre singularité folle. Deux jours de temps diégétique pour presque dix ans de production…
Dramatiquement parlant, le film est peut-être plus visible aujourd’hui, la distance aidant, le recul, et la certitude qu’un tel film serait impossible à faire de nos jours. C’est non seulement drôle au visionnage, mais surtout, on cesse très vite d’y chercher un sens, et on ne voit plus que ce que c’est : un film dévoué à la seule expression de la folie de ses auteurs. Si on mêle à cela la peur constante, réelle, qu’on couve pour les membres de la famille, et la distance ironique, parfois consciente d’être inconsciente (comme le montre parfois le ton taquin de la musique), et on a comme l’impression d’assister à quelque chose de réellement singulier qui mérite d’être regardé.
On peut le voir aussi comme le summum d’une époque avec ses délires et ses excès : le film sort en 1981 à peine exploité, mais il a fallu toutes les années 70 pour le mettre en œuvre. Vu aujourd’hui, c’est un peu comme voir le lointain et tardif épilogue d’un eldorado qui n’aurait pas connu le meurtre de Sharon Tate censé siffler la fin des années 60. Ces années 70 sont encore en roue libre, sans retenue ni barrières, nous proposant une sorte de gang bang de la peur tournant au snuff movie : de La Petite Maison dans la prairie version hippie, de son innocence, on arrive tout droit à la crise et à ses années 80, brutales, sans rien y comprendre. Out of Africa. Gorille dans la brume… jusqu’aux années 80 on assistera épisodiquement à la fin de cet exotisme niais et de la prise de conscience que l’autre bout de la planète est à la fois à portée de main, mais aussi un environnement tout autant en danger que lui-même dangereux ; mais jamais on ne retrouvera cette folie collective qui ne pouvait prendre corps que lors d’un tournage encore imprégné des idées des années 60. Les années 80 mettront fin à ces illusions démentielles, celles de voir la nature, exotique, brutale, continuellement avec des étoiles floues dans les yeux et des fleurs dans les cheveux. (Quoique, ce biais est toujours d’actualité : la nature continue d’être vue comme infailliblement bénéfique, bienfaitrice ou rassurante… Au moins n’y mêle-t-on plus de gros chats prêts à nous sauter dessus.)

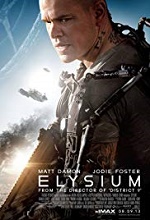












 Année : 1949
Année : 1949


 Tout en haut du monde
Tout en haut du monde














