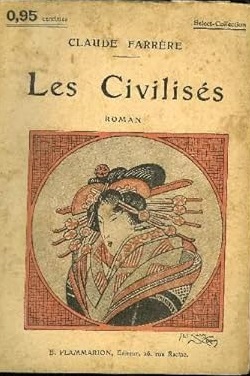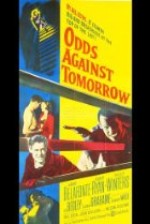La lune était bleue
Titre original : The Moon Is Blue
Année : 1953
Réalisation : Otto Preminger
Avec : William Holden, David Niven, Maggie McNamara
Remarquable comédie américaine qui semble assez renouer avec l’esprit des années 30, voire avec celui du pré-Code. Quelques situations et lignes de dialogues étonnent encore aujourd’hui tant les films de cette époque nous ont habitués à être beaucoup plus aseptisés. On y parle ouvertement de rapport sexuel, et cela sur un ton plutôt badin, voire absurde et innocent pour ne rien arranger. Rien que le terme « sexuel » quand il jaillit à l’écran, dans la bouche d’une jeune femme faussement candide vous fait écarquiller les yeux et ajoute au plaisir de cette joyeuse comédie romantique et loufoque.
Une version revisitée de la pièce aurait quelque chose de savoureux et d’instructif. Certains sujets de préoccupations bien actuels sur les rapports entre homme et femme sont évoqués ici : le consentement, l’écart d’âge entre prétendants, l’égalité des traitements ou les préjugés concernant les mœurs attendues d’une innocente demoiselle… Avec quelques retouches et une approche différente, en accentuant ici ou là, le film parlerait de notre société comme on n’ose pas trop le faire encore aujourd’hui.
C’est que très vite, quand le film s’introduit sur une rencontre entre un homme censé avoir trente ans (William Holden en avait en réalité cinq de plus, soit dix ans de plus que sa partenaire) et une fille à peine devenue adulte, pendant tout le premier acte, on ne quitte pas ces deux personnages principaux. La lune sera peut-être bleue pour nos tourtereaux, mais à se demander si la lune n’est pas aussi le lieu d’origine de cette étrange créature qui s’étonne de tout, sauf peut-être, des hardiesses séductives et si peu originales de son prétendant architecte.
Là où au cœur des années 50 à Hollywood, on pourrait s’attendre à du glamour et à des répliques convenues, pleines de repartie, l’audace, l’innocente (feinte ou non), la candeur loufoque et absurde de Patty désarçonnent autant le dragueur petit-bourgeois qu’est Don que le spectateur. Au contraire des personnages que Judy Holliday incarnait par exemple à la même époque (en particulier trois ans avant, déjà avec William Holden, dans Comment l’esprit vient aux femmes), Patty n’a rien d’une idiote. On peut le croire aux premiers instants, trompés par son air lunaire et surtout par sa spontanéité renversante. Mais à de nombreuses reprises, elle démontre qu’elle ne s’en laisse pas conter tout en parvenant à garder son détachement. C’est là tout le charme non pas romantique du personnage, mais son charme tout court : on ne peut cesser de porter notre attention sur elle tant son comportement intrigue. On attend la prochaine réplique faussement innocente qui laissera penser qu’elle a parlé un peu trop vite avant de subodorer qu’il y a un fond de bon sens et… de folie dedans.
L’une des interrogations de notre époque concerne la manière dont il faut prendre au sérieux les atteintes à la dignité des femmes et aux agressions quand elles se trouvent seules avec des hommes. Paradoxalement, c’est en mettant en scène ces situations et en les (dé)dramatisant que le sujet peut être traité. La spontanéité de Patty révèle qu’elle est loin d’être dupe. Un peu comme dans une expérience de pensée sans conséquence, elle se jette ainsi presque innocemment dans la gueule du loup. Ce dernier finit tellement estomaqué par le caractère insaisissable et unique de cette jeune actrice sans talent qu’il perd toute contenance, tout appétit, et n’entreprend plus rien pour forcer les choses (en dehors d’un baiser volé qui ferait froncer un sourcil aujourd’hui).

Tout le premier acte glisse ainsi dans un romantisme loufoque qui donnerait presque une voix (pré-Code) au personnage de It Girl qu’incarnait Clara Bow au temps du cinéma muet. Ce dévergondage n’est pas sans rappeler aussi celui de Ginger Rogers, surtout dans The Major and The Minor, différence d’âge oblige, mais le film jouait avant tout sur un quiproquo et le personnage était forcé de feindre l’ingénue et de se travestir (comme plus tard le duo de Certains l’aiment chaud). Patty est beaucoup moins terre-à-terre : issue d’une classe sociale modeste, la Grande Dépression n’est plus qu’un vieux souvenir. Avec l’esprit des années folles, et sans la malice des années 30, elle semble avoir été parachutée dans le monde pour le conquérir.
Mais l’actrice à qui fait bien plus penser Maggie McNamara, moins clownesque que la partenaire de Fred Astaire (quand elle ne danse pas avec lui), c’est Audrey Hepburn. La même allure fluette, la même élégance de danseuse classique, les mêmes mimiques, et une certaine fantaisie, loin des contraintes terre-à-terre de la crise, héritée de Veronica Lake dans Ma femme est une sorcière ou de Jennifer Jones dans La Folle Ingénue. Seulement, la future Sabrina (toujours avec William Holden) n’était alors pas une star : le phénomène Hepburn commencera avec Vacances romaines, sorti… deux mois après La lune était bleue. Certaines tendances parfois semblent flotter dans l’air…
Un vaudeville ne peut tourner autour du même couple plus d’un acte entier (à moins de savoir d’une manière ou d’une autre y injecter un nouveau carburant). On aurait pu en rester là, après tout, le meilleur vaudeville de Feydeau, Feu la mère de Madame, se consume en un acte… Mais à Broadway comme à Hollywood, la norme, c’est les trois actes. La comédie prend un nouveau départ et se poursuit dans une veine loufoque, avec des accents britanniques en plus et quelques gouttes d’alcool (on se croirait dans The Thin Man). L’apparition du personnage qu’incarne magnifiquement David Niven sert de carburant à ce nouveau départ. Son incrédulité ahurie mais toujours distinguée malgré le coup dans le nez représentait sans doute le contrepoint parfait aux audaces et aux envolées absurdes de Patty. L’écart d’âge s’accentue, et l’inconséquence feinte (ou pas) de Patty, passant innocemment des lèvres d’un homme à celles d’un autre, ne semble pas avoir beaucoup enthousiasmé les précepteurs de la censure (le film n’aura son agrément qu’en 1961 et a dû faire face à quelques interdictions dans le pays).
Elle est là la modernité du personnage de Patty. En cassant tous les codes, elle donne quelques pistes aux femmes actuelles pour arriver à déjouer, par l’absurdité, les avances des hommes (même si elle finit dans le film, pas à céder, mais à prendre, elle, les devants). Le point à retenir : Patty est libre. J’aurais presque envie de dire aussi qu’il y a du Hamlet en elle. Le personnage de Shakespeare, insaisissable, peut être joué des millions de fois différentes. On y trouvera toujours des incohérences parce que Hamlet est incohérent. Patty est incohérente parce qu’elle est sotte comme elle est intelligente ; elle paraît être d’une effrayante naïveté avec les hommes, pourtant elle n’est dupe de rien (il faut penser à l’épisode de l’aiguille durant lequel elle fait mine pendant tout ce temps de jouer le jeu de la parfaite demoiselle capable d’aider le pauvre homme en détresse, alors que l’on comprend sur le tard qu’elle avait tout vu venir sans chercher pour autant à déjouer le calcul puéril de l’architecte ; en dehors du baiser volé, elle semble par ailleurs toujours initier ou guider les avances des hommes qu’elle séduit) ; tout paraît la surprendre, comme une fille de la campagne qui débarquerait dans la haute société (c’est ainsi qu’elle est en tout cas perçue par sa concurrente, la fille du personnage de David Niven et ancienne fiancée de celui de William Holden), mais elle montre à diverses occasions que l’on ne lui fait pas…
Un tel personnage insaisissable, on en rêve tous les jours quand on est acteur. Allez savoir pourquoi, par la suite, seule Audrey Hepburn (qui héritera de personnages et de films versant un peu moins dans la fantaisie et plus dans le romantisme en couleurs) deviendra une star. Il n’aurait en tout cas pas été impossible de voir l’actrice débuter dans un tel film. Le succès aurait été identique, et de la même manière, immédiat. Maggie McNamara n’aura pas cette chance, peut-être faute de talent, d’opportunité…
Jolie réussite et quel plaisir de voir autant d’audaces et d’à-propos dans une comédie dirigée par Otto Preminger alors que Billy Wilder, George Cukor et Howard Hawks menèrent la décennie, et alors que l’industrie du cinéma américain semblait plutôt délaisser les adaptations des pièces aux ambitions modestes de la scène de Broadway ou d’ailleurs au profit de plus grosses productions… Un relent vrillé et bienvenu du début des années 30.
La lune était bleue, Otto Preminger (1953) The Moon Is Blue | Otto Preminger Films
Sur La Saveur des goûts amers :
Liens externes :