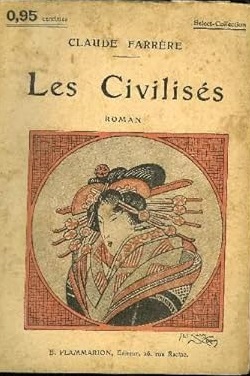
Roman qui correspond en tous points à l’image que l’on se fait d’un Prix Goncourt (reçu en 1905), même décerné au début du siècle dernier. Un style parfait, voire précieux, au service de pas grand-chose sinon d’un sujet à la mode susceptible de faire parler tout en évitant de trop susciter la polémique (ces « civilisés », ici, correspondent à la manière dont trois riches noceurs établis en Indochine se qualifient ironiquement — les barbares étant les colons qui ne tirent pas avantage des privilèges et avantages souvent sexuels que peuvent tirer les oppresseurs sur les populations locales).
Voilà pour le style, car, pour ce qui est de l’intrigue, ça tiendrait en trois lignes. Elle est d’ailleurs à l’image du bon esprit, que l’auteur tente de faire infuser au début de son roman : un humour propre aux diplomates, c’est-à-dire un peu mou et vide derrière les tournures et l’habilité un peu datée (les pauvres retrouvent leur tonton raciste à toutes les fêtes de famille, les classes supérieures doivent se farcir les remarques faussement fines de l’ambassadeur).
C’est que si les diplomates, les aristocrates ou les officiers multiplient les aventures de par le monde, ils n’en vivent pas pour autant de véritables histoires. Si les gens heureux n’ont pas d’histoire, il pourrait en être de même des parvenus, des diplomates, des personnes bien sages gâtées par les circonstances de la vie qui n’auront strictement rien à dire sur le monde dans lequel ils évoluent, parce qu’ils ne le voient et ne le conçoivent que d’un seul bord.
Paradoxalement, on effleure avec le sujet du roman un peu de ce monde réel, mais si la minceur de l’intrigue peut faire penser à une fable anticolonialiste, l’auteur semble surtout s’émouvoir des mœurs « civilisées » de ses trois protagonistes sans jamais réellement prêter attention à la logique impérialiste, et par conséquent, sans jamais montrer la moindre empathie pour les populations réduites le plus souvent à de l’esclavage sexuel.
La morale (internationale) derrière la morale (des lupanars) : Les colonies ne se porteraient au fond pas si mal si les occupants ne se résumaient pas à des personnes louches plus ou moins bannies de la métropole. Pour le démontrer, l’auteur punit ses trois noceurs en ne leur laissant aucune chance de rédemption : car en voilà deux qui tout compte fait espérerait se ranger et cesser leurs activités nocturnes. Messieurs, vous allez devoir payer. L’amour sera votre tombeau.

Barbarie, Civilisation, Hermann Paul (pour Le Cri de Paris, 1899)
Si l’intrigue est donc niaise, molle et simpliste (comme une fable, certes…), certaines descriptions de ces colons peu fréquentables derrière la respectabilité de leur rang, de leur grade ou de leur profession valent la lecture pour le vitriol avec lequel elles nous sont soumises et pour le soin stylistique qu’y a apporté l’auteur (pareil pour la description de Hong Kong).
Beaucoup des adjectifs employés pour qualifier les populations colonisées d’alors ne sont aujourd’hui plus d’usage, signe que le monde a bien changé depuis. On en aurait presque parfois la nausée à plonger dans cet univers colonial définitivement disparu : c’était probablement le but de l’auteur, sauf que plus d’un siècle après, pour un lecteur contemporain, cette absence de lois, de morale, cet écart gigantesque entre ceux qui possèdent tout et les autres qui n’ont rien et qui vivent des miettes des premiers, c’est tout ça qui donne la nausée. Bien plus que la débauche qui n’en est en fait que la conséquence logique.
Le plus triste, c’est que d’une certaine manière le monde actuel tend un peu vers un retour de ce monde ultra-déséquilibré, plein d’excès de toutes sortes avec quelques nantis pour en profiter et la majorité qui survit. L’empire n’est plus colonial, mais capitaliste et mondialiste. La faune de nantis d’aujourd’hui se distingue en ce qu’elle est constituée différemment : si désormais, ce sont les richesses financières qui gouvernent le monde, à l’époque, c’était encore (avant que la Première Guerre mondiale massacre tout ce petit monde) les notables de grandes familles (avocats, banquiers ou médecins) et surtout les aristocrates.
Seuls deux chapitres présentent un réel enjeu dramatique, une confrontation entre deux personnages et une péripétie fâcheuse.
La première concerne la demande en mariage ratée du médecin. Cette scène est peut-être une des seules du roman d’ailleurs à pouvoir faire écho aujourd’hui (le type insiste lourdement, la demoiselle, à peine vingt ans, reste ferme et n’hésite pas à se faire plus directe quand le bonhomme, censé être un orateur brillant, revient à la charge comme un enfant de quatre ans n’ayant pas encore compris le principe des limites posées).
La seconde consiste à détruire les rêves d’assagissement et de rédemption du jeune militaire : rentrant au bercail après plusieurs semaines en mission, ayant résisté jusque-là à toutes les tentations pour honorer sa fiancée, cette dernière le surprend à l’aube en compagnie de ses deux amis noceurs et de deux femmes… Farrère évite le grand-guignol et le mélodrame en réduisant la dramatisation des événements importants au strict nécessaire et en se faisant plus lyrique (avec une touche de suspense) pour décrire tout ce qui encadre cet événement majeur représentant une sorte de bascule vers le vide pour le militaire.
Dommage de ne pas avoir su créer dès le départ un récit autour de cette déchéance. Les fables sont faites pour ne durer qu’un instant, pas sûr que ce soit adapté à un roman. Si bien que la première moitié du récit donne comme envie de vomir.