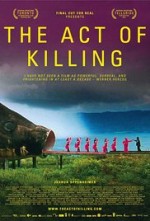La Commune (Paris, 1871)

La proposition de départ, celle de mettre en place un dispositif ouvertement distancié et anachronique avec un récit articulé autour de deux médias télévisuels (une télévision d’État nationale basée à Versailles et une autre gérée par les communards), offre pas mal de possibilités pédagogiques. Comme souvent avec des méthodes qui suivent les principes de la distanciation, le dispositif permet paradoxalement (et dans certaines limites) de s’identifier plus facilement aux situations rapportées.
Après, curieusement, je dois dire que le résultat est assez contrasté. En ce qui concerne les acteurs non professionnels, le réalisateur leur a, semble-t-il, laissé de grandes libertés afin qu’ils puissent s’approprier leur personnage et cela a pour conséquence un phrasé parfois improvisé, certes rempli d’anachronisme, mais fluide et sincère.
La mise en abîme, quand elle est volontaire, passe encore, seulement, la critique faite à la Commune, qui serait sous chaos permanent avec ses discussions sans fin, finit par devenir une critique légitime adressée au film. Une actrice propose d’ailleurs un regard étrange sur leur propre travail : dès que la caméra se pointait devant eux, le discours prenait toujours le pas sur l’action.
Quoi faire alors d’autre quand les moyens nous manquent ? Ce sont les limites d’un documentaire qui fait le pari d’illustrer un sujet en mettant en scène les acteurs d’une page de notre histoire. C’est le choix de la reconstitution fictionnelle (même avec tout son dispositif de distanciation) face à d’autres possibilités : diverses interviews d’historiens évoquant les événements, une voix off omnisciente, extérieure aux faits, collant son récit sur des images figées, des animations ou des objets d’époque filmés dans la nôtre, etc.
Cette critique méta réapparaît quand des intervenants viennent à interroger la logique d’un tel média (le leur, la télévision de la Commune) en ne fournissant aux spectateurs que des témoignages. Sur deux ou trois heures, ça fait sans doute sens. Sur deux fois plus, ça devient un peu lassant et vain. Le dispositif finit par éclipser son sujet et l’on se tient finalement toujours trop éloigné du fait historique. La volonté de coller ainsi au plus près à la réalité reconstituée d’un événement, on en vient, sans doute un peu comme les communards de l’époque, à ne pas savoir ce qui se trame au-delà du quartier, derrière la barricade…
Ce n’est pas toujours les panneaux indicatifs qui donneront beaucoup plus d’informations d’ailleurs, surtout quand les anachronismes volontaires s’accummulent.
Mais soit, le spectateur assiste à une reconstitution, une sorte de happening baroque, un pas de côté au milieu de nombreux documentaires (académiques) produits chaque année, pas un documentaire historique. Et les expériences, c’est souvent nécessaire dans l’art, ne serait-ce que pour montrer qu’une proposition ne marche pas. Pour voir le sujet de la Commune traité de manière plus conventionnelle, il faudrait plutôt plus se reporter vers Les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssan (qui n’est pas totalement historique d’ailleurs : de mémoire, il s’appuie sur un témoignage d’époque).
Regrettons toutefois que la proposition du film (on peut a priori suspecter Watkins d’être favorable aux communards) se révèle en fait extrêmement critique à leur égard. On aurait attendu que soit plus, ou mieux, exposées certaines des expérimentations éphémères et démocratiques de la Commune. Or, chaque fois qu’une décision est prise, il semblerait qu’elle ne puisse jamais être appliquée à cause du bordel constant. C’est là, quand on se met à douter de la vérité historique de ce que le dispositif nous met sous les yeux, que l’on aimerait que le documentaire soit moins baroque et plus historique, objectif.
Au lieu d’aller dans ce sens au moment où le dispositif commence à nous épuiser, Watkins préfère au contraire insister sur la comparaison entre 1871 et 1999. Tous les acteurs militants parlent très bien, eh bien, d’accord, mais ça en dit surtout plus sur leur époque (vingt ans après, on voit des termes comme « mondialisation » ou « internet » apparaître et rarement être mis en rapport, alors que l’un accentuera l’autre, et que le rapport péjoratif de l’un viendra s’appliquer plus à l’autre…), et surtout, moi, ça me perd totalement avec ma volonté de voir un peu mieux la Commune illustrée dans un film. On ne voit jamais le film qu’on voudrait voir.
La Commune (Paris, 1871), Peter Watkins 2000 | 13 Productions, La Sept-Arte, Le Musée d’Orsay
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel











 Année : 1960
Année : 1960

 Année :
Année : 




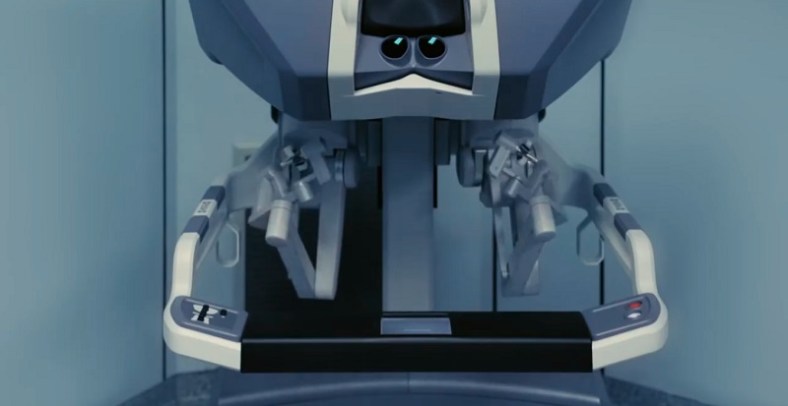
 Année : 2012
Année : 2012