C’est le machin le plus éprouvant et le plus abracadabrantesque que j’ai vu depuis Paradise Lost. Les complots existent, en voilà un beau. La filouterie des notables qui cherchent à se disculper (au moins de leur incompétence) et accuser les pauvres est sans limites. Le Dossier Adams nous en avait déjà donné un aperçu il y a bien longtemps… L’Amérique semble toujours aussi fâchée avec son système policier et judiciaire.
Je serais curieux de savoir combien parmi les spectateurs de la première saison ont vu la saison 2. Ces procès au long cours, avec des rebondissements à chaque « épisode », n’en finissent malheureusement jamais. L’avantage pour moi sans doute d’être arrivé après plus tard (et l’évidence qu’une fois la troisième saison diffusée, je serai alors le dernier au courant…). C’est au moins ce qui distingue la série des deux films Paradise Lost, plus facile à voir (moins longs), car sur bien des points, on remarque d’étonnantes similarités : aveux forcés d’adolescents influençables et en marge, coins perdus des États-Unis avec des sociétés resserrées où tout le monde se connaît et où la majorité désigne une minorité supposée problématique, les témoins impliqués et volontaires qui se révèlent être les principaux suspects, etc. D’un côté comme de l’autre, les accusés à tort se trouvent être pauvres et blancs, je n’ose même pas imaginer le nombre de situations analogues dans un contexte de communautés blanches pointant du doigt de parfaits accusés noirs… (Dans Un coupable idéal, il était question d’un adolescent noir dans mon souvenir.)
Je n’aime pas trop la personnalité de l’avocate de la seconde saison qui se montre trop rentre-dedans et prompte à faire des leçons de morale ou de compétences (en particulier envers les deux premiers avocats de Steven). Mais elle a sorti l’artillerie lourde pour disculper son client : elle fait intervenir des experts auxquels ses confrères n’avaient pas jugé bon de faire appel, sans doute faute de moyens, et est entourée de jeunes associés travaillant pour elle. Si l’on admet sans peine la mauvaise fois des flics et des juges corrompus, voire fautifs (travail bâclé, violation du droit des accusés, dissimulation de preuves et de témoins, acharnement, non-respect du principe de conflits d’intérêts auquel ils étaient tenus, etc.), on ne peut pas mettre en cause systématiquement comme elle le fait la compétence des premiers avocats (sauf celui de Brendan qui lui a de toute évidence œuvré pour faire condamner son client…). S’ils ont été dupés ou si les dés étaient pipés d’avance, ils ne pouvaient pas le prévoir.


Dans ce type d’affaires, et c’est compréhensible, les familles des victimes réagissent souvent de la même manière : elles s’attachent à la culpabilité de l’accusé qui leur est livré par les autorités et se refusent à laisser là moindre place aux doutes lors des procès. Premier suspect, toujours coupable. Il est probable que comme pour une partie des juges, l’investissement intellectuel et émotionnel nécessaire à une remise en question de ses convictions (qu’il faut pour reconnaître qu’on s’est trompé malgré tous les faisceaux d’indices allant dans ce sens) soit trop lourd à assumer pour des familles qui doivent déjà affronter la douleur de la perte d’un être cher. La charge sera d’autant plus forte que l’investissement initial pour identifier un coupable est long et laborieux, surtout quand on est en position de victimes et qu’une administration policière et judiciaire facilite votre deuil et atténue vos chagrins en vous désignant un coupable idéal. Pas difficile à comprendre qu’on en vienne ainsi si facilement à persister dans une conviction première pour éviter de perdre la face ou de se trouver à nouveau dans l’inconfort de ne pas savoir qui est la cause de ses souffrances… On voit se manifester ce même type de réflexes ou de facilités intellectuelles malheureusement de nos jours avec la pandémie et un personnage comme Raoult qui pensait disposer d’un remède à la Covid-19 (une certitude facilitée par toute la mauvaise science qu’on l’avait déjà laissé pratiquer depuis des années sans réelles sanctions) et qui a traîné derrière lui des bandes de fous furieux prêts à croire ses conneries… Identifier un faux coupable semble être, en certaines situations, préférable à ne pas avoir de coupable du tout.
Notons qu’aucune contre-enquête, contre-expertise ou contradiction n’aurait pu être faite sans la masse de documents, en particulier les interrogatoires vidéos, produite durant l’enquête et les différents procès. Dans une dictature, on ne s’encombrerait sans doute pas autant d’une telle paperasse, et l’on ne pourrait ainsi jamais proposer un tel spectacle d’une démocratie prise en flagrant délit de déni de ses valeurs. Les pièces à conviction, on peut les manipuler, mais on peut également trouver des traces de ces manipulations. Les outils sont adaptés, mais on ne lutte pas contre des notables mis en cause, de mauvaise foi et prêts à tout pour que les leurs, leur service, leur chef, leur institution, leur « communauté », leur État, ne soient jamais éclaboussés par les agissements de l’un d’entre eux. En voulant en protéger quelques-uns, ils finissent tous par devenir complices. C’est bien pourquoi là-bas comme en France, il est si important que dans le cadre d’une enquête, d’un contrôle de routine, tout soit consigné et que les vidéos soient largement utilisées. On peut difficilement falsifier la nature musclée d’un interrogatoire, les fausses promesses de remises en liberté, les menaces, les intimidations, le harcèlement de questions, etc. Et il est également essentiel que ces pièces deviennent publiques (même si l’on peut interroger la pertinence de rendre public le contenu d’un disque dur qui contient des vidéos à caractère pornographique « déviant »… — j’ai du mal à comprendre en revanche comment un témoin, s’il est avéré qu’il disposait de vidéos pédophiles, peut s’en tirer à si bon compte).
Peut-être que dans un avenir proche (ou même cela était-il déjà possible), les possibilités de l’OSINT (les recherches en sources ouvertes), de l’imagerie ou de l’intelligence artificielle donneront accès à des informations qu’on n’imaginait pas il y a encore quelques années. Je pense notamment aux images satellites. Ces images, librement disponibles par tous, pourraient dans un cas similaire et avec un peu de chance donner des informations sur l’emplacement et les créneaux horaires durant lesquelles le véhicule de la victime aurait été déplacé. Les images satellites ne sont pas continues, mais d’après ce que j’ai compris on peut disposer au moins d’une image par jour de n’importe quel terrain : si le 4×4 de la victime avait été placé sur un autre terrain adjacent à celui des Avery, des technologies adaptées auraient pu livrer des informations précieuses aux enquêteurs (quels qu’ils soient)…


Dernier point fascinant relevé par le documentaire : le décryptage du comportement psychologique des uns et des autres, qu’ils soient suspects puis accusés, témoins ou policiers. Ces derniers disposeraient d’une sorte de manuel les aidant à interpréter les gestes, l’attitude générale et particulière, les expressions faciales des personnes qu’ils interrogent afin d’identifier ceux qui auraient quelque chose à dissimuler. Manifestement, soit ils prennent mal en compte ce qui est spécifié dans ce manuel (en particulier concernant les mises en garde faites concernant l’interprétation ou les méthodes d’interrogation des mineurs, des personnes isolées ou déficientes mentales), soit le manuel est mal fichu. On le voyait dans une autre série mettant en scène cette fois les débuts des recherches du profilage, Manhunt : il faut du temps pour mettre en œuvre des outils fiables utilisables par les enquêteurs. Et si l’on peut imaginer, une fois que « la science de l’interrogatoire » aura fait ses preuves, qu’il y ait des spécialistes (fédéraux sans doute pour ce qui est des États-Unis) capables de former les policiers sur le terrain et d’identifier par conséquent des méthodes d’interrogation indiscutablement problématiques, encore faut-il que ces pratiques soient mises en œuvre par les procureurs une fois que des litiges sur de tels interrogatoires apparaissent. On peut douter que cette expertise quand elle existe soit toujours fiable dans les grandes villes, alors dans les petites n’en parlons pas. La bonne vieille technique du shérif censé protéger « sa communauté » des intrus ou des éléments en marge fera tout autant l’affaire… La « communauté » en question est souvent un cache-nez pour évoquer en réalité soit un boss (période western), soit une institution, soit les notables de la ville ; en tout cas, il est presque toujours question d’une confusion entre « maintien de l’ordre public » et « maintien de l’ordre des choses ».
D’ailleurs, dans un objectif éducatif, pourquoi ne pas se faire aider d’acteurs à qui l’on demanderait de jouer des situations où ils seraient censés dissimuler des émotions, des informations, une culpabilité factice, etc. Précisément, les techniques de jeu stanislavskiennes, très populaires sur le continent américain, sont censées construire des personnages intérieurement, jouer sur leurs motivations, leurs émotions refoulées, etc. C’est toujours facile de le dire après, mais quand on regarde la série, après-coup peut-être, on peut déceler dans le comportement des uns et des autres des indices pouvant laisser penser qu’ils cachent quelque chose, mentent, ou au contraire se montrent invariablement sincères et au-dessus de tout soupçon. Les menteurs ou les escrocs sont parfois identifiables par leur aplomb, l’assurance avec laquelle ils affirment les choses (l’aphorisme « la présomption d’innocence ne s’applique qu’aux innocents » m’a tué), un recours permanent à l’évocation des victimes pour justifier certains agissements (fausse empathie et appel à l’émotion), un certain excès de confiance, une forme d’arrogance à peine contenue aussi, une foi chevillée au corps, et une volonté généreuse de leur part (sic) de se présenter aux yeux des autres comme un chevalier blanc, un donneur de leçons (pas un redresseur de torts, plutôt dans le genre « pasteur qui enfonce les portes ouvertes et qui resserre les liens de la communauté »), ou comme un prince magnanime (en tête à tête : recours aux fausses promesses, dévalorisation des personnes isolées et fragiles ; en public : prétention à être celui disposant de la vérité, du savoir, du pouvoir de juger, à être le gardien des institutions et de la vertu ou le devin en capacité d’assurer au public de la suite des événements — allant, forcément, toujours dans son sens).
On trouve un peu de tout ça tout au long de la série. Chez le procureur Kratz, d’ailleurs, comme parfois les personnes en excès de confiance, il se fera prendre une fois qu’il aura un peu trop flirté avec la ligne rouge (chopé pour des sextos). Les policiers sont fourbes et semblent bien profiter de leur statut de représentant de l’ordre (des choses donc). L’avocate-star de la seconde saison possède quelques-unes aussi de ces caractéristiques, mais au moins son mobile est évident. Bien sûr, elle est prétentieuse. B bien sûr, elle semble vouloir participer à la défense de Steven après le visionnage de la saison 1 et être fière de ses réussites passées. En revanche, on peut difficilement remettre en question son acharnement à défendre son client et elle paraît sincère quand elle explique les caractéristiques des personnes accusées à tort (ce qui illustrerait plutôt un réel sens éthique et de l’empathie). La différence de comportement est également palpable entre les deux premiers avocats de Steven (l’un d’eux répète plusieurs fois sa désolation de voir les conséquences humaines, voire politiques, d’un tel acharnement judiciaire) et celui désigné d’office de Brendan (ses ricanements en disent long sur l’intérêt qu’il porte au sort de son « client »).
À l’image des personnages de Paradise Lost que l’on aperçoit d’abord en arrière-plan et qui prennent de plus en plus d’épaisseur à mesure que les regards se tournent vers eux, les comportements de quelques « témoins » interrogent. À défaut de pouvoir les « confondre » pour en faire des coupables, leur comportement devrait au moins donner lieu à des interrogatoires et à des perquisitions (d’autant plus que c’est rappelé, dans les histoires de meurtres, les proches sont plus volontiers impliqués). Un ancien petit ami qui lance les recherches (là encore, dans Manhunt, il est noté que les meurtriers aiment à s’impliquer dans les recherches… tant qu’ils ne sont pas eux-mêmes suspectés) et qui a accès à la boîte vocale de son ex (?!). Un neveu qui met en cause le principal accusé qui n’est autre que son oncle (oncle qui s’apprêtait à lancer un procès contre l’État afin de récupérer des compensations financières après ses années passées pour un premier crime dont il a été innocenté — possible jalousie), qui possède des vidéos violentes sur son ordinateur, et que son oncle relève innocemment qu’il l’a vu aussitôt partir après le départ de la victime. Le beau-frère de Steven qui est également utilisé comme témoin par l’accusation contre lui, souvent en retrait quand sa femme ou ses beaux-parents expriment leur rage, leur obstination ou leur incompréhension face aux injustices dont Steven et Brendan sont victimes (il est moins proche des deux, mais cette retenue pourrait au moins interroger — elle cesse d’ailleurs quand Steven fait savoir à sa sœur que son avocate le suspecte, et qu’il lui dit ses quatre vérités dans un échange houleux au téléphone : ce qui n’est pas pour autant une preuve de culpabilité). Le policier qui semble manifestement avoir servi de fusible en ne relayant pas certaines informations capitales et qui se décompose à la barre quand il est appelé en tant que témoin (attitude plus du type qui sait qu’il a merdé pour protéger les gros poissons ou des amis, plus que du menteur invétéré plein d’assurance, volubile, à la limite de l’arrogance et de l’insolence). Cela fait beaucoup de suspects potentiels.

Et à côté de ça, la spontanéité enjouée ou dépassée d’un Steven criant son innocence, et le malaise constant d’un Brendan parlant à ses chaussettes (et non pas spécifique une fois mis en difficulté), qui laissent assez peu de place au doute quant à leur implication dans le meurtre dont ils sont accusés. Rien ne peut l’écarter, mais leur comportement est bien plus celui de victimes harcelées, limitées, démunies et sans défense que de manipulateurs. On remarquera par ailleurs, pour en finir avec des « profils de meurtrier », que Steven et son neveu sont à l’exact opposé des hommes à la masculinité toxique, violents, manipulateurs, pleins d’assurance qui sont habituellement les hommes qui s’en prennent aux femmes… D’aucuns pourraient dire qu’on voit tout une bande de masculinistes s’arranger pour faire condamner des types de profils à l’opposé des leurs : Steven s’en est pris à un animal et avait pleinement reconnu ses torts (jamais à des femmes, mais avoir été si longtemps accusé de viol vous fait passer pour un coupable idéal), Brendan n’a jamais fait de mal à une mouche. On ne peut pas en dire autant de ceux qui les pointent du doigt (s’ils étaient honnêtes, les enquêteurs auraient fait des recherches sur le comportement de Bobby avec les femmes après avoir trouvé des vidéos compromettantes chez lui, mais comme ces mêmes enquêteurs sont précisément des hommes toxiques, des dominants, ils recherchent prioritairement des hommes fragiles pour mieux pouvoir faire valoir sur eux leur domination ; certains auront par ailleurs des comportements qui devraient dans un autre cadre alerter sur leur profil : le procureur devra donc faire face à un scandale de sextos — envers des profils de femmes fragiles, ça rappelle quelqu’un —, et d’autres ont fait pression sur la médecin légiste pour qu’elle n’intervienne pas dans l’affaire, lui faisant subir des pressions telles qu’elle dira plus tard se sentir obligée de démissionner).
Une troisième saison nous en dira peut-être plus. Aux dernières nouvelles, l’avocate fait savoir qu’elles disposent de pièces incriminant, semble-t-il, celui déjà qu’elle pointait du doigt dans la saison 2 : Bobby, le frère de Brendan et neveu de Steven (avec un motif de crime sexuel si je comprends ce qu’elle en dit sur son compte Twitter).
Deux mots tout de même sur la forme de la série. On peut souvent craindre le pire quand il est question de documentaire à la sauce américaine. On n’échappe pas aux effets de mise en scène, certes, mais ils me semblent moins omniprésents que dans d’autres documentaires, et surtout, le sujet est tellement prenant et révoltant qu’on n’y prête plus réellement attention. Il serait d’ailleurs judicieux de comparer la légitimité d’employer de tels procédés quand il est question de mettre en lumière un acharnement judiciaire, des institutions manifestement corrompues ou pour le moins malades ou des victimes innocentes passant la majorité de leur vie en prison, et quand il est question d’enfoncer les portes ouvertes en documentant la vie d’une victime (Dear Zachary).












































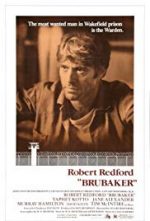 Année : 1980
Année : 1980





