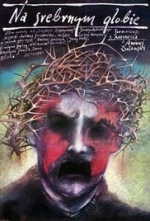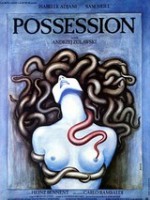Poupée de son

L’Art d’être aimé
Titre original : Jak byc kochana
Année : 1963
Réalisation : Wojciech Has
Avec : Barbara Krafftówna, Zbigniew Cybulski, Artur Mlodnicki, Wienczyslaw Glinski
— TOP FILMS —
L’art de la mise en scène de Wojciech Has
On est en 1963, et bientôt, ce type de mise en scène passera à… l’Has. C’est pourtant une manière de faire qui m’a toujours plus séduit que les méthodes de jeu jugées plus naturelles qui tendront à s’imposer par la suite. Il s’agit d’une mise en place particulièrement adaptée ou attachée dans l’imaginaire collectif au noir et blanc. En voici les deux caractéristiques principales : un jeu mécanique qui donne à voir à chaque seconde une expression ou un geste ; un centre unique d’attention ou dans le cas d’un plan large une recherche de cohérence dans les mouvements pour éviter la multiplication des centres d’attention et l’impression de chaos ou d’improvisation.
Comme ailleurs dans mes commentaires, à noter que dans mon vocabulaire, « mise en scène » se rapporte presque toujours à la direction d’acteurs, à leur mise en place (j’y intègre également, par principe les éléments que l’on nomme au théâtre « scénographie », autrement dit les accessoires et les décors). J’oppose ainsi tout ce qui est censé apparaître dans le champ (la mise en scène) ou dans l’univers diégétique du film (le hors-champ) à tout ce qui a trait à la technique d’appareils ou de montage (la réalisation). Je ne traite ici que de la mise en scène (j’évoque en fin de commentaire, brièvement, les mouvements de caméra).
Organisation du mouvement
Un jeu mécanique, précis et un centre d’attention unique, ces détails ne peuvent pas être décidés par les acteurs seuls. C’est une partition que le metteur en scène décide et organise seul. Les acteurs peuvent proposer des gestes, des expressions, des placements ou des mouvements lors des répétitions ou des prises, mais c’est bien celui qui dirige toute cette mise en place qui organise leur mise en œuvre, choisit de les adopter ou non, parce que c’est une question de coordination et de pertinence. Quand une mise en place est aussi précise, certains peuvent la trouver trop mécanique ou théâtrale, mais toujours, elle donne à voir et organise les choses (dont le récit, l’impression visuelle) afin qu’on ait l’impression que chaque chose est à sa place et paradoxalement s’organise naturellement.
Le réel est un chaos, on multiplie les gestes non signifiants, on se percute, on s’interrompt, on parle en même temps. On filmerait cette “nature” du réel qu’on n’y comprendrait pas grand-chose. Avec de l’improvisation (sauf quand elle est bien dirigée), les acteurs ont la mauvaise manie d’en faire trop, et ça devient vite une catastrophe. Même sans improvisation, en réalité, dans la plupart des films actuels, les acteurs sont laissés à leur sort : on s’assure qu’ils ont appris leur texte, le metteur en scène leur indique des positions, ils se mettent d’accord sur la situation, et basta. Tandis qu’avec d’autres cinéastes, comme au théâtre, on décide pour chaque seconde ce qui apparaîtrait dans le champ : gestes, regards, interactions, pauses, déplacements. En plus de donner une impression mécanique, il est assez simple de remarquer ce type de mise en scène travaillée : le jeu est décomposé, c’est-à-dire que les acteurs prennent soin de ne pas mélanger les répliques avec des gestes ou des expressions significatives. Les choses se font l’une après l’autre.
Les metteurs en scène choisissent au mieux parfois la place de la caméra, ils donnent des indications générales aux acteurs, mais très rarement dans les commentaires de film, on parle de ce qui parfois est l’essentiel : la mise en place. Vous ne verrez jamais des critiques faire l’éloge de la qualité d’une mise en place. Cela n’a jamais été leur sujet. Bonne ou mauvaise, riche ou pauvre, ils ne sauront pas faire la différence. Pourtant, c’est un savoir-faire qui apporte en réalité énormément à un film : elle permet de travailler sur le sous-texte, d’agrémenter sa mise en scène d’allusions, de regards en coin, d’expressions variées (souvent en réaction discrète et en contrepoint), d’améliorer la présence et l’autorité des acteurs à l’écran, etc.
Quelques exemples pris au hasard pour illustrer la nature de ces petits gestes, expressions ou mouvements qui ne sont pas le fruit du hasard ou de l’inspiration d’acteurs sur le moment.

Premier exemple
Au moment de nettoyer la table une fois que les officiers nazis et le collabo s’en vont après que leur voisin, l’acteur de théâtre, leur a manqué de respect, la serveuse, le personnage principal du film, rend au collabo discrètement ses gants et son étui à cigarettes. Elle ne le regarde pas, mais son regard se pose ostensiblement ailleurs. C’est le signe que c’est un geste délibéré pour insister sur la tension et la nécessité de faire attention à ce qu’on fait en présence des occupants. C’est plein cadre, on ne voit que ça au moment où l’actrice est face à la caméra alors que les autres se retirent à l’arrière-plan et qu’elle leur tourne le dos. Il n’y a rien de naturel ou d’improvisé : elle fait un geste à la fois, une expression à la fois, et dans ce genre de direction d’acteurs, on donne à voir à chaque instant. Le metteur en scène ne décide pas forcément de toutes les nuances d’expression que les acteurs apportent à leur jeu, mais un geste comme celui-ci peut difficilement être improvisé (même si l’imprévu n’est pas rare non plus ; on en voit d’ailleurs un exemple, puisqu’il s’agit d’une histoire d’acteurs, plus tard dans le film lors de la séquence radiophonique durant laquelle l’actrice surprend son partenaire obligé de s’adapter à ses improvisations).
La mise en place, la direction d’acteurs, disons, volontaire, souvent, ça donne cette impression de jeu mécanique : tac, tac. Une mise en scène précise, structurée, significative (elle donne à voir), et que d’aucuns qualifieraient de “théâtrale”. Quand on écrit un récit (ou une critique de film), on fait ça proprement, on structure les événements, on décide quoi montrer, on dévoile les choses les unes après les autres. La mise en place au cinéma, certains cinéastes savent ou préfèrent faire pareil. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne maîtrisent pas la mise en place et la direction d’acteurs feront systématiquement moins bien, disons en tout cas que ceux qui connaissent cette manière de faire auront souvent ma préférence. Trop souvent, on insiste beaucoup chez les commentateurs de films sur l’aspect formel de la réalisation quand cela concerne la caméra (les mouvements d’appareil, les angles de vue, le montage) et presque jamais sur la mise en place et la direction d’acteurs. Je ne m’expliquerai jamais ce tropisme. Méconnaissance, préférence, désintérêt ?
Deuxième exemple
Dans la même séquence ou un peu plus tard, un soldat nazi prend un homme par le col pour le rejeter un peu plus loin. C’est un geste en arrière-plan, au même moment, bien autre chose se passe dans le champ. Pourquoi est-ce significatif ? D’abord, parce que ça illustre à mon sens pas mal la situation : les soldats sont menaçants et n’hésitent pas à user de violence sur la population. Surtout, aucun figurant n’oserait prendre l’initiative d’un tel geste, seul. Il arrive que des metteurs en scène décrivent à des foules d’acteurs et de figurants une situation et leur demandent d’agir en conséquence, mais le résultat est presque toujours chaotique avec des imprévus rarement allant dans le sens de la situation que l’on voudrait voir se développer dans le champ. C’est donc, là encore, le signe que c’est une indication du cinéaste à un figurant pour donner à voir à ce moment-là. Le geste est répété au préalable : les acteurs savent où commence le mouvement, où ils doivent finir et ce qu’ils font par la suite. Une telle mise en place réclame toujours des heures de travail. Parce qu’il ne faut pas croire que metteur en scène et acteurs trouvent tout de suite le geste qu’il faut… Bien sûr, en voyant le résultat, tout paraît naturel, peut-être un peu mécanique, mais en réalité ce sont des heures de répétitions et de travail en amont. C’est justement parce que ça paraît simple que ça prend du temps à coordonner. Et je serais prêt à parier qu’aujourd’hui encore plus, la majorité des cinéastes dédaignent ce travail de mise en place, par choix ou par méconnaissance. Un cinéaste donnerait des indications à ses acteurs principaux et un assistant-réalisateur (ou je ne sais qui) en donnerait d’autres, d’ordre général, aux figurants. Avec un résultat, je l’ai dit souvent chaotique : certains proposent des mouvements au même moment, on se percute, d’autres figurants restent au contraire parfaitement statiques et semblent assister en spectateur à la scène, bref, on tâche de faire comme dans la réalité, on y retrouve certes son aspect chaotique, mais non, l’improvisation mal dirigée, cela a ses spécificités, et dans les séquences avec des figurants appelés sur le tard, on voit vite qu’ils se sentent comme des potiches au milieu des acteurs professionnels. Je le répète : combien de cinéastes avant de réaliser leur premier film ont déjà travaillé avec des acteurs ?
Voilà pour ces quelques détails. Inutile d’en faire plus : ce sont deux exemples, en réalité, chaque seconde du film pourrait illustrer ce que je veux dire.

Réalisation
Pour le reste, Wojciech Has n’en est pas encore aux grandes reconstitutions ou aux décors extravagants de La Poupée ou de La Clepsydre. On serait plus dans une forme de classicisme très cadré de cinéma d’intérieurs comme pouvait l’être Le Nœud coulant. Le talent de Has, il est de parvenir en très peu de plans extérieurs à nous restituer le contexte de la guerre dans une ville polonaise occupée, puis libérée. Les jeux de raccords avec les fenêtres sont ainsi primordiaux. Les fenêtres (une fenêtre en particulier) jouent même un rôle crucial dans le récit et dans la symbolique de la mise en scène de Wojciech Has : le premier plan en flashback nous montre presque brusquement l’une de ces fenêtres, sans que l’on comprenne le sens de cette évocation brutale.
À la Ophuls, on voit le cinéaste polonais déjà habile à suivre ses acteurs avec des travellings d’accompagnement. Rien encore de tape-à-l’œil : c’est propre, discret et efficace. L’idée est d’être toujours au plus près des acteurs tout en leur permettant d’évoluer dans un espace souvent limité par un décor d’intérieur et, si nécessaire, de les cadrer avec d’autres acteurs quand on peut y trouver des actions simultanées et qu’elles se répondent. Montrer ainsi le personnage principal en regarder d’autres du coin de l’œil, dans le même cadre, cela permet de proposer rapidement un sous-texte, pas forcément essentiel, mais qui illustre bien une situation et l’atmosphère, baignant dans la nostalgie et la solitude, du film. Ça colle d’autant plus que le film est un long récit à la première personne, et que ça fait sens d’intégrer ce qui pourrait presque s’apparenter à des apartés silencieux ponctuant les longs flashbacks narratifs racontant les épisodes marquants de la vie de cette actrice pendant et après la guerre.
Les acteurs
Les acteurs sont parfaits. Dans un parfait rôle d’appoint, on remarque la présence d’une des figures majeures du cinéma d’après-guerre polonais, Zbigniew Cybulski, notamment dans les films de Wajda, et qui tournera avec Wojciech Has Le Manuscrit trouvé à Saragosse. Il disparaîtra relativement jeune, à 40 ans, percuté par un train. Destin opposé pour sa partenaire, Barbara Krafftówna, présente pratiquement dans tous les plans du film, et qui est décédée seulement l’année dernière à l’âge respectable de 93 ans. Cela semble être en tout cas ici son rôle le plus marquant de sa carrière. On peut difficilement rêver meilleur rôle. Son personnage s’apprêtait à jouer Ophélie, la guerre l’en a empêché. Et Ophélie n’est en effet jamais bien loin. L’actrice échappera à la folie et au reste, mais son cher Hamlet lui en fera d’autres…

L’histoire
Difficile de trouver meilleur rôle pour une actrice, car en plus de ces atouts formels, le film est parfaitement écrit et tragique comme il faut. Le personnage principal, une actrice, se rend à Paris en avion, et depuis son siège se remémore les épisodes marquants ayant fait de sa vie sentimentale un désert (le titre du film semble un poil ironique et désabusé). Elle apprendra vers la fin du film que lors du premier voyage en avion, on a coutume de dire que les passagers revoient leur vie défiler. Elle en sourit, car c’est précisément ce qu’elle a fait depuis une heure. Sa carrière d’actrice est donc interrompue par la guerre, et à la suite d’une brouille entre un acteur et un groupe de soldats dans le bar où elle travaille, elle propose à l’acteur de l’héberger chez elle pour lui permettre d’échapper à la police. Éprise de son ancien partenaire de jeu, elle le cache ainsi pendant toutes les années de guerre dans son appartement. Son amour est loin d’être réciproque. L’acteur lui fait comprendre qu’une fois la guerre finie, il filera vite hors de ce qui pour lui est une prison. Avant ça, de son côté, sa protectrice lui fait savoir qu’une rumeur sur sa mort circule dans la ville, et il a comme un pressentiment que ça ne présage rien de bon.
L’un des premiers tournants tragiques du film, c’est quand deux soldats viennent fouiller chez l’actrice et qu’ils en profitent pour la violer à tour de rôle. Pour ajouter à son malheur, quand elle court vers l’acteur caché sous des matelas, il est tellement mal au point qu’elle doit s’occuper de lui, et alors qu’elle pensait au moins trouver un peu de réconfort auprès de lui, que nenni, le bonhomme n’a probablement rien entendu. Double peine.
La guerre s’achève, mais les problèmes continuent. Comme il l’avait promis, l’acteur fuit sans demander son reste (puisqu’on était dans les détails de mise en scène, en voilà un autre : il pensait s’échapper en profitant de l’absence de sa protectrice, mais elle le trouve à temps juste avant son départ en train d’emballer tel un voleur un gros morceau de saucisson…). On a connu mieux comme remerciements. Et puis, comble de la déveine, à l’image de ce qu’il se faisait en France dans l’immédiate après-guerre, les nouveaux maîtres des lieux règlent leur compte avec les collaborateurs. Comme pressenti plus tôt par l’acteur en entendant qu’on le pensait mort, personne n’a eu connaissance de leur situation : personne n’était au courant. D’un côté, on reproche à l’actrice d’avoir travaillé pour les Allemands (un ami lui reproche de ne pas se défendre en n’évoquant pas le fait qu’elle ait caché une personne recherchée, mais elle n’a aucune preuve), et de l’autre, on apprendra quelque temps après que l’acteur était suspecté d’avoir été de mèche avec la Gestapo parce que personne ne savait où il était passé pendant toutes ces années… Il y a un côté savoir-faire et faire savoir dans leur malheur commun : ils se sont tellement bien caché que personne n’était au courant et que personne ne peut désormais imaginer une telle histoire… Si vous êtes des héros, rappelez-vous que l’essentiel pour tirer profit de votre héroïsme, c’est d’en faire la publicité et de connaître les bonnes personnes pour raconter votre histoire… On a connu des acteurs plus habiles en la matière.
Bref, des années après, lui est devenu alcoolique, et puisqu’une femme amoureuse, c’est une femme un peu idiote, elle lui propose de revenir loger chez elle. Bien entendu, tout ne se passe pas comme elle l’aurait espéré. Faites sortir le malheur par la porte, il entrera par la fenêtre. Elle file ensuite pour la capitale et se fait remarquer dans une émission radiophonique qui lui vaut son succès. Pèsera sur elle toujours le regret de n’avoir jamais été en mesure de passer maître dans l’art d’être aimé…
La dernière image du film est bouleversante. L’hôtesse de l’air qui s’est un peu prise d’affection pour elle en la voyant enchaîner les verres de cognac lui propose un café : l’avion va atterrir, signe que le défilement de son passé prend fin. Regard dans le vague, regard perdu. Et malgré son émotion, elle cherche à faire bonne figure. L’image bouleversante d’une femme trahie par les hommes, souillée en silence pendant la guerre, accusée de ce qu’elle n’était pas, et qui ne rencontrera jamais l’amour d’un homme. Les hommes, ces lâches.
Grand film.
L’Art d’être aimé, Wojciech Has 1963 Jak byc kochana | WFF Wroclaw, ZRF Kamera
Liens externes :












 Cold War Zimna wojna, Pawel Pawlikowski 2018 Opus Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej, MK2 Films
Cold War Zimna wojna, Pawel Pawlikowski 2018 Opus Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej, MK2 Films
 Année : 1947
Année : 1947