
Si on suit les principes énoncés par Aristote, étant donné que le film traite de personnages « bas » et « laids », il ne s’agit pas de tragédie. Dans une perspective classique, ce serait donc plutôt une comédie, voire une satire. La terreur et la pitié sont réservées à la tragédie. La comédie, elle, est dans le ridicule, l’excès. On rit du laid, des bassesses des personnages, quand les personnages de la tragédie se distinguent au contraire par leurs qualités. Ce sont des héros, des demi-dieux, et ne sont pas responsables de leur destin souvent marqué par le sort. Le contraire des personnages bouffons et escrocs de la comédie. C’est une autre forme de catharsis. Au lieu d’avoir en pitié, on se moque et on montre du doigt les excès de la bassesse des hommes. Donc s’il faut trouver un lien entre Salò et les textes antiques, il faudrait plutôt regarder du côté d’Aristophane, voire de véritables satires (je n’en connais pas).
Le problème du film, à mon avis, et pour rester dans l’approche classique, c’est la distanciation. Je ne sais pas si Pasolini voulait proposer une sorte de comédie épique au public, un peu à la manière de l’Arturo Ui de Brecht, et donc s’il avait l’intention de suivre des préceptes de la distanciation du théoricien et dramaturge allemand, afin de forcer une analyse du fascisme. Le problème avec une telle fable grotesque, c’est que plus c’est gros et excessif, plus il va falloir en retour faire des efforts pour retourner cette distance prise naturellement avec des personnages aussi « pitoyables » (dans le sens moderne du terme) pour les rendre un minimum sympathiques, sans quoi le film est une torture (ce qu’il est, au sens cinéphile du terme). Même dans la distanciation, même dans le grotesque, même dans la dénonciation, il y a toujours une part d’identification : Arturo Ui, on le suit, on le regarde, pour ce qu’il est, un monstre.
Or, qu’est-ce qu’on ressent devant ces personnages excessifs et laids de Salò ? De l’amusement ? De la fascination ? Très peu. Surtout du dégoût. Et le dégoût produit peu ou pas d’analyse puisque la seule envie qu’on ressent devant un tel spectacle, c’est de détourner les yeux et de se pincer le nez. La catharsis, dans le théâtre antique, est un exutoire à la fois pour le héros et pour le public. Ce qu’on a ici est différent puisque l’exutoire des personnages est une sorte de happening coupé du public, qui se moque de lui, le terrorise et le dégoûte. C’est le même principe que pour les acteurs : s’ils n’arrivent pas à défendre et à aimer les personnages qu’ils représentent, la partie est presque toujours perdue. Même les personnages les plus grossiers, il faut arriver finalement à les rendre sympathiques, à les défendre, à leur laisser une part d’humanité. S’ils n’ont jamais de circonstances atténuantes, s’ils ne se retournent jamais, l’auteur ne fait que vomir sur la bassesse des hommes, et c’est un constat facile, un type de dénonciation qui provoque rarement l’intérêt ou le questionnement du spectateur (pour rester dans Brecht). Ce dernier n’a alors aucune raison d’adhérer à une histoire qui ne transcende pas le réel, car c’est le rôle de toute histoire de chercher à nous divertir ou à nous éduquer. (C’est peut-être ce que Pier Paolo Pasolini a essayé de faire au cours du film, mais j’avoue ne pas me rappeler. Il aurait sans doute fallu du génie pour rendre sympathiques, dans le sens « visibles », ces personnages. Et ici, « Triple Pet » en a manqué.)
L’un des premiers effets, parfois assumés, de la théorie de la distanciation, c’est l’ennui. C’est logique, si l’identification procure du plaisir, la distanciation s’en éloigne. Pour certains spectateurs, l’ennui va conditionner le rapport qu’ils ont avec le film : si le film est ennuyeux, il est mauvais. Si on utilise la distanciation, ce n’est pas toujours dans l’optique bien brechtienne d’analyser, ça peut faire partie paradoxalement d’une volonté de spectacle, mais où l’ennui agirait comme une fascination, un mystère, un peu comme un film mis en apnée.


Tonino Guerra a été, par exemple, scénariste d’Antonioni. Quand tu regardes L’avventura, tu suis comme dans Salò, un groupe de personnes, à la recherche d’une femme dans un lieu improbable. Tu t’ennuies, on est en plein dans la distanciation, mais tout vise à renforcer l’effet de mystère, d’incompréhension, sans doute pour exprimer une seule idée, l’incommunicabilité chère à Antonioni. Mais en dehors de ça, l’œuvre suit des principes d’une écriture parfaitement classique : un personnage disparaît, on le recherche et, comme dans toute quête, on y trouve autre chose. Tout le reste est dans la brume, mais c’est suffisant pour éveiller une certaine fascination. Le talent de Guerra et d’Antonioni fait le reste.
Le problème de Salò, au-delà du rejet de son sujet et de ces personnages « bas » « laids », je ne pense pas que ce soit tant que ça l’ennui. Le problème, c’est qu’on ne comprend pas l’idée de départ, l’événement qui déclenchera la quête et instillera une idée unique, mais indispensable capable d’instaurer pour plus tard un mystère, un mouvement, un désir chez les personnages (ce que j’appelais autrefois « action dramatique »). L’avventura, une femme disparaît, on la recherche. C’est simple et clair, c’est le reste qui est dans le brouillard. Mais pendant qu’Antonioni s’évertue à fondre le spectateur dans une « action d’ambiance » permanente, le spectateur ne perd jamais de vue cette première idée motrice de l’action, qui est la disparition. Même 2001, l’Odyssée de l’espace, le film le plus chiant de la terre s’appuie sur ce même principe : quelques événements symboliques et historiques, puis un départ d’exploration vers Jupiter. Voilà « l’action dramatique », clairement énoncée, Kubrick peut ensuite faire glisser son film dans une lenteur morte, désincarnée, et pourtant fascinante, faite seulement « d’actions d’ambiance », parce qu’on garde toujours à l’esprit ce spectre de la « destination ».
Ici, j’ai comme l’idée que Pasolini a voulu reprendre l’idée de départ de Buñuel pour L’Ange exterminateur où des bourgeois se réunissaient dans une maison et n’arrivaient plus à en sortir. Le film marchait parce que l’idée de départ était simple. Absurde, mais simple. Et comme pour L’avventura où il est inutile d’expliquer les raisons de la disparition de la femme, dans le Buñuel, il était inutile d’expliquer la raison du phénomène étrange interdisant les convives de quitter les lieux. Le respect de ces codes n’est qu’une clé pour permettre d’exprimer chez l’un son goût pour le surréalisme, l’absurde et la critique d’une société, chez l’autre, Antonioni, son goût pour l’impossibilité des êtres à se retrouver, se comprendre. L’idée n’est donc pas si éloignée de L’Ange exterminateur, mais ce n’est peut-être pas le dégoût le principal problème du film, et si ce n’est pas non plus l’ennui, ça ne peut être qu’une chose : une idée de départ trop confuse. Si même après avoir lu les explications de Pasolini, on n’a toujours pas compris où il venait en venir ici, c’est peut-être un peu aussi qu’il a voulu dire trop de choses, qui de toute façon restaient incompréhensibles pour le spectateur. Que Pasolini cherche à dénoncer, pousse à l’analyse ou provoque, dans tous les cas, c’est raté.
Reste qu’il peut toujours y avoir un « génie » qui m’échappe dans tout ça. Beaucoup y trouvent leur compte. Lire une œuvre, la comprendre, ça reste de toute façon une affaire personnelle. Il suffit d’être réceptif à une seule idée qu’elle nous ait été évoquée grâce au « génie » d’un cinéaste ou qu’on se soit fait notre film tout seul, pour que notre regard sur une œuvre soit chamboulé. Le même Pasolini a fait L’Évangile de saint Matthieu, et le film est plus appréciable. J’aime bien également Théorème. Quand tu joues avec les effets de distanciation, quelle que soit l’intention, tu prends le risque de ne pas être compris, d’être ennuyeux ou de paraître trop « élitiste ». Mais ça reste toujours une expérience qu’il faut vivre parce que parfois, elles peuvent arriver à évoquer en nous quelque chose. Toutefois, si Pasolini avait une démarche militante, politique, dans ses films, ça n’aurait aucun sens d’utiliser la distanciation. L’intention de Brecht était bien d’éveiller les consciences politiques des spectateurs, elle était en ce sens démocratique et didactique, mais si Pasolini cherchait à faire des œuvres communistes (et je n’ai aucune idée de ses intentions), c’est totalement raté. Ce serait même ironique, parce que l’ouvrier, le « peuple » quand il voit ce genre de films, la première chose qui lui vient à l’esprit, c’est « élite ». Pas celle qui apparaît à l’écran, mais celle à qui serait adressé ce film.
En rab : distanciation ou « élévation » dans L’Évangile selon saint Matthieu.
Oui, pas meilleure élévation que de regarder au ciel quand on fait caca au seuil d’une nouvelle religion. Sauf si on considère que le plus beau, c’est encore de savoir qu’après deux mille ans d’histoire, l’élévation se fera en sens inverse et portera les mêmes adorateurs à embrasser la même foi tout juste tombée à terre et à la manger ce qui en signera le crépuscule définitif. Ou temporaire. (Le problème avec la foi, c’est qu’une fois tous les siècles, il faut passer au cabinet pour s’en soulager. Et certains n’en démordent pas.)
Tout ça pour dire que, perso, c’est justement le caractère totalement profane d’un sujet éminemment religieux qui rend le film “beau” : n’en faire ni des prophètes ni des escrocs, mais peut-être tout bonnement des gens simples, c’est une manière de contrarier nos certitudes sur un sujet où a priori on part avec des idées déjà bien établies. C’est beau, parce que ça nous force alors à remâcher nos certitudes en permanence avant de les faire avaler aux autres. Chacun sa forme d’élévation.
Pasolini, je le vois comme un disciple de Brecht : il use de certains effets de distanciation pour porter à réfléchir, en particulier selon un prisme social. La plupart de ses directions d’acteurs fonctionnent avec ce même refus de l’identification, que ce soit en adoptant l’exagération jusqu’au grotesque, ou que ce soit dans le minimalisme comme ici. Ce qui peut être confondu (et c’est une confusion bienvenue, car elle peut faire sens pour certains) avec une représentation de la foi. Derrière L’Évangile selon saint Machin, reste toujours une dernière vision, celle qui reçoit la bonne parole et la traduit à sa convenance. « C’est selon », voilà ce qui pourrait presque être une définition de l’art, ce qui n’est pas vraiment en adéquation avec le principe de la religion où une vision unique est censée faire “foi” (ce qui ironique, vu que tous ces charmants garçons se sont contentés de proposer des reboots d’une vieille série de science-fiction).

 Année : 1952
Année : 1952

 Année : 1964
Année : 1964















 Année : 2016
Année : 2016


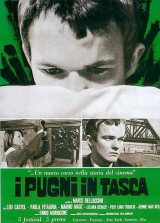 Année :
Année : 




 Année : 1967
Année : 1967






















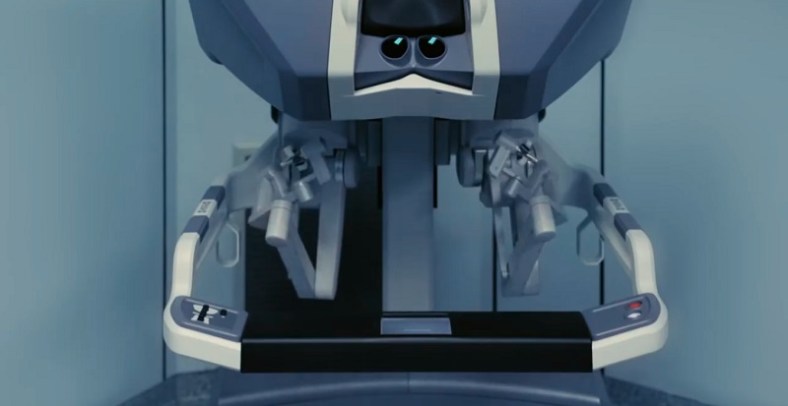
 Année : 2012
Année : 2012
