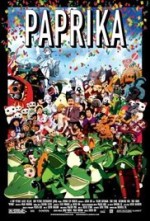Albator, corsaire de l’espace
Titre original : Kyaputen Hârokku
Année : 2013
Réalisation : Shinji Aramaki
Consternant. Je ne veux rien savoir du pourquoi du comment, mais on peut imaginer le scénario, on l’a déjà subi des centaines de fois. Un studio qui ne fait plus d’animation traditionnelle depuis belle lurette se lance dans le développement de technologies animées à la mode, et parce qu’un studio, c’est un peu comme un navire, s’il reste à quai, tout le monde est au chômage. Les cadres se mettent en quête d’un projet susceptible d’agiter le box-office… : tu regardes ce que tu as en catalogue, et tu décides d’adapter un classique déjà bien amoché à force de repasser dessus comme d’autres descendent dans leur cave pour violer la victime qu’ils ont enlevée il y a des années de ça. Pic et pic et choléra, c’est le tour de ce bon vieil Albator. Voilà donc le chef-d’œuvre de ma jeunesse (je suis né avec, j’ai littéralement appris à écrire sur une pochette de disque Albator, la musique et les images font partie de mes plus anciens souvenirs) pris en otage par de vulgaires branleurs dans un bureau qui, après un inventaire des fonds de tiroir et une étude d’impact, ont établi qu’un classique de l’animation, patrimoine mondial de la culture, jalon important de l’imaginaire collectif, pouvait être le vecteur idoine pour vendre de la soupe 3D.
Tu réunis des créateurs chargés de remodeler la chose au goût du jour, et tu leur expliques bien gentiment comment ça va se passer : « Ne vous préoccupez pas, le succès est garanti, le film n’est qu’un prétexte à montrer ce qu’on sait faire en matière d’animation. » On applaudit parce qu’on assure le travail de pas mal d’employés pour quelques années, on fait fuiter les premières informations après consultation du service marketing dont le budget dépasse largement celui de l’écriture, et même les fans semblent se réjouir parce qu’un fan, c’est presque aussi con qu’une figurine qui jette un fulguropoing à ressort quand on appuie sur un bouton. Tout se passe bien : continuons sur cette voie et suivons le plan.
Dix ans après, le film est achevé. Tout le monde a été payé. La campagne internationale de publicité porte ses premiers effets. À l’étranger, ces petits cons d’Occidentaux mordent à l’hameçon : la nostalgie est un capital, un veau d’or. Les premiers chiffres des sorties augurent du meilleur. On se frotte les mains. On rentre dans nos frais. Le studio va pouvoir lancer de nouveaux projets piqués à d’autres, même si nos équipes techniques ont pris du retard sur la 3D des concurrents. On a du fric à dépenser avec le succès du film et après les dividendes lâchés aux actionnaires, malgré les mauvaises critiques et la chute spectaculaire des entrées en deuxième semaine (la curiosité, le marketing et la nostalgie, ça limite toujours les catastrophes industrielles). On se tourne alors vers le département scénarios, on demande ce qu’ils ont en stock, on nous propose des trucs qui n’ont jamais été faits avant. Mais flûte, non, on va quand même pas prendre de risques. Manque de bol, on a adapté tous les mangas à la mode. Faut-il développer le secteur acquisition au détriment des soirées organisées dans une maison de thé pour les cadres et les clients ? Dilemme. Faut-il exhumer une nouvelle icône ? Et puis, on se tourne vers le département juridique, et on se résout à trouver un autre machin du patrimoine (même chez les autres) à prendre en otage et qui coûterait pas trop. Il faut remettre le personnel sur le pont, surtout le directeur technique 3D coréen qu’on vient de débaucher et qui va devoir superviser les équipes qui travaillent depuis trente ans sur Atari 6128.
Deux ans après, la maison mère du studio se délaisse de sa branche animation parce que tout le monde fait de la merde et parce que personne, parmi les publicitaires et les directeurs de chaîne, n’achète plus nos machins hideux écrits avec les pieds. Toe-i Animalcon.
Le capitalisme tue la création et vandalise le patrimoine.
Tout y passe. L’esprit mutique et androgyne du personnage passe à la trappe. L’humour (un peu lourd) qui faisait office de contrepoint n’est plus qu’un vieux souvenir. Les femmes sont hypersexualisées (désolé, l’original n’est peut-être pas un modèle, mais on n’y voit personne en string double bande) alors qu’elles avaient à l’origine un côté sainte-nitouche, évanescent, tout à fait charmant. On a de manière vulgaire forcé sur le high-tech en gommant le plus possible l’esthétique multicolore, presque claire, et en en faisant un univers brut, très masculin plein de cambouis et de vrombissements virilistes. La 3D, en plus d’entretenir une certaine idée de la laideur, pose un réel problème de la représentation des corps : si dans un dessin animé, les stéréotypes grossophobes (notamment) peuvent être atténués par le relatif caractère conceptuel des formes, avec des dessins qui recherchent le réalisme des contours, ces silhouettes féminines uniformément filiformes interrogent. Et surtout, qu’est-ce que c’est que ce scénario écrit en trois heures ? Quand dans une histoire qui se veut un peu épique, le tableau de tes péripéties s’étale sur à peine 48 heures, c’est qu’il y a un souci. J’en finis avec le plus risible et le nombre de revirements soudains des personnages qui tient plus de l’acrobatie que de la science de la narration.
Bref. Une catastrophe. Une honte. Un massacre.
Albator, le corsaire de l’espace, Shinji Aramaki 2013 Harlock Space Pirate | Tōei animation


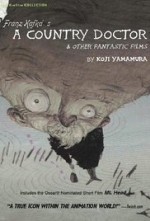
 Année : 2007
Année : 2007