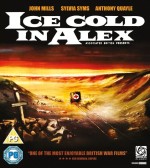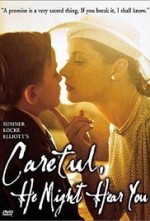Sur ce dernier point, le curseur a bien bifurqué vers le « plus », vu qu’en dehors des grandes lignes du récit, il semble bien périlleux d’y reconstituer un sens ou une logique d’ensemble (il est vrai que je dois être mauvais spectateur, incapable que je suis à faire le moindre effort ; surtout quand mon attention a autre chose à faire, un peu comme une femme qui rend visite à son nouvel amant, qui se laisse tripoter sans joie et dont l’attention s’arrête tout à coup sur les petits dessins figuratifs dessinés sur les rideaux de la chambre d’hôtel…).
Laissons donc l’histoire nous tripoter fugacement là où ça chatouille et portons notre attention sur ce qui ravit plutôt mes petits yeux de maîtresse insatisfaite…
D’abord, le récit, dont la structure en confettis vaut bien le détour. Parfois, on se contente d’une construction en tableaux, laissant le spectateur relier logiquement ce qui se perd dans l’ellipse ; seulement le procédé ici est moteur et central. Absurde ? Un peu. Essayons de reconstituer un univers, une chronologie, une logique dramatique, et l’on en sera incapable. Ne reste que des bribes, des impressions, des images, voire des sensations : certains plans tendent, semble-t-il, à jouer sur elles plus que sur une situation donnée, à la limite souvent du cinéma expérimental : les tours habituels du film narratif sont présents avec leurs personnages récurrents ou principaux (avec un même narrateur) ; la même tonalité, la quête d’un passé révolu qui s’étiole en bouche comme un œuf poché raté… ; il y aurait de quoi se sentir perdu, et l’on se demande, au fond, s’il vaut mieux ne rien chercher à comprendre (je me porte le premier volontaire pour y renoncer — on reconnaît les courageux). On pourrait certes prétendre réussir à tout reconstituer, c’est sûr que ça doit être fort amusant de lire les papiers mangés par la broyeuse, il paraît même que ce genre d’occupations étranges trouve un regain d’intérêt juste après Noël et que nos aïeux appelaient cela « puzzle »… Bref, on trouve des petits malins partout, je n’en suis pas et suis plutôt du genre à faire la tête le jour de Noël (du genre passé « dans la broyeuse » et ça dure jusqu’à la Saint-Cotillon, peut-être même que j’ai la tête déglinguée tout le reste de l’année aussi, alors devoir me cotillonner en plus de la mienne, la tête des autres, non merci), et… je sais plus ce que je disais.

Ellipse.
On note également dans la mise en scène, à l’échelle des séquences cette fois (si l’on peut appeler ça ainsi, puisqu’il s’agit tout au plus de poignées de confettis, de cuillerées de vermicelle, de moutons de poussière noyés dans la soupe…), un procédé presque systématique (donc remarquable) qui m’évoque toujours Partition inachevée pour piano mécanique. Pour éviter de devoir couper deux plans probablement fixes, Nikita Mikhalkov, imagine dans son film des panoramiques d’accompagnement qui permettent de passer d’un plan à un autre au cours d’une même prise. Le résultat frappe par son élégance, et c’est toujours amusant de remarquer, au début d’un plan, quelque chose qui ressemble dans sa composition à un plan fixe, et qui à travers un mouvement de caméra suit alors un personnage (le plus souvent) et finit sur ce qui aurait tout aussi bien pu être un autre plan. Le montage sans découpage, c’est magique. Eh ben, Zoltán Huszárik (je retranscris son nom de mémoire) procède un peu de la même manière, mais là encore pousse l’idée jusqu’aux limites de ses possibilités en reproduisant l’effet, parfois plusieurs fois dans le même plan, et… en s’autorisant des inserts de plans censés évoquer des souvenirs, des impressions (ou carrément en revenant à une scène antérieure ou en initiant une autre). Plusieurs fois, il commence par un gros plan (sur un visage de femme même), puis un autre personnage (le principal sans doute) s’immisce dans le cadre et la caméra s’adapte alors pour l’intégrer à l’image, le plus souvent en reculant et en opérant un léger panoramique d’ajustement. Et ainsi de suite. Parfois, c’est le contraire, on va profiter d’un mouvement pour nous approcher. Raccord dans l’axe, sans cut, c’est magique. Parce que le plus beau, c’est bien que ce soit censé être le plus transparent possible ; c’est bien l’intérêt d’un raccord (moi je vois tout, surtout les motifs décoratifs dans la chambre de mes amants).
Travelling narratif et montage sans coupage
Je reviens deux secondes sur les inserts parce que le film les multiplie. Il est de coutume dans un film narratif classique de limiter les inserts au strict nécessaire (l’insert apporte un détail significatif). L’abus d’inserts nuit à la cohérence narrative… Au contraire, quand il s’agit de plans de coupe et que le tout sert à illustrer une séquence dont la continuité reste perçue à travers la piste sonore (ou un retour à la scène en question), les risques d’abus sont mineurs. On n’est jamais avare en images quand il est question d’illustrer une situation (la différence entre un plan de coupe et un insert, au-delà de la durée, c’est surtout la nature de ce qui est montré : l’insert montrera plus volontiers des gros plans sur des objets ou des détails du corps quand le plan de coupe dévoilera le corps entier, voire des plans généraux, et les gros plans illustreront davantage des visages, des réactions). Sauf que Zoltán Huszárik utilise ces inserts non pas comme des plans de coupe, mais quasiment comme des images subliminales : il se fout pas mal que l’on y comprenne quelque chose (ou des détails). Il peut alors s’en permettre un usage intensif, toujours pertinent, car il est entendu qu’il ne fait que saupoudrer un peu plus la soupe de grumeaux que constitue déjà l’histoire avec un peu de fantaisie poétique, lyrique, ou impressionniste. Au lieu d’illustrer une situation, l’insert sert davantage ici à décrire le monde intérieur du personnage principal avec ce qui s’apparente à des souvenirs ou des flashs… Le procédé n’est pas nouveau, on connaît ça depuis l’avant-garde au temps du muet (on n’est pas loin aussi du montage des attractions de Eisenstein sauf que le réalisateur soviétique cherchait à optimiser un récit à la troisième personne, quand ici le procédé vise moins l’omniscience que la subjectivité cahotante d’un personnage unique), et les films en usant de cet effet (de manière moins systématique) sont nombreux, surtout depuis que Godard a fait recette avec ses menus décomposés. Je serai d’ailleurs toujours gaiement partant pour un petit plan de coupe qui montre une jolie Hongroise se roulant nue dans la neige (en terme technique, on parle « d’insert fruste », ou bien « plan-cul », mais je ne voudrais pas être trop ennuyeux avec ma Hongroise).
Inserts subliminaux
Autre procédé renforçant l’idée d’onirisme (ou de surréalisme) : le son postsynchronisé. Avec un découpage et un récit qui infuse sous la mare dans un ensemble que l’on croirait indigeste avant d’y goûter, on peut comprendre la crainte, ou la difficulté, en plus de cela, à devoir se farcir une piste sonore en prise directe. Le son en studio permet de maîtriser la température de cuisson, et surtout de servir de liant à tout cet enchevêtrement d’impressions fines. Mieux encore, comme on peut le voir dans Une histoire immortelle tourné trois ans plus tôt par Orson Welles, l’uniformité du son et l’absence d’arrière-fond permettent de renforcer l’impression d’étrangeté propre aux rêves (c’est ce qui faisait la saveur aussi de Derrick et continue sans doute de fasciner dans les divers soaps horrifiques et néanmoins matinaux). Mieux-plus-encore, ce recours à la postsynchronisation permet au cinéaste de mettre l’accent sur l’interprétation de ses acteurs d’une manière plutôt charmante puisqu’il leur demande presque pour chaque scène de chuchoter. Le début du film est en ce sens remarquable, car on entre à pas feutrés dans un monde en suivant (déjà) les errances du personnage à travers ses rencontres féminines ; un peu comme quand on s’immisce subrepticement, la nuit, dans la chambre de bébé pour s’assurer qu’il s’est bien endormi. De bébé en fait, ici, il serait plus question de souvenirs…
Quelques mots concernant cette direction d’acteurs. Je le dis et le redis, il y a le texte que l’acteur doit délivrer aussi simplement que possible à la connaissance du spectateur, et il y a le sous-texte, souvent plus important que les mots mêmes. L’un trahissant parfois les autres… Les mots doivent donner une première impression, le rythme, mais là où tout se passe (quand on sait bien s’y prendre), il est dans le jeu du corps, les attentions, le regard, toute une foule de détails qui doivent donner à voir et à réfléchir le spectateur, voire le partenaire. On parle parfois « d’imagination » pour un acteur capable de transmettre plus que les mots, et surtout arriver à se tenir à un sens (ou sous-entendu, allant « droit ») unique (ou évoluant légèrement au gré des détours dramatiques que peut offrir une même situation), et quand tous les acteurs offrent cette même rigueur, c’est plus certainement au metteur en scène à qui le crédit d’une telle réussite doit revenir. Les acteurs sont, par essence, assez bêtes et paresseux (comme la pensée), et prêteront toujours plus attention à ce qu’ils disent (priant pour que ça suffise au bonheur du directeur ou aux yeux du public) qu’à ce qu’ils montrent, ou à l’histoire qu’ils doivent écrire à travers ce sous-texte. Je peine donc à croire que tout ce petit monde arrive à jouer la même partition sans le génie d’un chef d’orchestre. J’ai évoqué Orson Welles plus haut qui n’avait pas peur de fabriquer une grande partie de sa « direction d’acteurs » en postproduction ; il avait une expérience de la radio et l’idée de montage sonore n’a chez lui jamais été le signe d’une perte de qualité du jeu de l’acteur (il comprenait qu’une partie de la partition se jouait à l’écran et que le son ne devait pas venir copier comme un écho ce qu’il y montrait…). Mais l’on pourrait tout aussi bien citer Visconti qui possédait le même génie pour mettre en scène des acteurs en leur faisant composer des personnages complexes, d’une main avec les mots, et de l’autre, avec les silences, le regard et le corps. Et ce n’est pas le tout de le savoir, l’exécution ici est toujours très juste.
Sindbad avance donc en quête de ses vieux souvenirs, et l’on erre avec lui, et on le fait peut-être un peu plus volontiers qu’on peut se mettre à rêver que les mêmes procédés servent un jour à une adaptation de Proust. Preuve que la tâche est peut-être insurmontable, Raoul Ruiz, qui était peut-être le cinéaste en France dont le style se rapprochait le plus de ce style tout en évocations, s’est complètement vautré. La difficulté de se porter à bonne distance de son sujet : quand on sert des acteurs au lieu de voir des acteurs servir une histoire, la focalisation se fait sur eux. Pas ce souci chez Zoltán Huszárik qui manie parfaitement à la fois les plans d’ensemble (dans lesquelles doit évoluer son héros, toujours à bonne distance) et les focales longues très utiles pour noyer la vision (du personnage principal) dans un flou permanent. Ce regard de myope, capable de voir défiler devant lui moult détails sans en comprendre forcément la nature ou l’origine, s’évertuant à en trouver le sens, à le recomposer (dans un bol de porcelaine rempli d’eau) pour y découvrir les images cohérentes avant leur émiettement confettique, c’est bien ce que l’on peut imaginer se rapprocher le plus d’une écriture proustienne au cinéma.
Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir.
Et comme dans ce jeu où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant… toutes mes conquêtes féminines, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et les maisons closes et tout Budapest et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, nuques et cheveux, de mon assiette de tafelspitz.
Sindbad, Zoltan Huszarik 1971 Szindbád | Mafilm