Plus de deux heures de films où on ne s’ennuie pas c’est déjà ça. Après, quand on y repense, on se demande ce qu’on a vu. Est-ce que c’est le film sur la culpabilité d’une Polonaise rescapée d’Auschwitz ? Ou est-ce le film sur un ménage à trois ? Franchement, on a de quoi être perdu. Un récit peut adopter plusieurs points de vue, utiliser plusieurs modes de lecture ; ça, ce n’est pas un problème. Ça peut servir dans certaines circonstances à mettre en évidence un point ; ça peut être une volonté de l’auteur de placer son histoire sous un angle précis pour lui donner un sens précis. Seulement là, le film ne sait clairement pas où il va.
Évidemment, je n’ai pas lu le livre, mais dans un roman, c’est plus facile. On peut faire deux paragraphes d’introduction et de conclusion pour encadrer le récit, on aura toujours cinq cents pages au milieu plus essentielles. Une introduction et un retour en conclusion du narrateur, ça peut mettre de la distance avec le sujet, lui donner un relief particulier. Dans le film en revanche, le point de vue du narrateur est presque trop envahissant. Tout l’art de la mise en scène c’est de trouver le ton juste, l’angle juste. Et là, plus le film avance, plus Pakula montre qu’il ne maîtrise rien.
D’après ce que j’ai compris et quelques recherches, l’auteur du livre voulait faire un parallèle entre l’Allemagne nazie et le sud raciste des États-Unis. Là, il y a un sens, seulement Pakula n’a pas respecté ça. Son film ne veut plus rien dire. Il reste les traces du parallèle original avec la présence de cet écrivain venu du Sud, mais on ne comprend pas pourquoi il est là et pourquoi tout le film tourne autour de lui… Il y a un gros malentendu dans l’histoire…

Le Choix de Sophie, Alan J. Pakula 1982 Sophie’s Choice | Incorporated Television Company (ITC), Keith Barish Productions
On commence donc le film avec le point de vue de ce narrateur, venant à Brooklyn pour écrire un roman et qui se lie d’amitié avec un couple : un juif new-yorkais et une Polonaise rescapée des camps. On continue tout du long avec le point de vue du narrateur. Pourtant, tout l’intérêt du film, tel qu’il est présenté par Pakula, est ailleurs : le couple, leurs secrets, etc. Ces deux personnages vivent leur passion folle et excentrique. Plus le récit avance, plus le personnage narrateur prend part à leur vie pour devenir plus qu’un ami. On frôle le ménage à trois. On sait que le couple est rongé par un démon, celui d’une culpabilité presque commune : l’un parce qu’il n’y a pas participé, l’autre parce qu’elle y a survécu. On apprend alors que lui a un cabinet secret où il recense les criminels nazis qui ont échappé à la justice (c’est sa manière à lui, en tant que juif qui n’a pas vécu l’horreur, de se racheter) ; la femme, elle, porte un secret, très lourd, qui la culpabilise, et qui va devenir peu à peu le centre de tout.
Tout allait bien jusqu’à ce que Pakula décide de faire de la culpabilité de la Polonaise son sujet principal. C’est comme s’il se désintéressait du reste (et pour cause). Il avait déjà occulté tout ce qui faisait référence dans le roman au Sud ségrégationniste, voilà maintenant qu’il décide de se désintéresser du personnage juif américain qui vit une culpabilité d’un autre genre, mais qui se rapporte aux mêmes événements. Je ne peux pas imaginer que dans le roman, l’auteur décide tout à coup de ne plus s’intéresser qu’à l’un de ces personnages. L’auteur du livre semblait vouloir appuyer sur le fait qu’il n’y avait pas que les juifs qui avaient souffert dans les camps. C’était une question délicate mais intéressante à développer dans le film. Bien sûr, on sait qu’elle est catholique, mais ce n’est pas traité comme un fait important. C’est juste anecdotique. Du coup, Pakula fait tout le contraire du roman qui voulait rétablir une vérité sur les « autres » victimes de cette catastrophe, en recentrant son histoire sur ce personnage rescapé des camps. Peu importe qu’elle soit juive ou catholique, fille de nazi, c’est juste présenté comme une ironie de l’histoire… Ce qui est important pour lui, c’est juste Sophie, et le « Choix de Sophie ». Plutôt futile et réducteur. À peine sérieux comme vision… Pakula a enlevé toute la force du parallèle initial, il fixe son regard sur la faute initiale sur quoi repose tout le récit. Il la dévoile sans fards et porte son attention plus que sur ça, alors que tout l’intérêt du récit aurait dû être les conséquences de cette « faute » dans sa nouvelle vie, sa culpabilité… C’est aussi indécent que de vouloir montrer une scène d’amour entre Œdipe et sa mère alors qu’il ne sait pas encore que c’est sa mère… Il faut laisser les choses à leur place : la faute initiale ne doit pas être mise en scène, mais être simplement évoquée.
Le cinéma rend parfois les choses plus faciles parce qu’il peut absolument tout montrer, mais le but c’est tout de même de savoir ce qu’il faut montrer. Il n’est pas question de bienséance comme par le passé, mais d’établir une logique et un équilibre narratif.


Il aurait pu peut-être commencer par cette histoire de ménage à trois, puis basculer peu à peu vers l’histoire dans les camps nazis (même si ce n’est probablement pas conforme à ce que semble décrire le bouquin). On peut faire glisser un sujet vers un autre, un peu pour tromper volontairement le spectateur, ou juste faire une entrée progressive vers le monde douloureux des camps et la culpabilité de Sophie. Parce que ce long flashback est fascinant. Le film prend une autre dimension en dévoilant en même temps les secrets de Sophie et sa véritable nature. À cet instant, on se dit que le reste avait juste pour but d’introduire cette histoire douloureuse. Ça permettait de mettre de la distance, de faire une comparaison entre présent et passé, en montrant les conséquences d’abord puis les causes d’un trouble. Mais Pakula ne revient pas à son sujet de départ avec ce narrateur qui s’immisce dans la vie de couple de ses voisins. Quand on revient dans ce petit immeuble typique de Brooklyn où Sophie a raconté son passé à son ami (le narrateur), et qu’on reprend le cours de l’histoire du « ménage à trois »…, et il y a comme un choc. On passe de la tragédie à ce qu’il y a de plus futile. Si l’auteur du livre voulait nous dire qu’il n’y avait pas que des victimes juives dans les camps, Pakula, semble nous dire qu’il n’y a pas que les tragédies comme celles des camps qui sont importantes, il y a aussi la tragédie des couples ou des ménages à trois…
Non seulement, on est perdu parce qu’on ne sait plus quel est le véritable sujet du film, mais on se sent trahi, parce qu’on tenait là un sujet fort et sur lequel on aurait dû rester. Si au moins on avait toujours été centré sur l’histoire du couple, le lien aurait peut-être pu être plus évident, plus équilibré (mais toujours non fidèle à l’œuvre originale). Mais non, il y a toujours ce nabot d’écrivain sudiste qui cherche à rentrer dans le lit conjugal. Pakula ne sait pas où il va, il tire des extraits du roman (les meilleurs sans doute), mais son anthologie des meilleures scènes du livre n’a plus aucun sens entre elles. Il ne prend même pas le parti pris d’être infidèle au roman et de fabriquer une œuvre qui lui serait propre, non il fait n’importe quoi. Il tombe sur une scène qui lui plaît, une anecdote du roman qui lui plaît (ou qui est spectaculaire), et il en fait des tonnes dessus. Il s’amuse avec ce qui lui tombe sous la main, mais il ne raconte pas une histoire dans son ensemble. Quand on revient à la réalité futile de Brooklyn, le film se résume à une vulgaire histoire de cul. C’est obscène quand on le compare à certains éléments du roman initial, particulièrement tragique.

Quand on revient une dernière fois dans cette scène du « choix de Sophie », qui explique le traumatisme du personnage (mais qui ne devrait pas être le sujet du film), ça paraît totalement hors de propos. La scène est déchirante, mais elle apparaît au milieu de nulle part, une confession lâchée à un pauvre type qui lui demande de partir avec elle et qui veut avoir des enfants avec elle. Tel que le met en scène Pakula, c’est-à-dire en en faisant une scène à part entière du film, et la pierre angulaire presque du récit, il y a comme une faute de goût énorme. Une telle scène, telle qu’elle l’a sans doute été imaginée dans le roman initial (et c’est une simple conjecture étant donné que je ne l’ai pas lu — et on sait jamais, peut-être que ça part également dans tous les sens sans savoir réellement où ça va), ne devait être qu’évoquée. Non pas mise en scène, mais racontée par le personnage, en confidence. D’ailleurs, le film termine sur une image arrêtée de Meryl Streep racontant cette histoire, preuve qu’avec le peu d’image qu’on a d’elle, ça nous a marqué, et que la simple évocation de l’événement suffisait à émouvoir. Et que ce qu’il fallait montrer à ce moment, parce que c’était le sujet du film, c’était le visage de l’actrice revivant cette scène en se la remémorant. Le sujet, c’est Sophie racontant son « choix », pas le choix en lui-même. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d’évocation d’un acteur face caméra ; les scènes les plus émouvantes sont parfois les plus simples. Il faut se souvenir de l’incroyable climax des retrouvailles dans Paris, Texas : tout est dit, rien n’est montré. Faire des flashbacks, même avec des scènes formidables, aurait été totalement hors de propos.
D’ailleurs, il est assez curieux de remarquer que Pakula, auteur de ce scénario mal fichu, a été le producteur Du silence et des ombres. Je ne sais pas à quel point il a été impliqué à l’époque dans le scénario de ce film, mais en tant que producteur, il ne pouvait en adaptant Le Choix de Sophie noter la similitude dans la mise en forme des sujets. Peut-être d’ailleurs était-ce là le problème…, peut-être aurait-il voulu reproduire une structure se rapprochant plus Du silence et des ombres que du livre qu’il adaptait… On y retrouve le même système de distanciation et de multiplication des points de vue. À la différence, c’est que là, la scène de la faute originelle, la scène qui détermine tout le reste (celle du pseudo-viol d’une Blanche par un Noir), n’est jamais dévoilée. On ne parle que d’elle, et on se garde bien de la montrer (ce qui rend d’ailleurs possibles les différences de points de vue).


Dans Du silence et des ombres, on comprend l’utilité de la mise en abîme, le fait de mettre une histoire dans l’histoire. Elle a un sens didactique. Le lien entre les deux histoires est simple à comprendre : le récit cherche par le biais des enfants à nous enseigner non seulement qu’un Noir n’est pas plus présumé coupable qu’un Blanc, mais aussi qu’un Blanc peut malgré les apparences être le dernier des salauds. La couleur de peau n’est en rien dans la valeur des hommes ; et il faut se méfier des apparences, ainsi que des hommes qui les utilisent pour arriver à leurs fins.
Dans le Choix de Sophie, Pakula a coupé tous les liens. Restes des pantins inanimés avec des expressions figées. Beaucoup de séquences sont formidables, si on les prend individuellement, mais elles n’ont plus aucune cohérence entre elles. Si on aime le film, on l’aime pour ses scènes dans les camps. Or, elles ne sont que des prétextes, des gadgets. On est pas loin du cinéma sensationnaliste qui se vautre dans les effets et qui se fout du reste. Un film ne devient pas grand parce que son actrice principale est exceptionnelle, parce que la photo est jolie, ou parce qu’il y a deux ou trois scènes d’anthologie. Il faut une cohérence d’ensemble, et ça, Pakula ne l’a pas trouvée.


 Année : 1984
Année : 1984








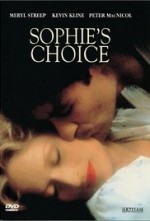






 Année : 1981
Année : 1981




 Année : 1982
Année : 1982


